Marco Nahon
Birkenau, le Camp de la Mort
récit, juin-juillet 1945
page de titre du tapuscrit original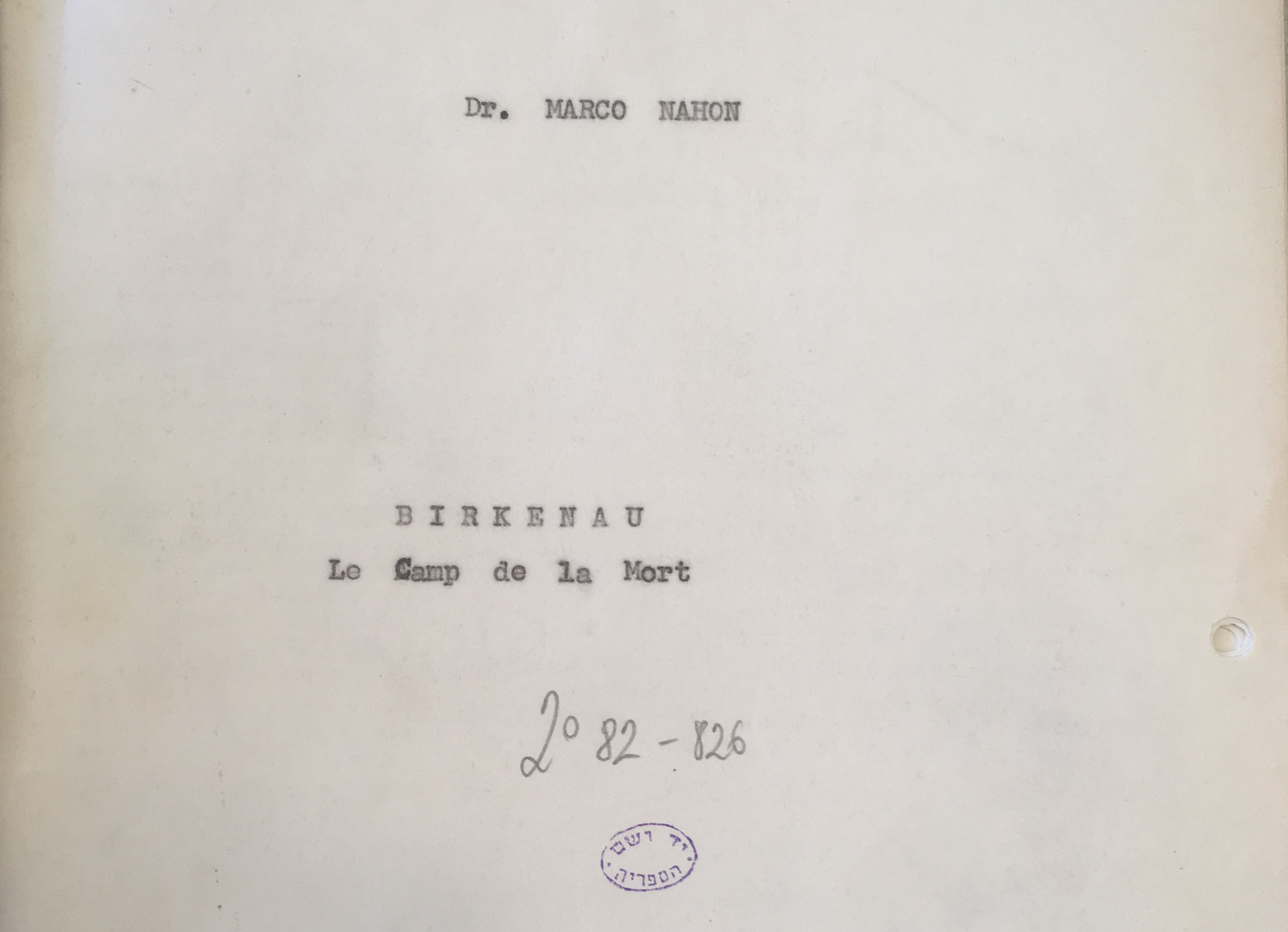
Présentation par PHDN — Le récit de Marco Nahon — Sources et informations — Bibliographie complémentaire
Présentation par PHDN
Né en 1896, Marco Nahon est un Juif originaire de Dhidhimotikhon (Demotika), en Thrace près de la frontière gréco-turque, ville qui fit partie successivement de l’Empire Ottoman, de la Bulgarie puis de la Grèce. Éduqué dans les écoles de l’Alliance Israélite Universelle, il parle français couramment (un nombre important des Juifs de Grèce et d’Asie mineure sont francophones grâce aux actions de l'AIU). Il étudie à Beyrouth (Liban) dans une Université française (probablement Saint-Joseph) de 1912 à 1914 mais le début de la Première Guerre mondiale le contraint à rentrer chez lui (territoire bulgare à ce moment là). Il vit à Xanthi où de 1915 à 1917, il travaille dans une société de tabac. En 1917 il est enrôlé de force dans l’armée Bulgare, stationné à Philippopolis. Lors d’une permission à Demotika il parvient à rejoindre Istanbul qu’il quitte pour Beyrouth où il reprend ses études à l’Université de 1918 à 1922. Il en sort diplômé en médecine. C’est le métier qu’il exerce à son retour chez lui. Il se marie avec Sara Fresco, dont il a un fils, Haïm né le 2 septembre 1926. En 1931 naît leur fille, Esther (Estela).
Les Juifs de Demotika emmenés à Salonique…

La Seconde Guerre mondiale voit la Grèce envahie par l’Italie, la Bulgarie puis finalement l’Allemagne. À partir de mars 1943, les Allemands arrêtent les Juifs afin de les envoyer à Auschwitz pour les y assassiner. En mai 1943, Marco Nahon est arrêté avec sa famille par les Allemands, emmené à Salonique d’où il sera ensuite acheminé à Birkenau où il arrive le 19 mai 1943. Figurant dans la minorité «sélectionnée» pour servir d’esclaves concentrationnaires (la majorité est assassinée, dès son arrivée, dans les chambres à gaz, sans être enregistrée), il survit et assiste aux exactions nazies. Fin 1944 il est expédié au Stutthof puis à Echterdingen et Ordruf. En avril 1945, il fait partie d’une «marche de la mort» qui emmène les rares survivants à Dachau, où il arrive épuisé le 27 avril. Dachau est libéré par les Américains le 29 avril. Sur une famille de quarante personnes, Marco Nahon et son fils sont les seuls survivants. La femme de Marco Nahon, Sara et leur petite fille Estela avaient été assassinées à Birkenau.
Le périple de Marco Nahon 1943-1945…

Marco Nahon sera emmené dans un hôpital à Augsburg. Très rapidement, en juin et juillet 1945, alors qu’il est encore en Allemagne et que la guerre vient à peine de s’achever en Europe, Marco Nahon couche noir sur blanc, en français, le récit de ce à quoi il a assisté. Une fois rétabli, Marco Nahon est emmené à Bari en Italie, puis par bateau à Corinthe d’où il rejoint Athènes en camion. Le fils de Marco Nahon, Haïm Nahon avait été emmené (sans doute dans une marche de la mort) à Mauthausen en janvier 1945, d’où il fut transféré à Melk puis à Ebensee, où il fut libéré le 6 mai. Il parvint à retourner en Grèce à la mi-août 1945 et retrouva son père. À son retour en Grèce, Marco Nahon confit son récit à Asher Moisis qui le traduit en Grec et le fait paraître immédiatement en série dans le journal Hestia. Nous sommes encore en 1945. C’est sans doute l’un des tous premiers récits de survivants, sinon le premier, qui paraît alors.
Sara, Haïm, Marco et Estela Nahon peu avant la guerre…

Un ami d’enfance de Marco Nahon, David Benbassat-Benby, est journaliste à Istanbul lorsque, en 1948, il reçoit la visite de Marco Nahon. Celui-ci lui apporte la liasse de son récit dactylographié en français. David Benbassat-Benby avait déjà publié le témoignage d’un rescapé de Bergen-Belsen, Elie Jaffé, en 1945. C’est ainsi que paraît, en français (mais amputé de quelques passages), le récit de Marco Nahon, en 1948 à Istanbul (Birkenau, le Camp de la Mort, Istanbul: Kağıt ve Basım İşleri A.Ş, 1948, 76 p.).
Marco Nahon et son fils, après avoir vécu de nouveau à Demotika puis à Athènes, émigèrent aux Etats-Unis en 1956 où Marco Nahon continua d’exercer la médecine en Pennsylvanie. Dans les années 1980 il vivait à Philadelphie. Il s’était remarié avec Suzanne, la sœur de sa première femme Sarah. Après le décès de Suzanne, Marco Nahon a vécu chez son fils Haïm, sa femme et leur fils, Marcel. Marco Nahon est décédé en 1992. Haïm Nahon est décédé en Floride en 2007. Il a eu deux enfants, Adam et Rachel. En 1989, l’historien Steven Bowman, qui avait lu le tapuscrit original de Marco Nahon dans les archives de Yad Vashem, en fait paraître une traduction complète en anglais (voir sources), accompagnée d’informations biographiques (que nous avons repris ici) et des cartes et photographies qui accompagnent la présente introduction. Le récit publié en anglais est donc plus complet que la version française publiée en 1948 et rééditée en 1992.
Ce récit éclaire à la fois le sort d’une communauté mal connue, celle des Juifs grecs, dont un nombre important fut intégré dans les derniers Sonderkommandos (les équipes d’esclaves, séparées des concentrationnaires, utilisées pour accompagner les Juifs aux chambres à gaz et incinérer ensuite leurs cadavres) de Birkenau ainsi que le fonctionnement de la machine de mort à côté du camp de concentration, et pourtant intriquée dans celui-ci. Il présente notamment, dans son chapitre XXVI un long récit qu’un membre des Sonderkommandos a confié à un ami de Marco Nahon qui le lui a répété. On y trouve, sans doute pour la première fois, de nombreuses informations qui seront confirmées par d’autres témoins, victimes, bourreaux et tiers, ainsi que par la documentation, sur le fonctionnement des complexes fours crématoires-chambres à gaz de Birkenau et la vie des Sonderkommandos, informations avec lesquelles les historiens sont aujourd’hui très familiers. Il est remarquable aussi qu’y figure (pour la première fois dans un récit publié après-guerre), la mention de la mort du SS Josef Schillinger tué au seuil d’une chambre à gaz par une Juive qui s’est emparé de son arme (ou de l’arme d’un autre SS à proximité), épisode rapporté (souvent de façon indirecte, approximative sinon magnifiée) par de nombreux survivants et témoins (y compris par Hoess)1.
Le tapuscrit original du récit de Marco Nahon (135 feuillets), celui qu’il amène à David Benbassat en 1948, est aujourd’hui conservé à Yad Vashem. Nous avons pu disposer d’une reproduction des trois quarts de cet original (sans les cinq premiers chapitres, ni les trois derniers, mais la comparaison avec la traduction anglaise, complète, de 1989, ne montre aucune différence significative) correspondant à l’expérience intégrale de Marco Nahon à Birkenau. Nous avons pu constater des différences de trois ordres entre cette version tapuscrite et la version imprimée. Les premières, naturelles, sont des améliorations orthographiques et typographiques de la version imprimée, résultat d’un travail d’édition classique qui, ici, ne dénature absolument pas l’original (c’est quasi strictement le même texte). Les secondes portent sur le découpage en paragraphes, dont le nombre a été réduit pour la version imprimée. Nous avons choisi de reprendre dans la présente édition du texte le découpage original, plus clair, même pour les parties issues de la version imprimée. Les troisièmes différences sont les passages de l’original tapuscrit absents de la version imprimée. Deux chapitres entiers sont ainsi inédits (18, Marché noir à Birkenau, et 19, A la recherche d'un "Bon Kommando"), ce qui produit un décalage dans la numérotation des chapitres entre les deux versions (vingt-huit plus un dans la version imprimée, trente plus un dans le tapuscrit original). Quelques passages, allant du simple segment de phrase à plusieurs paragraphes, dans d’autres chapitres figurent également dans l’original mais pas dans la version imprimée. Enfin, il faut signaler que l’épilogue rédigé à Athènes en septembre 1945, présenté dans la version imprimée de 1948, ne figure pas dans le tapuscrit conservé à Yad Vashem.
Malgré le fait qu’il nous manque encore une partie (sans doute moins pertinente pour notre propos en l’occurrence) du tapuscrit original, nous avons choisi de restituer ici le récit de Marco Nahon de façon la plus complète possible en y intégrant les passages manquants figurant dans le tapuscrit original. Afin, toutefois, de ne pas perdre le bénéfice de l’édition imprimée, ce sont les passages de cette version (environ 80% du texte) qui ont eu la priorité, au découpage en paragraphes près. La distinction entre les deux sources est faite de façon explicite par un changement de police de caractères et en encadrant les passages provenant du tapuscrit par des accolades {}. En de très rares occasions un segment de texte de figurant pas dans l’original se trouve dans la version imprimée. Nous l’avons alors signalé en l’encadrant par des crochets []. Nous n’avons pas fait subir au texte du tapuscrit le même travail d’édition que celui qui a abouti au texte imprimé. Nous avons donc conservé aberrations typographiques et la plupart des coquilles, sauf pour de rares fautes d’orthographe trop spectaculaires.
Dans le texte, la maîtrise de la langue française est parfois approximative, mais nous n’avons effectué aucune correction. Le vocabulaire utilisé par Marco Nahon peut surprendre le lecteur quatre-vingt ans après les faits. Ainsi son usage de «internés» pour désigner les esclaves concentrationnaires ne correspond évidemment pas à la connotation carcérale classique attachée à ce terme, mais il faut réaliser que Marco Nahon rédige son récit à un moment (la guerre vient à peine de s’achever en Europe, et se poursuit encore dans le Pacifique) où il est encore plongé dans l’événement, où l’analyse et la compréhension de ce qu’il a traversé n’ont même pas encore commencé. Ce constat vaut également pour l’emploi par Marco Nahon de «ouvriers» pour désigner là-aussi les esclaves concentrationnaires, ce terme signifiant pour lui qu’ils sont tout en bas de la hiérarchie de ces derniers. Marco Nahon se débat de toute évidence avec une réalité inédite et radicale qu’il tente de décrire dans une langue qui n’est pas sa langue maternelle. La narration est parfois décousue, et des retours en arrière peuvent survenir au cours du récit (c’est le cas avec le chapitre tiré du tapuscrit sur le choix d’un «bon kommando»), mais il nous est aujourd’hui difficile d’imaginer quelle fièvre devait étreindre Marco Nahon alors qu’il racontait ces épreuves radicales quelques semaines seulement après en avoir traversé les pires. Le témoignage de Marco Nahon est parfois âpre et sa lecture rendue émotionnellement difficile, tant par la nature des faits rapportés que par le ton hétérogène du narrateur qui oscille entre détachement clinique et grande émotion. Nous avons introduit quelques notes absentes du texte original lorsque nous l’avons jugé nécessaire. Un bref complément bibliographique figure après le texte de Marco Nahon. Nous avons conservé la division en chapitres qui figure dans le texte original. Nous avons laissé intactes l’orthographe (sauf coquille évidente que nous signalons en note) et la typographie de l’édition de 1948, sauf dans de rares cas où nous avons préféré la présentation du tapuscrit original, plus claire.
Le récit de Marco Nahon
rédigé en juin et juillet 1945
I. L’invasion — II. Bruits de Déportation — III. L’Arrestation — IV. Le transport Démotica - Salonique — V. Le Ghetto de Salonique — VI. Le Transport Salonique - Birkenau — VII. Arrivée à Birkenau — VIII. Les Complets — IX. La Ration — X. Les Bucks — XI. Premiers tourments — XII. Les «Lager» de Birkenau — XIII. Le Travail — XIV. Les Stérilisés — XV. La Musique — XVI. Les «S.- K.» — XVII. Les Capos — {XVIII. Marché noir à Birkenau — XIX. A la recherche d'un "Bon Kommando"} — XVIII. Passe-temps nazi — XIX. L’Appel — XX. Le Zigeuner-Lager — XXI. Le Sport — XXII. Le «Zaehne – Konrolle» à Echterdingen — XXIII. Le Krankenbau — XXIV. Les Sélections — XXV. Égards nazis — XXVI. Les «Créma» et les «Sonder-Kommando» — XXVII. Les derniers Transports — XXVIII. La Libération — Épilogue (septembre 1945)
Sur le repos de l’âme de ma femme, sur le repos de l’âme de ma fillette, de ma mère, de mon père, de mon frère, de mes quatre sœurs, de mes neveux et de mes nièces, de mes oncles et de mes tantes, de mes cousins et de mes cousines ; sur le repos de l’âme de plus de quarante membres de mon entourage immédiat assassinés par les Allemands à Birkenau, je jure que les faits relatés dans ce récit correspondent à la plus stricte vérité.
Chapitre I. L’invasion
6 avril 1941. La grande Allemagne a déclaré la guerre à la Grèce. Mais comment, est-ce bien possible? N’est-ce pas Hitler lui-même qui a catégoriquement proclamé que dans le conflit italo-grec l’Allemagne n’a rien à voir? Mais M. Hitler, chacun le sait, n’est pas à un mensonge près.
Dans ma petite ville, il règne aujourd’hui une atmosphère lourde d’inquiétude. La guerre? Mais c’est l’invasion certaine des germano-bulgares! Durant la nuit, tous les fonctionnaires ont traversé la frontière; ils sont déjà en Turquie. Il ne reste plus en ville que quelques gendarmes pour y maintenir l’ordre. Vers 11 heures avant midi, ces quelques policiers passent eux aussi en Turquie; ils traversent la Maritza en barque. Aussitôt voilà une bonne partie de la population qui imite les autorités, tout le monde est plus ou moins atteint de la fièvre du départ. Aussi c’est partout un va-et-vient continuel de gens à pied, de voitures, de bagages de toutes sortes. Nombreux sont ceux qui se dirigent vers Pythion pour prendre le train pour Istanbul; la plupart préfèrent la route c’est si tentant, la Maritza n’est pas bien loin de la ville, il n’y a qu’à la traverser en barque et déjà on est en territoire turc. Chrétiens, Israélites, Mahométans quittent en masse la ville. Parmi les Israélites la plupart ont des parents à Istanbul. Tous escomptent s’y rendre et s’y établir pour toute la durée de la guerre; on ignore en ce moment que la Turquie n’accorde aux réfugiés que des facilités de transit et qu’elle n’autorise en aucune façon l’installation permanente de quiconque chez elle.
Aussi, à peine en territoire turc, presque tous ces réfugiés sont dirigés vers un port, le plus souvent Tekirdag, d’où ils sont embarqués pour une île grecque, pour Mytilène.
L’occupation rapide, foudroyante, par les Allemands d’une grande partie de la Grèce, y compris les îles, déconcerte et paralyse tous les esprits. Le problème est particulièrement aigu pour les réfugiés israélites.
La majorité a déjà été expédiée à Mytilène, quelques jours après les Allemands y débarquent aussi. Seules quelques familles israélites, parmi lesquelles celle du rabbin Alcabès, refusent de se rendre à Mytilène, refusent aussi de rentrer à Démotica par la frontière gréco-turque et, du moment que l’établissement en Turquie même leur est interdit, ils réclament le droit de passer en Palestine. Après beaucoup d’efforts, ils obtiennent gain de cause, leur obstination leur sauve la vie, mais on ignore en ce moment quelle tragique destinée est réservée à la totalité des Israélites de Démotica est qui, plus tard, seront déportés en Allemagne2 pour y être assassinés presque tous.
Depuis quatre jours la ville est abandonnée à elle-même aucune autorité légale n’existe plus. Le soir, avant même le coucher du soleil, chacun se barricade chez lui: ne parle-t-on pas avec terreur des bandes de pillards bulgares attaquant de nuit les villages? Ce soir, dit-on, ils vont descendre en ville même. Aussi, s’est-il formé une commission de sûreté locale à la tête de laquelle est le métropolite. Ce prélat, confirmant une fois de plus la tradition du clergé grec dont l’Histoire Hellénique rapporte de si nombreux cas d’héroïsme et de sacrifices, parcourt toute la journée la ville dans tous les sens, infatigable, remontant le moral tout en insufflant du courage à tous par sa seule présence. Puis, un soir vers 6 heures la nouvelle se répand rapide comme l’éclair. Ils arrivent! «Ils» ce sont les Allemands. Ils entrent en ville dans quelques voitures motorisées comme des touristes, sans tirer un seul coup de fusil. Ils prennent aussitôt possession de la préfecture et s’y installent.
Leur commandant reçoit diverses délégations et les représentants des communautés religieuses. Naturellement, la communauté israélite y est également convoquée. Au cours d’une brève harangue, le commandant affirme que dans les territoires occupés les Allemands ne font aucune distinction de race ni de religion. Les Israélites sortent de la Komandantur quelque peu rassurés.
Depuis deux années presque, les Allemands occupent notre ville. D’une façon générale on peut dire que durant ce temps, les Israélites n’ont pas été trop molestés. Il y a bien presque tous les jours des visites aux magasins juifs d’où les Allemands emportent les objets et les étoffes qui leur plaisent en payant le prix qui leur plaît ; il y a des visites aux maisons juives d’où les Allemands emportent le mobilier qui leur convient ; il y a bien aussi de fréquents coups de fouet au cours de travaux de réparation d’une route que les Allemands font exécuter exclusivement par des Juifs ; mais ce sont là des détails insignifiants si l’on songe à l’immensité de l’orage qui va bientôt s’abattre sur les Juifs de Démotica.
Un jour ma femme, qui parlait assez bien l’Allemand, accompagne chez le commandant von Kleist, à titre d’interprète, la femme de Joseph Alcabès, qui, de retour de Mytilène a trouvé sa maison occupée par les Allemands. Madame Alcabès demande à von Kleist la permission de réoccuper, pour y installer sa famille ; un étage de sa maison. Naturellement von Kleist refuse ; et il ajoute, s’adressant à ma femme: «mais pourquoi diable tant de Juifs ont fui devant l’avance des Allemands? Est-ce que nous avons jamais songé à leur faire le moindre mal?» Sont-ils assez stupides pour cela?»
Herr von Kleist, je crois, aujourd’hui encore, que vous étiez un Allemand pondéré, réfléchi ; et, phénomène tout à fait exceptionnel durant la guerre, un Allemand inoffensif. Êtes-vous encore en vie, von Kleist? Sauriez-vous me dire maintenant où sont tous les Juifs de Démotica que vous prétendiez ne pas inquiéter? Où sont-ils: ma femme, ma fillette, ma mère, mon père, mon frère et mes sœurs et une quarantaine au moins des membres de mon entourage immédiat? Non, les Allemands ne vont pas s’attaquer aux Juifs. Ils ne vont pas faire de distinction de race ni de religion. Leur commandant n’a-t-il pas engagé sa parole d’honneur d’officier Allemand? Cependant, ils ont réduit les Juifs en fumée et à quelques grammes de cendres jetés à la Vistule… Mais cela c’est une autre histoire, une terrible histoire.
Chapitre II. Bruits de Déportation
Au début de mars 1943, des bruits inquiétants arrivent de Salonique: les Allemands déportent les Juifs. On les enferme dans des wagons à bestiaux jusqu’à 70-80 par wagon; et ils sont expédiés quelque part en Pologne dit-on; en réalité personne ne sait exactement où. On se concerte entre amis. Que faut-il faire devant la menace imminente? Quel parti prendre? Mon ami Vitalis Djivré, quoique se croyant lui-même à l’abri de tout danger, parce que citoyen espagnol, est catégorique: il faut fuir, il faut passer de suite en Turquie, en Palestine, en Égypte, n’importe où, mais fuir immédiatement. Moi-même, hélas! et quelques-uns de mes autres amis, sommes d’un avis tout opposé. Non, quoi qu’il arrive, je n’émigre pas. On va nous déporter en Allemagne ou en Pologne? et après? On nous y fera travailler? Je travaillerai. La guerre ne va pas durer éternellement; elle va durer une année, deux années encore; et comme il est certain que ce sont les Alliés qui remporteront la victoire, la guerre finie, nous rentrerons chez nous.
Nous avons cependant certains avertissements. Un jour, je suis à la pharmacie de Mr. Assinacopoulos. Le professeur de l’académie de langue allemande, Mr. Papanastassiou, vient d’y arriver ; il étale aussitôt un journal de langue allemande, le «Donau Zeitung». À un moment donné, il me dit: «tiens, tu vois cet article? Il y est dit que l’Allemagne a l’intention de rassembler tous les Juifs de Grèce dans des Konzentrations-Lager. Personne ne le sait. En ce moment pour la plupart d’entre nous, les Konzentrations-Lager ce sont des villages abandonnés par les Polonais par suite des opérations de guerre, et où l’on va installer les Juifs, pour que, mettant en pratique la théorie nazie, les Juifs vivent exclusivement entre eux. Un autre jour, c’est Marco Raphael Béhar qui vient nous trouver. Il est encore tout troublé de ce qu’il vient d’apprendre: Mr. Mandjaris, le directeur de la douane, lui a rapporté une conversation qu’il a eue avec un officier de la Gestapo. Tous sont les pensionnaires de la même maison. Mr. Mandjaris a demandé à l’officier: que font en Pologne tous les Juifs de Salonique déportés? L’officier n’a pas hésité une seule seconde: les Juifs déportés? Mais ils y sont tous exterminés. Nous, naturellement, nous n’attachons aucune importance à cette information; il n’est pas possible qu’on tue des populations en masse sans aucune raison; et puis, pourquoi les conduire si loin; si vraiment on veut exterminer les Juifs, qu’est-ce qui empêche les Allemands de les tuer ici même? Tous ces bruits sont sans doute perfidement et intentionnellement répandus par les agents de la Gestapo dans le but de briser le moral des Juifs. C’est la guerre des nerfs déclenchée contre les Juifs. Ainsi se laissait-on bercer par des illusions trompeuses et endormait on la vigilance.
De Salonique, les nouvelles arrivent confuses et contradictoires. Un jour les «Transports» continuent régulièrement. Un autre jour les «Transports» n’ont plus lieu, ils se sont arrêtés: les Allemands n’ont pas l’intention de vider complètement Salonique de sa population juive. Dans l’ignorance de la réalité, nous nous donnons des explications toujours favorables à nos désirs.
Et les Juifs de Démotica, eux, seront-ils déportés? Personne ne le sait. Les avis sont partagés; chacun émet une hypothèse. Démotica c’est la zone libre, c’est le Protectorat de l’Ebre. Là, les Allemands ne toucheront pas aux Juifs. Les Allemands, eux, sont d’une discrétion absolue. Bon nombre d’Allemands fréquentent en cachette des familles juives, mais aucun ne fait allusion à la déportation des Juifs; sauf un seul, Mr. von Salomon, de la Gestapo. Mr. von Salomon est l’ami de David Tarabulus; ce dernier parle parfaitement le Français et l’Allemand. Von Salomon parait se plaire énormément à sa conversation. Il va chez lui presque tous les soirs. Puis, le jour suivant, Tarabulus rapporte à un petit cercle d’amis la conversation qu’il a eue la veille avec von Salomon. Mais ce dernier, ne l’oublions pas, est un agent de la Gestapo. Pourquoi vient-il si assidûment chez un Juif? Ne vient-il pas, lui aussi, pour propager de faux bruits et faire la guerre des nerfs? De la part d’un Allemand, surtout d’un Allemand de la Gestapo, tout est possible. Aussi, dans ses conversations, Tarabulus est-il d’une extrême prudence. Il laisse parler von Salomon et parle lui-même très peu. Un jour, von Salomon lui annonce une mauvaise nouvelle, comme il dit: «Les Juifs de Démotica eux aussi seront déportés; il tient cela d’une source sûre. La seule chose que je puisse faire, ajoute-t-il, c’est de vous avertir 1-2 jours avant votre arrestation». Puis il continue «je crois que le plus dur3 pour vous sera le voyage; vous serez dans des wagons à bestiaux, fermés, jusqu’à 80 par wagon. Mais une fois arrivés à destination, vous ne serez pas aussi mal que vous pouvez le supposer. Vous y mènerez une vie certes difficile mais supportable».
Le lendemain, Tarabulus nous rapporte cette conversation si importante. Mais, comme toujours, nous supposons, les choses les plus contradictoires ; ne s’agit-il pas encore d’une machination allemande?
Ainsi, nous sommes jusqu’à la fin sourds à tous les avertissements. Ni l’article du «Donau Zeitung» annonçant l’intention formelle de l’Allemagne d’arrêter les Juifs de Grèce, ni la confidence imprudemment échappée à un officier de la Gestapo affirmant que les Juifs déportés sont tous exterminés, ni les révélations amicales de von Salomon n ‘ont pu être pour nous des tocsins d’alarme pour la gravité du drame en préparation. Mais aussi l’esprit humain se refuse à concevoir l’extermination totale d’une population innocente. Là fut notre erreur tragique et la cause principale, presque unique, de notre perte.
Chapitre III. L’Arrestation
3 Mai 1943. La veille au soir, von Salomon a averti D. Tarabulus que la commission pour les affaires juives et le train pour le «Transport» des Juifs de Démotica ont quitté Salonique. L’arrestation des Juifs est imminente. Le soir de ce même jour, la commission arrive. Le lendemain 4 mai 1943, le chef de cette commission, un S. D., réunit à la Gestapo tous les officiers Allemands présents à Démotica. Il y invite aussi le conseil communal israélite. «Il faut, dit-il, rassembler à la synagogue, dans l’intervalle d’une demi-heure, tous les Juif s mâles âgés de 15 ans et au-dessus. Ne craignez rien, ajoute-t-il, j’ai simplement à leur communiquer certaines choses, cela ne va pas d’ailleurs durer longtemps; ne prenez pas la peine de fermer vos boutiques, chacun pourra retourner de suite à ses affaires». Il a été d’une correction parfaite, presque affable. Une demi-heure plus tard, tous les Juifs sont présents à la synagogue, les élèves du gymnase4 y compris. De temps en temps l’Allemand a soin de demander si nous sommes au complet et lorsque finalement il s’en est bien convaincu, il ordonne que l’on ferme les portes de la synagogue, et d’un ton dur et impératif contrastant avec son affabilité de tout à l’heure, par l’intermédiaire d’un interprète, il nous tient son petit discours que trente minutes plus tôt il prétendait inoffensif:
«— A partir de ce moment vous êtes prisonniers. Tenez-vous bien tranquilles, car quiconque tentera une évasion sera immédiatement abattu par les postes qui entourent la synagogue. (Effectivement, en cet instant précis, comme au cinéma, les parages de la synagogue, jusque-là déserts, sont subitement entourés de tous les côtés par des postes nombreux). Vous serez transportés à Salonique pour y travailler. La nourriture pour le trajet vous sera assurée par votre propre communauté (quel cynisme allemand! Il n’y a plus de communauté, tout le monde est enfermé, la communauté ne peut absolument rien, les Allemands le savent très bien, mais ont-ils besoin de se faire du souci que les Juifs aient ou n’aient pas à manger dans le train?) Chacun de vous va écrire immédiatement quelques mots à sa femme pour qu’elle prenne les objets qui vous sont nécessaires et surtout (il élève la voix et martèle les mots) tout l’or et tous les joyaux, car là où vous irez vous en aurez besoin. Vos femmes et vos enfants doivent être à la synagogue au plus tard dans une heure».
Une heure plus tard, tous les Juifs de Démotica, femmes, enfants, jeunes, vieux, sont rassemblés à la synagogue. On est, si je ne me trompe, quelques 740. Dans l’après-midi, tous les Israélite de Néa-Orestias, conduits en camions, sont eux aussi parqués dans notre synagogue.
Chapitre IV. Le transport Démotica - Salonique
Cinq Mai 1943, c’est le départ, le «Transport» vers 11heures du matin, le défilé s’ébranle. On le dirige vers la gare. Les Allemands déjà sont moins corrects et commencent à montrer ce qu’ils n’ont jamais cessé d’être: des brutes et des barbares. Pour un rien, ils tapent à coups de matraque. Moi-même je reçois sur la tête un coup de massue qui me laisse étourdi pendant quelques minutes. Ils tirent des coups de l’automatique à l’intérieur même de la synagogue, pour hâter soi-disant les retardataires: en réalité pour semer la terreur. Un S.S. bien dressé (et qui peut bien douter qu’ils ne le sont pas tous) se doit de n’avoir aucun respect pour la croyance et la foi des autres, ni pour les sanctuaires. Chacun de nous, jusqu’au plus petit enfant, emporte sur son dos un bagage quelconque. À ce moment, et soi-disant par hasard, le métropolite avec son grand courage qui ne le quitte pas, traverse le quartier israélite. Personne ne se méprend sur le motif réel de sa promenade. Les israélites comprennent bien que c’est pour les saluer et leur témoigner sa sympathie qu’il est descendu en ville. Plusieurs, en guise de remerciement lui baisent une dernière fois la main.
Dès cet instant, nous ne nous appartenons plus ; nous sommes des esclaves ; moins que des esclaves. Un esclave peut parfois tomber sur un maître compatissant: mais des Allemands que peut-on attendre sinon la confirmation de la fureur teutonique, brutalisant les gens jusqu’à les assommer.
A la gare, le train est prêt. Au fur et à mesure que les déportés arrivent, ils sont entassés dans les wagons. Dès qu’un wagon contient 70 à 80 personnes, on le ferme à double tour pour passer en vitesse au wagon suivant. Mon père qui nous a devancés un peu en chemin dès son entrée dans la gare, est poussé dans un wagon qui est immédiatement refermé sur lui. Comme bagage, il a tous les pains pour notre voyage, rien que des pains. À notre tour, ma femme, mes enfants et moi-même arrivons à la gare ; on nous pousse dans un autre wagon. Ainsi durant tout le trajet de Démotica à Salonique qui dure plus de trois jours, nous n’avons pas de pain. Heureusement, des compatriotes qui voyagent dans le même wagon nous en fournissent. Dans les wagons la vie tout de suite s’organise ; chacun s’installe comme il peut la plupart restent assis sur leurs bagages. Les wagons, naturellement, sont hermétiquement clos, on n’a de lumière que par les petites ouvertures aménagées une à droite et une à gauche. Ces ouvertures sont tout en haut des parois, ce qui complique d’autant la manœuvre consistant à vider au dehors les pots de nuit. Par ces ouvertures, quand le train s’arrête dans une station, un S.S. s’amuse à lancer des pierres, sans rime ni raison ; et comme les wagons sont bondés de gens pressés les uns contre les autres, le S.S. a toute garantie de réussir une tête. Mais, il faut reconnaitre son impartialité et lui rendre justice: il s’évertue à ne mécontenter personne; consciencieusement, tous les wagons, à tour de rôle, reçoivent leurs pierres.
A toutes les stations les habitants nous témoignent leur sympathie. Est-ce la haine commune de l’Allemand barbare qui provoque ce rapprochement des autres peuples? Beaucoup de gens nous sollicitent du regard et vont au-devant de nos désirs. C’est surtout du manque d’eau que nous souffrons; on nous en apporte partout des seaux pleins. Je n’oublierai jamais le dévouement de l’adjudant de gendarmerie Lambros Mihalopoulos et de ses hommes à la station de Mouriés, allant de wagon en wagon s’enquérir de nos besoins. Pendant des heures et des heures, ils ne s’occupent que de nous. Infatigables, ils nous apportent dans un va-et-vient continuel de l’eau, du pain, du fromage, des bougies, etc… A la tombée de la nuit, les Allemands convoyant le train défendent à quiconque l’approche des wagons; dès qu’ils aperçoivent une ombre près du train, ils tirent dessus. Malgré ce danger mortel, l’adjudant et ses gendarmes continuent dans l’obscurité, et au risque de leur vie, à nous porter encore de l’eau et des vivres. Dans le wagon faisant suite au nôtre, un vieillard se trouve mal. On a pu se procurer une ampoule d’huile camphrée, mais on manque dé seringue pour faire l’injection. Albert, le gendre du malade sait que je me trouve dans le wagon contigu et que j’ai une seringue sur moi. À voix basse, pour ne pas être entendu des Allemands, il supplie un gendarme de me demander la seringue. Mais à l’instant même où celui-ci tâtonne dans l’obscurité et essaie de remettre la seringue, Albert, dans le but d’éclairer le gendarme, commet l’imprudence d’avancer à travers l’ouverture du wagon une allumette enflammée. Immédiatement une décharge de l’arme automatique des Allemands fait reculer le gendarme qui l’échappe de justesse. Puis, me rendant la seringue:
«— Docteur, reprenez votre seringue, me dit-il, j’ai failli être tué par l’imprudence de votre camarade».
Je pensais que l’épisode était terminé. Deux minutes plus tard, j’entends du dehors le même gendarme m’appeler à voix basse:
«— Docteur, docteur, donnez-moi la seringue, je la passerai au malade, je leur recommanderai de ne pas allumer cette fois».
J’avais les larmes aux yeux. De pareils hommes font le plus grand honneur à leur pays.
Chapitre V. Le Ghetto de Salonique
Dimanche matin 9 Mai 1943, nous sommes en gare de Salonique. On ouvre les portières des wagons et en vitesse, schnell, schnell, on forme une colonne qu’on dirige vers le quartier Hirsch transformé en ghetto. Deux ou trois familles sont installées dans une même chambre. La nourriture y est assurée par la communauté ; on distribue une soupe midi et soir. La synagogue de ce quartier est transformée en une espèce de bureau ; on dirait une banque avec une multitude d’employés, de machines dactylographiques, etc. Tous les déportés doivent s’y rendre pour s’y faire enregistrer et avoir leur numéro.
De plus, tout l’argent dont on dispose doit y être versé contre un chèque en zlotis. Tout le monde est porteur d’un zloti, on en aura besoin en Pologne! En Pologne, naturellement, aucune autorité ne s’est jamais inquiétée ni des chèques, ni des zlotis. Les Allemands croient faire montre de finesse, alors même qu’ils mettent l’empreinte du sceau de leur esprit le plus lourd. Ils ne négligent aucune occasion de se moquer, à leur façon, des Juifs, même au moment de les assassiner. Tous sont obligés de se faire coudre sur la poitrine l’étoile de David, en étoffe jaune. Beaucoup de déportés sont conduits dans un bureau spécial où ils sont fouillés minutieusement et débarrassés, sans une quittance, de toutes les pièces d’or. J’ai pu voir dans ce bureau une quantité de métal jaune telle que je n’en avais jamais vu auparavant. Tous ces tripotages se font exclusivement par des Juifs, on oublie par instants l’existence des Allemands. Mais naturellement, les opérations sont faites sous leur contrôle et pour leur compte exclusif.
Dans le ghetto, la vie est réglementée par des lois et des canons rigides. Toute la journée, ou presque, on doit être enfermé chez soi. On ne peut circuler dans les rues qu’à telle ou telle heure. Il est rigoureusement défendu, sous peine d’être rudement passé à tabac et d’être ensuite emprisonné, de sortir en dehors de l’heure prescrite. Non pas qu’on ait fixé un horaire à l’avance et que l’on sache à quoi s’en tenir ; tout change à chaque instant, suivant le bon plaisir de la milice juive du camp. Tout est d’ailleurs réglé et annoncé par des clairons: ce clairon annonce l’heure de distribution de la soupe; cet autre son veut dire qu’on peut sortir librement dans les rues, ou rentrer d’urgence à la maison.
J’ai peine à me rendre à la réalité. Je me frotte les yeux. Est-ce que je rêve? Ou bien, peut-être, durant des heures me suis-je perdu dans la lecture de quelques œuvres de Zangwill ou d’un autre auteur Juif narrant la vie dans les ghettos du moyen-âge? Est-il possible que de nos jours, époque des avions ultra-rapides et de la radio, diffusant partout dans le monde l’idéal de liberté et de libre pensée, des gens qui tout à l’heure étaient libres et indépendants, soient maintenant embrigadés et contraints d’obéir, malgré leur répugnance manifeste, à des commandements absurdes et d’un autre âge? Est-ce que je rêve? Mais non, il faut se rendre aux faits quelque amère que soit la réalité: les clairons retentissent constamment et déchirent nos tympans de leurs sons aigus pour nous enlever nos dernières illusions.
Chapitre VI. Le Transport Salonique - Birkenau
…Lundi 10 Mai. De très bonne heure les clairons nous réveillent ; il faut se rendre à la gare, c’est le départ pour la Pologne. Notre «Transport» Démotica-Orestias qui compte 1070 personnes est complété par des Saloniciens. À la gare, c’est le même procédé qu’à Démotica, dès qu’un wagon est bondé, on le referme immédiatement et l’on passe en vitesse au wagon suivant. Mais ici, les Allemands montrent encore plus de décision et de dureté. Des officiers, le revolver au poing, menacent constamment la foule. De temps en temps des coups de feu retentissent. C’est qu’il faut faire vite, schnell, toujours plus «schnell». Serait-ce que pour les Allemands, l’issue favorable de la guerre dépendrait surtout du schnell des Juifs? C’est la question qu’on ne peut s’empêcher de se poser. Le «transport» est convoyé par des agents de la Schupo; ils sont bien moins rudes que les S.S.
Le train s’arrête à une petite station. Deux schupos visitent successivement tous les wagons à la station suivante: on doit remettre toutes les pièces d’or et tous les bijoux: on fera un contrôle serré et celui qui sera pris avec de l’or ou des bijoux sur lui, sera impitoyablement fusillé sur place. Dans tous les wagons on ramasse de suite l’or et les bijoux. Certains préfèrent ne pas les remettre aux Allemands et les lancent dans les champs à travers les fentes des wagons. Le jour suivant, nouvelle visite: cette fois on doit livrer toutes les montres. Un autre jour, chaque wagon doit fournir aux Allemands dix pièces de savon. Le jour d’après ils s’attaquent à nos vivres, on doit leur remettre des figues et des raisins secs. Ainsi, régulièrement tous les jours, ils exigent quelque chose de nous. Naturellement, il n’y a pas à discuter, il faut s’exécuter sans aucune objection. Ces bandits opèrent pour leur propre compte; en escamotant les biens des Juifs, ils volent leur propre gouvernement qui, avant d’assassiner les Israélites, s’est proclamé aussi leur héritier. Mais le pillage est d’une telle envergure, qu’i y en a pour tout le monde.
Tous les deux jours, le train s’arrête devant quelque prairie: on ouvre les portières des wagons, tout le «Transport» s’éparpille dans les champs. Hommes et femmes satisfont leurs besoins naturels, côte à côte, sans aucune gêne. La nécessité et les malheurs communs en ont fait une seule et même famille.
{Durant un de nos arrêts dans les champs, je rencontre mon ami X. Nous échangeons à la hâte nos impressions du dramatique voyage. --- "Dans mon wagon me dit mon ami X, la situation est horrible : les fenêtres de ventilation ne sont pas libres comme dans les autres wagons; elles sont fermées par des plaques en tôle percées de trous minuscules; impossible de vider par là les pots de nuit. Forcément on essaye de verser les selles au dehors par la seule issue accessible : par les étroites fentes du bas des portières. Les ébranlements du train en marche font verser une bonne partie du contenu des pots à l'intérieur du wagon, et le reste forme à l'extérieur et tout le long des portières des stalagtites de matières. L'atmosphère dans les wagons est nauséabonde. Et, par dessus tout, les S.S. du convoi, sarcastiques, ne cessent de nous importuner en nous répétant avec mépris : on voit à la vérité que vous n'êtes que de sales Juifs.}
Nous sommes dans une petite station d’Autriche. La portière de notre wagon s’entrouvre et un schupo demande le médecin: «Docteur une femme est en train d’accoucher et vous réclame». Il me conduit vers la quelle du convoi et m’enferme dans le wagon de la femme en travail. C’est une primipare, toute jeune. Comme tous les autres wagons, celui-ci aussi est bondé d’internés. L’accouchement a lieu dans des conditions déplorables, devant les regards de tous les habitants du wagon, hommes, femmes et enfants. Heureusement tout se passe bien et quelques heures après un bébé, un garçon voit le jour. La famille de l’accouchée est toute heureuse et distribue des sucreries. Comment pouvait-on se douter que deux jours plus tard, la jeune maman, le bébé et les trois quarts de l’assistance passeraient par la cheminée d’un des crématoria de Birkenau!
Chapitre VII. Arrivée à Birkenau
16 Mai 1943. Nous sommes au terme de notre voyage. Le train s’arrête devant un quai en planches. À travers les ouvertures des wagons, on aperçoit des gens portant des costumes rayés bleu et blanc. On remarque de suite qu’ils ne font rien de leur propre volonté ; ils se meuvent et agissent au commandement de l’un d’eux. À un moment donné, ils grimpent sur les wagons, en ouvrent les portières et schnell, ils nous empoignent et nous poussent dehors. Il est défendu d’emporter quelque chose avec soi. Les bagages dont le transport fut si pénible jusqu’ici ; les vivres dont on usait avec parcimonie, (certains d’entre nous, par prudence n’osaient pas manger à leur faim durant le voyage afin de faire quelques réserves pour les premiers jours de notre établissement en Pologne.) Tout, absolument tout doit être abandonné. Les gens en rayé qui ne nous parlent que par mimique (il leur est sévèrement défendu de s’entretenir avec les nouveaux arrivants) se chargent de descendre les bagages sur le quai. On nous range par cinq, femmes d’un côté, hommes de l’autre. Dans la foule je perds de vue ma femme et ma fillette. Je ne devais plus jamais les revoir. On nous fait défiler en vitesse, comme toujours, devant un groupe d’officiers et de sous-officiers. L’un d’eux sans proférer une seule parole, du haut de l’index, fait un triage rapide. C’est, on l’apprend plus tard, le Lager-Arzt, le médecin du camp. Ici on l’appelle l’Ange de la Mort. Il sépare les hommes en deux groupes: les jeunes et forts, seuls aptes au travail, d’après la conception allemande; et les vieux, les enfants au-dessous de 15 ans, les malades soi-disant inaptes au travail. Ces derniers sont immédiatement montés en voiture et transportés quelque part. Où? Personne ne le sait encore. Pour les femmes, on procède de même. Les vieilles, les malades, les femmes quoique jeunes et bien portantes mais ayant des enfants au-dessous de 15 ans, ces enfants eux-mêmes, sont installés sur des camions. Les jeunes et sans enfants sont seules reconnues aptes au travail et forment un groupe séparé.
On se met en marche, toujours par cinq, les hommes sont conduits au Lager des hommes, les femmes au Lager réservé aux femmes. On ignore encore en ce moment que personne ne reverra plus sa famille.
Arrivés au Lager, nous sommes introduits dans une baraque en planches: c’est le Block, comme cela s’appelle dans le camp. Les Blocks sont alignés des deux côtés de la route. Chacun peut avoir 40 mètre sur 12. Pas de fenêtres aux parois, la lumière s’infiltre par des fentes aménagées près du toit. Ce n’est naturellement pas un hasard de la construction; non, mais bien intentionnellement calculé. De temps en temps les habitants de chaque Block sont consignés dans leurs baraques respectives, portes hermétiquement closes. Toute circulation dans le Lager est interdite aux déportés sous peine de mort: c’est le «Block-sperre».
Dès que le gong annonce le Block-sperre, d’urgence tous les détenus s’enferment dans les baraques. Le son du gong résonne dans les cœurs avec des notes sinistres. Que se passe-t-il? Les S.S. préparent-ils un assassinat en masse? On ne peut absolument rien savoir de ce qui se fait au dehors, de ce qui arrive dans les Blocks voisins, dont on n’est pourtant séparé que d’une vingtaine de mètres.
Nous n’avons, je l’ai dit, aucun bagage avec nous ; à la gare les gens en rayé nous les ont soustraits pour les remettre aux Allemands. À peine arrivés au Block, nous défilons devant un ancien détenu gradé, un Capo, assis devant une table. Derrière lui, se tient debout un S.S. Nous devons nous présenter les poches retournées et de plus le Capo fouille tous les nouveaux arrivants. Tout est enlevé et déposé sur la table: pièces de monnaie, montres cachées, bague d’alliance, porte-plumes, couteaux, etc… jusqu’aux cigarettes. On n’a droit qu’à des poches complètement vides. Le S.S., et c’est leur tactique de toujours, ne s’intéresse directement pas du tout à ce travail; on dirait qu’il se trouve là comme par hasard et ce spectacle semble l’amuser. Puis, la fouille finie, il emporte tout le fruit du brigandage pour le remettre à ses chefs.
Maintenant nous devons défiler devant les Aufnahme Schreiber ; ce sont les scribes chargés de la réception et de l’enregistrement des «Transports». Chaque détenu remplit un formulaire en déclinant son identité, et reçoit son numéro. Dans les Lager allemands il perd de suite son individualité, il n’est qu’un numéro. Mais, je crois, que de tous les Lager, seulement à Auschwitz-Birkenau les numéros sont marqués par tatouage sur l’avant-bras de chacun. J’ai le No. 122274 et nom fils qui me suit reçoit le No. 122275. Ce tatouage nous inquiète énormément ; il fait sur nous la plus pénible impression. Chacun de nous est obligé de s’avouer dans le plus profond de son être conscient et avec amertume, qu’à partir de cet instant il est complètement assimilé à une bête.
Vers deux heures de l’après-midi, on nous sert pour la première fois la soupe: un litre d’eau dans laquelle nagent des bouts de pomme de terre et de rutabaga. Pas de cuillères, on boit la soupe à même la gamelle. Les gamelles elles-mêmes ne sont pas suffisantes; il faut attendre que les uns finissent leur repas pour avoir une gamelle vide. Ceux qui mangent sont d’ailleurs continuellement harcelés par les cris des Vorarbeiter (surveillants du travail) schnell, schnell, pour qu’ils avalent leurs soupes le plus tôt possible, quoique parfois brûlantes, afin qu’ils libèrent leurs gamelles et les passent aux autres camarades. On n’a naturellement pas la possibilité ni le temps de laver sa gamelle; la même déjà sale, doit servir six, sept fois à des détenus différents.
Le repas terminé, apparait Léon Yahiel. C’est un ancien du Lager, il est déjà ici depuis 2-3 mois et il a un poste. Il nous tient une petite harangue: «Mes amis, dit-il, ici vous devez tout oublier, oublier votre passé, oublier Salonique (en ce moment la plupart des Juifs du Lager sont de Salonique), oublier vos familles, vos femmes, vos enfants. Il vous faut vivre rien que pour vous-mêmes, et tâcher de tenir le plus longtemps possible. Ces quelques paroles nous plongent dans le plus grand désespoir. Ne plus songer à nos familles? C’est donc qu’on ne nous les rendra plus! Les esprits se troublent; Yahiel n’est-il pas lui aussi, de gré ou de force, à la solde des Allemands? Il, a dû sûrement être ainsi instruit par les Allemands pour briser nos nerfs. Il est impossible qu’un jour prochain nous ne retrouvions pas nos familles. Nous séparer définitivement d’elles? Non! une sanction pareille, sans avoir rien fait pour la mériter, sans aucune provocation n’est humainement pas possible. Ainsi pensent tous les détenus, malheureux que nous sommes! Nous ignorons en cet instant que nos femmes, nos enfants, nos mères, nos pères n’existent déjà plus. Arrivés seulement ce matin pleins de santé, tout à la joie de vivre, ils sont déjà réduits en fumée et en cendres….
Chapitre VIII. Les Complets
Dans l’après-midi commence la désinfection. Nous sommes conduits, toujours par cinq, à la salle des douches. Dans l’antichambre après le rasoir les ciseaux allègent copieusement nos cheveux. Puis nous sommes débarrassés de nos habits. Les vêtements de tous les détenus sont entassés pêle-mêle et forment une petite montagne. Impossible de retrouver ses effets respectifs. Cela n’a d’ailleurs pas d’importance. Après la douche nous recevons un autre costume: le complet du camp.
Ce sont des pièces ignobles et ridicules. Un tel reçoit une veste très courte et très étroite et un pantalon immense ; un autre reçoit des vêtements tout usés et déchirés ; presque tous sont sans boutons. Les vestes portent sur le dos une grande croix rouge ; sur le dos également un grand carré de tissu est remplacé par un morceau d’étoffe rayée bleu et blanc. Sur la poitrine, à la place du cœur s’étend une bande horizontale de toile blanche qui recevra le numéro d’immatriculation. Dans le coin droit de cette bande un triangle rouge, vert ou noir, suivant qu’on est dans le camp pour délit politique, de droit commun ou pour sabotage ; pour les Juifs, l’étoile de David en rouge et jaune. Sur les triangles, une lettre majuscule pour différencier les nationalités: G pour les Grecs, F pour les Français, R pour les Russes, etc… Et, si l’on a des punitions spéciales, des bandes rouges, des cercles rouges devant et derrière en supplément. Le pantalon porte latéralement de haut en bas une large bande de peinture. À droite, au-dessus du genou une bande avec des numéros, le triangle en couleur de qualité avec la majuscule de nationalité.
Les Allemands ont poussé jusque dans les camps leur amour des uniformes et des décorations ; mais ici dans un sens pitoyable et ridicule. Tous les détenus, en sortant de la désinfection, ainsi travestis, sont déjà méconnaissables ; ils ont tous l’air d’être tout d’un coup promus généraux, mais des généraux ignobles et ridicules. Ainsi arrivés au camp de concentration ce matin seulement, avec un tas de bagages, de vêtements, d’objets de literie, d’ustensiles de cuisine, de vivres, etc… nous sommes actuellement allégés de tout, et mis à nus, complètement à poil. Rien ne nous appartient plus. Nous ne possédons plus que les six pièces distribuées à la désinfection et qui constituent désormais tout l’avoir, toute la richesse d’un interné: la chemise, le caleçon, la veste, et la Mütze (la casquette). Pas de flanelle, pas de chaussettes, pas de mouchoir, pas de serviette. Quand un détenu se lave, il s’essuie sur sa chemise; d’autres préfèrent la casquette. De ce complet, la pièce la plus importante est la Mütze: il a un emploi multiple. D’abord et en premier lieu, son rôle de beaucoup le plus important pour les chefs qui nous commandent, c’est que c’est une… Mütze. Celui qui est passé par un camp de concentration allemand, seul, se rend compte de l’importance de la Mütze en tant que …Mütze. {La Mütze n'est-elle pas le symbole tangible de notre esclavage? Dès qu'un S.S. approche, il faut nous découvrir: Mütze ab! Si l'on ne se découvre pas devant un S.S., soit qu'on ne l'ait pas aperçu, soit qu'on ait oublié, il est capable de tuer par des coups; par contre, jamais un S.S. ne vous rend le salut.
Dans le Lager tout débute au commandement "Mützen-ab" et "Mützen-auf" et jusqu'un tel point qu'il nous semble que si la casquette n'existait pas, il aurait fallu absolument l'inventer, rien que vous faire "Mützen-ab" et "Mützen-auf".}
Tout se fait au commandement du Mützen ab, Mützen auf. {Aussi, durant} Des heures entières (lorsqu’on ne travaille pas naturellement, et qu’on jouit soi-disant du repos) des Capos et des Block altester sont capables de vous retenir dans les rangs à faire l’exercice du «Mützen ab» et du «Mützen auf».
Puis, très loin, viennent les autres fonctions de la Mütze; c’est naturellement le couvre-chef; puis c’est l’essuie-mains; c’est aussi très souvent l’assiette toute prête du détenu, quand on distribue des pommes de terre bouillies, par exemple.
Chapitre IX. La Ration
Après la douche, on rentre dans le Block. On distribue la ration du jour: 300 grammes de pain, un petit bout de saucisson: qui est remplacé parfois soit par 30 grammes de margarine, dont les Stubendienst ont soin de voler la moitié, soit par une cuillerée de marmelade. Pendant deux années de Lager, nulle variation dans l’ordinaire. Le matin, café; c’est une mixture brune, insipide, presque toujours sans sucre; à midi, la soupe, toujours la même, ou presque: un litre d’eau avec quelques pommes de terre, ou quelques carottes, ou plus souvent du rutabaga, rarement de l’orge mondé, plus rarement encore des petits pois Le soir, le pain et suivant le jour, tantôt le saucisson, la margarine, la marmelade; tantôt un petit bout de fromage écrémé et puant. De temps à autre, le café est remplacé par du lait, du lait ersatz, car il est totalement écrémé et aigri. Au lendemain de la distribution tout le monde a la diarrhée. Le bout de viande auquel nous avons apparemment droit de temps en temps, est volé à la cuisine par les «Proeminenten», les privilégiés, Capos et Blockältester. {Le soir, on distribue aussi le "thé", un litre pour cinq prisonniers; c'est une infusion noire, faite avec des feuilles d'on ne sait quels arbres.} Deux fois par semaine on a droit à un supplément de pain et de saucisson, c’est le «Zulage». Ces quelques articles constituent à eux seuls toute la richesse alimentaire des Lager. Avec le temps, on oublie jusqu’à l’existence d’une multitude d’aliments de la vie libre, de la viande, du poisson, des légumes, des fruits, des pâtisseries et même des simples haricots. De là les cas si fréquents et si rapides d’avitaminose, de scorbut, de misères physiologiques, œdèmes cachétiques se terminant presque toujours par la mort. C’est, on peut le croire, une des formes d’exécution scientifiquement étudiée et systématiquement pratiquée par les commandants des Lager allemands. Du reste, les internés israélites n’ont pas le temps d’aboutir à cette extrême cachexie; car dès qu’ils commencent à flancher ils sont pris dans une «Selection» et envoyés au four crématoire5.
Chapitre X. Les Bucks
Les lits sont appelés ici «Buck». Ce sont de grandes couchettes en planches mobiles, non clouées, à trois étages. Assez souvent les hommes du troisième sont précipités au second et même au premier étage, les planches s’étant déplacées. Dans chaque étage six détenus peuvent coucher serrés les uns contre les autres; mais huit, neuf et même plus y sont entassés, suivant l’effectif du Block. Pas de paillasse, on dort sur le bois. Pour se couvrir, une couverture par personne. Dans les Buck, impossible de se tenir assis, les distances séparant les étages les uns des autres n’étant pas suffisamment grandes. Le repas du soir, on le prend au lit dans la position demi-allongée.
Le matin, à 4h 30, on est réveillé par des clameurs retentissantes, de formidables «aufstehen»… Ces hurlements sont le plus souvent accompagnés, pour les rendre efficaces, de coups de bâton assénés avec vigueur et sans indulgence, de préférence sur la tête. En vitesse il faut sortir dehors, se ranger par cinq devant le Black, à l’Appell-Platz. Si on ne se rend pas assez vite, c’est une grêle de coups de bâton, toujours sur la tête. Puis, une fois les rangs formés, on a tout le loisir d’attendre une heure et davantage. C’est un principe essentiel des Lager et qu’on apprend par l’expérience, l’expérience des coups: au commandement d’Eintreten (alignez-vous) il faut s’exécuter en toute hâte, quitte à attendre ensuite des heures entières.
Chapitre XI. Premiers tourments
Depuis une semaine déjà nous sommes à Birkenau. Moi-même je n’ai travaillé comme ouvrier que les trois premiers jours. Comme médecin, je suis maintenant retenu au Block dans la journée pour les corvées. Aussi j’ai l’occasion de faire des connaissances parmi le personnel du Block.
Durant la nuit, personne n’est autorisé à sortir du Block, sous quelque prétexte que ce soit ; et à l’intérieur du Block il n’y a pas de latrines. On est libre d’aller pisser, chier, jusqu’à l’heure du gong du coucher ; mais, dès que le gong sonne, les portes du Block sont refermées, on ne peut plus pisser que le lendemain.
Au milieu de la nuit je suis réveillé en sursaut par des cris sauvages, désespérés… docteur, docteur, lève-toi, vite, on me tue.. C’est mon beau-frère Salomon, qui couche également dans mon lit laminé contre le mur, qui crie dans le couloir. Je me lève immédiatement et cours dans le couloir ; j’y aperçois le gardien du nuit, le «Nachtwache» Montag giffler, battant impitoyablement mon beau-frère.
— Je t’en supplie Montag, cela suffit, pitié, c’est mon beau-frère…
— Mais, docteur, tu ne sais pas ce qu’il a fait, c’est formidable. J’ai remarqué la nuit dernière que quelqu’un avait pissé, là, contre le mur. Je ne pouvais pas savoir qui c’était. Mais, cette nuit, j’ai surveillé et je l’ai attrapé: c’est lui, il a pissé de nouveau…
Il assène encore quelques gifles. Salomon, tout en encaissant les coups, proteste énergiquement.
— Non, je n’ai pas pissé.
Finalement, j’entraîne Montag au loin et je retourne vers mon beau-frère.
— Salomon, es-tu un gosse pour faire cela? Ne sais tu pas qu’ici on tue pour un rien? Pourquoi as-tu pissé?
— Écoute, me dit-il, non, je n’ai pas pissé… Mais, la nuit dernière, et cette nuit aussi, j’ai eu dans le ventre des coliques insupportables ; alors… et la nuit dernière, et cette nuit j’ai chié contre le mur. C’est un procédé tout de même moins répugnant que de chier dans les gamelles à soupe, comme font tant d’autres.
On voit venir un S.S. ; c’est le Kommando-Führer. Avant même qu’il soit en vue, Capos et Vorarbeiter redoublent de zèle «Arbeiten» schnell, schnell… Les coups tombent plus dru. À leurs coups s’ajoutent tout à l’heure ceux du Kommando-Führer lui-même. Le travail consiste essentiellement en travaux de terrassement. Birkenau est un des Lager dépendant d’Auschwitz, dont il est séparé d’environ 3 kilomètres. À des distances plus ou moins grandes il y a d’autres Lagers: Yawischowitz, Yanina, [Buna,] Yovarzna, etc… Dans certains de ces Lager il y a des mines de charbon; dans d’autres il y a des fabriques. À Birkenau il n’y a rien; et pourtant c’est un des camps les plus importants de toute l’Allemagne dès qu’on l’envisage sous le prisme de la conception nazie du nouvel ordre européen. Il justifie amplement son existence pour le but dans lequel il a été créé: c’est le grand camp d’extermination de l’Allemagne hitlérienne; d’abord et surtout extermination préméditée, calculée, systématique de tous les Juifs et puis, à un degré bien moindre, extermination des Aryens que les nazis considèrent comme leurs ennemis et dont ils veulent se débarrasser en douce, en toute discrétion, loin des villes où des exécutions en masse ne peuvent passer inaperçues et soulèveraient d’horreur les populations. À Birkenau tout ce travail macabre s’exécute en silence: pas un bruit pas un sanglot, pas un soupir, pas une trace de sang. On est garanti du secret absolu. Birkenau est une fabrique monstrueuse imaginée par des cervelles allemandes, qui engloutit des gens vivants et les sort par la cheminée réduits en fumée. Trop souvent hélas, l’infernale usine travaille à plein rendement; probablement 15 000 malheureuses victimes disparaissent tous les jours de la surface de la terre.
Chapitre XII. Les «Lager» de Birkenau
Birkenau lui-même est un groupe de camps séparés les uns des autres et désignés chacun par une lettre de l’alphabet ; Lager A, B, C, D, E, F, G, etc… et deux Lager pour femmes, «Frauen-Lager». La construction d’une infinité d’autres Lager est projetée. {Pour qui donc va-t-on construire tous ces nouveaux Lager? Quelles futures victimes, en transit pour les Crématoria vont-ils provisoirement héberger? Ils ne seront certainement pas construits pour des Juifs; l'extermination des Juifs que Hitler a en son pouvoir avance rapidement et se trouve presque vers la fin; et les installations actuelles de Birkenau se sont avérées suffisantes pour l'assassinat dans le secret et en silence de plusieurs millions d'individus. Et, si l'agrandissement en voie d'exécution du Camp servira, comme tout semble l'indiquer, à l'extermination dans la même proportion que Birkenau actuel, on est pris d'hallucinations rien que de songer aux millions d'êtres humains, cette fois sans doutes Ariens, que les Nazis se proposent de tuer chaque année.} [On en aperçoit pour le moment les clôtures par des colonnes en béton.]
Le Lager A, s’appelle aussi «Quarantaine-Lager», le «B», réservé aux familles juives tchèques, c’est le «Familien-Lager» ou «Tchechischer-Lager», le «E» habité par les Tziganes, c’est le «Zigeuner-Lager», etc… Chaque Lager est entouré par un fossé large et profond, formant une espèce de canal encerclant le camp sur tous les côtés. Derrière le fossé, soutenu par des colonnes en béton, il y a un mur de fils de fer barbelés, de trois mètres de hauteur environ; un courant électrique à haute tension les traverse. Le moindre contact provoque la mort immédiate par électrocution. Chaque 30-40 mètres, tout le long des fils barbelés, il y a des miradors; ce sont des minuscules baraques en planches s’élevant à 4-5 mètres au-dessus du sol; on y accède par une échelle. Dans chaque mirador veille un SS armé d’un fusil et d’une mitrailleuse. Durant la nuit, tout le long des fils barbelés brillent une infinité de lampes électriques et ici là des ampoules électriques rouges. Quand on s’oublie et qu’on rêvasse on se croit dans une foire-exposition. Si l’on coupe un des fils barbelés, la lampe rouge du secteur correspondant s’éteint, c’est le signal d’alarme pour les S.S. des miradors. Ainsi donc les internés sont bien gardés; toute tentative d’évasion à travers les fils de fer, le jour ou la nuit est vouée d’avance à un échec certain. Et [l’idée] {la pensée} ne peut nous quitter qui nous fait demander: «Pourquoi donc toutes ces précautions? Sommes-nous donc tellement dangereux pour les Allemands? Et pourquoi?» Nous l’ignorons. Mais la conviction envahit puis sature tout notre être que nous ne sortirons jamais d’ici; nous sommes des condamnés à mort.
On entre et on sort du Lager par une seule porte. Devant cette porte il y a une baraque abritant les S.S. de contrôle. La nuit la porte est fermée, toute communication entre le Lager et le dehors est interdite. Durant le jour, la porte est ouverte ; mais devant la baraque se tient en permanence un S.S. de service qui note sur le registre les entrées et les sorties du Lager. Ainsi, à tout moment est connu le chiffre exact des détenus qui se trouvent dans le Lager. Quand les Kommandos sortent pour se rendre au travail, ils forment une colonne, par cinq, Capo en tête. Arrivés à quelques mètres de la porte, le Capo commande: «Mützen ab,» puis Halte!» Pendant que tout le Kommando s’arrête figé au garde-à-vous, le Capo fait son rapport à l’S.S. de service: le prisonnier (Haftling) numéro tel (il se désigne lui-même) accompagnant un tel chiffre de prisonniers va se rendre pour tel travail à tel emplacement etc… Des yeux, le S.S. compte les hommes, en inscrit le nombre sur son registre et fait signe qu’on peut passer. Il arrive parfois que le Capo, soit par étourderie, soit par inexpérience, fasse mal son rapport! par exemple, au lieu de dire tant de prisonniers, il dit tant d’hommes. Le S.S. le renvoie brutalement en l’engueulant. Le Capo n’a pas d’autre ressource que de faire rebrousser chemin à son Kommando d’une cinquantaine de pas, de le ramener devant la porte et de refaire son rapport. S’il a le malheur de ne pas rectifier son erreur, cette manouvre de va-et-vient devant la porte du Lager peut se répéter cinq, dix fois et plus: jamais un S.S. ne peut se rabaisser jusqu’à indiquer en quoi le rapport pèche contre le règlement; mais la joie intime et cynique d’un S.S. consiste justement à profiter de toute occasion pour faire souffrir les prisonniers; est-il permis à un S.S de jamais avoir un élan de pitié pour secourir un interné? Qu’il neige ou qu’on ait les pieds, les mains et les oreilles gelés, c’est égal; en passant la porte du Lager, toutes les têtes doivent être découvertes et le rapport doit être fait bien en règle.
Chapitre XIII. Le Travail
Le lendemain de notre arrivée, nous sommes conduits au travail. Notre Kommando travaille dans un Planirium ; il s’agit de niveler la voie principale du camp. Arrivés au chantier, chaque détenu retourne de suite sa veste, le dos de celle-ci recouvre la poitrine et inversement la devanture passe en arrière ; il se boutonne sur le dos. Il saisit alors le bord avant de la veste le remonte vers le haut et forme ainsi, au niveau de l’estomac, une vaste poche qu’il remplit de matériel à transporter: terre, sable, boue, cailloux. Par rangées de cinq les prisonniers font ainsi toute la journée la navette d’un endroit à un autre distants de cinq, six, huit cents mètres. Et toujours schnell, schnell. Le Vorarbeiter ne vous quitte pas d’un pas. Il est fort adroit et pas du tout avare à distribuer des coups. Une seule brouette ferait le travail de dix hommes; mais dans ce camp-ci il n’existe pas de brouettes; ce serait un non-sens. Est-il logique de faciliter le travail des internés quand il s’agit justement de les tuer à la tâche?
Tout à coup, loin de nous, à quelques cinq cents mètres, nous voyons des détenus courir en désordre; ils se dispersent en vitesse dans toutes les directions. Ils courent tous, saisis de terreur. Les uns se cachent derrière les baraques, les autres gisent par terre. Mais que se passe-t-il donc? Nous l’apprenons bientôt. De loin nous apercevons un S.S., il est armé d’un manche de pelle; il tape sur tous ceux qui passent devant lui; sur ceux qui, chargés de terre se dirigent vers le chantier et sur ceux qui rentrent à vide dans la direction inverse. Mon fils et mon neveu sont sur la même rangée que moi. Arrivés à proximité de l’S.S. je leur crie de courir de toute la vitesse de leurs jambes. Le S.S. soulève sa massue et atteint mon neveu; il lui fait une large entaille au crâne. Ce jour-là l’Allemand laisse étendus sur le sol quinze blessés qu’il fallut transporter à l’hôpital.
Chapitre XIV. Les Stérilisés
C’est la nuit, dans la baraque. Je viens d’avaler mon repas et je me prépare à la seule douceur du camp, me mettre au lit. Soudain, un coup de sifflet. Instantanément un silence absolu plane dans l’air. Nous avons déjà appris que seul le chef de Block possède un sifflet et quand le Block-altester ordonne, il sait se faire obéir. Ne tient-il pas à la main une terrible cravache en cuir, le «Dolmetscher», l’interprète, qui sait se faire comprendre dans toutes les langues par des coups violents frappés indistinctement à droite et à gauche? Et puis, nul ne tient à faire connaissance avec la méthode de «25» sur le derrière: on empoigne le malheureux; on l’introduit la tête en avant et jusqu’aux jambes à l’intérieur du poêle en maçonnerie, les jambes pendantes au dehors, et on lui administre rudement 25 coups de fouet sur le derrière. Les hurlements du pauvre misérable s’éteignent à l’intérieur du poêle.
Dans un silence de mort, le Blockältester annonce: «que deux jeunes gens de 16 ans se présentent!» Il inscrit les numéros des deux garçons; puis il demande deux autres de 17, deux de 18 ans, etc… jusqu’à compléter un liste de cinquante sujets. Personne ne sait de quoi il s’agit. Ces cinquante individus forment un Kommando spécial: Le Kommando des 50. Ils reçoivent une corvée relativement plus légère. Puis, un jour, environ deux semaines plus tard, ils sont conduits dans un laboratoire. Là ils subissent un courant électrique sur les parties génitales: ils sont stérilisés. Depuis ce jour, le Kommando des cinquante s’appelle le Kommando des stérilisés. Plus tard, un grand nombre de ces stérilisés sont transférés à Auschwitz. Ils y sont opérés. Au cours d’une première séance on leur enlève un des testicules; et un mois plus tard le second aussi. C’est ainsi que les savants Allemands s’adonnent à des expériences. Parallèlement aux castrations des jeunes gens, ils procèdent à des stérilisations et des castrations des jeunes filles. Alors que dans certains pays, il se trouve des gens qui critiquent la vivisection même des animaux, en Allemagne nazie des expériences monstrueuses sur des hommes sont tout à fait licites. Mais aussi, demain, un Herr [Doktor] {Doctor} Teuton ne viendra-t-il pas se vanter des résultats des expériences tentées sur des personnes des deux sexes, soi-disant condamnées à mort, mais qui en réalité ignorent pour quelle raison elles sont internées dans le Lager?
Chapitre XV. La Musique
Tous les matins, à 6 h. la plupart des Kommando sortent du Lager pour se rendre au travail. Avec l’appel du soir, c’est e moment le plus solennel de la journée. Devant la porte du Lager sont rassemblés une dizaine d’officiers, sous-officiers et simples S.S. ; ils contrôlent la sortie des Kommandos en comptant tous les détenus. Ceux-ci défilent au pas et au son de la musique. Les capos et les S.S. veillent à ce que les internés marchent tous au même pas ; ils hurlent à s’égosiller: links, links {(gauche, gauche)}. Malheur à celui qui se trompe et qui avance du pied droit quand il faut pousser le pied gauche; aussitôt il reçoit une avalanche de coups.
Aussi paradoxal que cela puisse paraître, dans l’enfer de Birkenau il y a une fanfare et c’est une fameuse fanfare. Parmi les exécutants se trouvent plusieurs virtuoses qui faisaient jadis les délices des grandes salles de concert de l’Europe. Tous les matins à la sortie des Kommandos la fanfare exécute des marches pour marquer bien le pas. Les soirs, les Kommandos rentrent également au son de la musique. Quelque temps qu’il fasse, matin et soir, la musique est toujours présente porte du Lager. Le vent, la pluie, la neige, l’orage, rien ne peut constituer une raison valable pour motiver l’absence de la musique. Mais, pour nous autres détenus, rien de plus sinistre et de plus cynique que cette musique. Personne n’ignore qu’au moment même où la fanfare entonne ses marches les plus entraînantes, là-bas, tout près, à quelques centaines de mètres de nous, dans les crématoires dont on aperçoit les hautes cheminées fumantes et dans les fossés creusés à cette intention et dont les flammes immenses s’élèvent distinctement à travers le feuillage de la forêt toute proche, des dizaines de milliers de victimes innocentes sont en train de brûler.
Chacun de nous est d’ailleurs absolument convaincu qu’un jour notre tour viendra de passer par la cheminée. Personne ne nourrit plus aucune illusion, personne ne conserve le moindre espoir de sortir vivant de cet enfer. C’est ainsi qu’Isaac Sion de Salonique, qui [comptait parmi les exécutants] {était parmi les musiciens} de la fanfare pendant les deux trois premiers mois de son arrivée ici, est pris dans une «Sélection» pour troquer son clairon contre la cheminée du crématorium. Un autre jeune homme de Salonique, Stroumza, qui fait lui aussi partie de la fanfare, est envoyé au «S. K.» pour avoir écrit un bout de papier à sa sœur du Lager voisin; la vie au «S. K.» est tellement dure, qu’il y succombe au bout de quelques jours.
Chapitre XVI. Les «S.-K.»
Le «S. K.» c’est le «Straf-Kommando», le Kommando disciplinaire. Les malheureux qui y sont incorporés souffrent tellement qu’ils perdent toute notion de la réalité. En très peu de temps, ils ont l’impression qu’eux seuls sont des prisonniers et s’imaginent que leurs anciens compagnons du Lager sont en liberté. On est envoyé au «S.K.» pour la moindre raison, souvent même sans raison. Cela se passe à l’appel du soir. L’appel terminé le Rapport-Schreiber lit les numéros des détenus qui seront envoyés le même soir au «S. K.». Les victimes sortent des rangs et se présentent devant lui. Chaque patient, à tour de rôle, est étendu sur le ventre et jusqu’à mi-corps sur une table spéciale construite à cet effet, les membres inférieurs pendants et le derrière bien exposé. Tous reçoivent pour commencer 25 coups sur le derrière, puis ils sont conduits au Block du «S. K.». Tous les matins, dès le «Auf-stehn» à 4h30 les condamnés du «S. K.» sont chassés de leur Block à coups de fouet: ils sortent en courant, à poil, pour prendre la douche froide dans la cour. Été comme hiver, quelque froid qu’il fasse, la douche froide dans la cour est obligatoire. Le plus souvent elle est accompagnée de coups de bâton que les Capos du «S.K.», spécialement choisis pour leur férocité, s’amusent à distribuer aux internés.
Au «S.K.» on a une heure de travail supplémentaire par jour. Il est défendu de sortir du Block; ainsi à cet effet, et pour pouvoir les distinguer à distance, tous les détenus du «S.K.» portent l’habit rayé, avec sur la poitrine et sur le dos, un grand cercle d’étoffe rouge. Certains détenus envoyés au «S.K.» en sont parfois sortis vivants. Mais ce sont là de bien rares exceptions. En règle générale, une foi entré au «S.K.» on y meurt, des coups et du froid.
Chapitre XVII. Les Capos
Les Capos sont la terreur des internés, et non sans raison. Il y en a qui sont d’une cruauté féroce.
Son travail terminé, une demi-heure avant l’Appel du soir, mon cousin Marco Décalo, accablé de fatigue, roule une cigarette dans un bout de papier d’un sac de ciment. En guise de tabac il manipule les débris de feuilles de thé desséchées, du thé-ersatz qu’on nous distribue parfois à la place du café. Qu’importe, on a l’illusion de fumer. Le Capo Alfred survient. Nous l’appelons ici «Pharaon» par allusion au roi d’Égypte qui persécutait les Juifs au temps de Moïse. Il voit fumer Marco Décalo; aussitôt il l’interpelle:
— Komm, komm, tu fumes à l’Appel, hein? Et tiens! une gifle d’un côté, tiens une autre de l’autre côté. Le malheureux est pris de vertiges, il roule à terre; le Capo lui ordonne de se relever. Nouvelles gifles qui renvoient le misérable dans la poussière. Il l’oblige à se remettre debout et de nouveau il l’envoie rouler au le sol. Cette sinistre manœuvre se répète une dizaine de fois.
Tout à côté, il y a un canal, profond de trois mètres et large de quatre. Dans le fond dort un demi mètre d’eau vaseuse et pestilentielle. Une planche étroite unit les deux bords du canal. Marco Décalo ne peut plus se tenir debout, tellement il est étourdi par les coups, mais le Capo n’a pas encore assouvi toute sa rage. Il le fait placer au milieu de la planche et d’un violent coup sur la tête, le balance dans l’eau puante. Le malheureux se débat dans la boue en poussant des gémissements atroces. Il implore du secours ; il ne peut remonter les bords à pic du canal, il glisse à chaque tentative. On lui lance une corde et on le retire trempé et ruisselant d’eau vaseuse. Il se met à genoux devant «Pharaon», implorant pitié. Mais le Capo n’a pas fini avec lui; il redouble les coups, jusqu’à le laisser étendu sur le sol, à moitié mort…
{Chapitre XVIII. Marché noir à Birkenau
La grande masse des internés de Birkenau, ceux qui travaillent dans les Kommandos come simples ouvriers, n'ont ni le te temps ni les moyens de songer à améliorer la ration en s'adonnant au Marché noir. Ceux-là ne sont dans le Lager que pour travailler, recevoir des coups, souffrir tous les jours mille tortures, et finalement pour mourir.
Le Marché noir est le privilège de ceux qui constituent la haute sphère des internés, de ceux qu'on appelle ici des "Proeminenten", principalement des Capos et des Blockältester. On les reconnaît d'ailleurs à leur uniforme rayé, qui ne sont pas tout simplement en toile mince de coton, mais le plus souvent en tselwohl. Un autre signe de grande élégance des dandys du Lager, c'est qu'ils ont presque tous la tête rasée toujours de frais: ils ont soin de se raser la tête au moins deux fois par semaine, et la tête doit briller comme des billes de billard. Mais qui donc a introduit dans l'aristocratie du camp la mode des têtes rasées? Est-ce peut-être l'envie vaine mais irrésistible d'imiter les généraux allemands dont on voyait dans les journaux des photos avec des têtes rasées lorsqu'on était libres?
Pour débuter dans le Marché noir, il faut avoir la monnaie d'échange, c'est-à-dire des pièces d'or, des diamants, des brillants. Pour les Capos et les Blockältester, il n'est pas toujours très difficile de se les procurer; toute la difficulté réside dans l'art de les cacher, pour ne s'en servir qu'au fur et à mesure qu'on en aura besoin, et en attendant qu'une nouvelle occasion se présente pour refaire la provision de pièces d'or.
Certains des "Proeminenten" qui possèdent une petite ou même une grande fortune la cachent en l'enfouissant dans le sol, hors du Block, dans un endroit connu d'eux seuls, et où ils se rendent en secret la nuit pour retirer ou pour ajouter des pièces nouvelles, mais ce procédé est rare. Le plus souvent, les Capos ont recours à un système plus pratique; sans avoir à courir eux-mêmes aucun danger, si ce n'est que celui de perdre tout le trésor: ils confient leur fortune à de simples ouvriers de leurs Kommandos qui les cachent sur eux aussi bien qu'ils le peuvent. Et lorsque, comme il arrive de temps en temps, les S.S. qui font la garde à la porte du Lager, font une perquisition corporelle de tous ceux qui rentrent ou qui sortent dans le Lager pour rechercher de la monnaie ou des victuailles que les internés essaient de passer en contrebande, ce qui naturellement est très sévèrement défendu, lorsqu'il arrive qu'un S.S. mette la main sur un malheureux transportant sur lui soit de l'argent, soit des vivres, l'argent, les vivres sont confisqués; l'interné coupable est gratifié sur le champ d'innombrables gifles et coups de pied; et le soir, après l'Appel, il sera couché sur la table spéciale pour recevoir 25, 50, ou 100, sur le derrière avec le tube en caoutchouc, et de là, il sera envoyé à l'S.K. Il arrive parfois, lorsque l'interné est pris avec une somme importante, que le S.S. l'abatte d'un coup de revolver sans autre forme de procès. Ainsi le "Proeminentsia" à qui appartiennent la monnaie et les victuailles saisis ne risque personnellement rien. Ce système de contrebande est très couramment employé à Birkenau, et tous les internés s'y sont tellement habitués, que personne n'y voit rien d'immoral. Et les Capos qui ont perdu avec leur fortune leur homme de confiance, soit que ce dernier ait été tué, soit qu'il ait été envoyé à l'S.K. se remettent à l'oeuvre pour refaire un nouveau trésor et se choisir un nouvel homme-coffre-fort. Du reste, toutes les pièces d'or, tous les diamants, et tous les brillants, tous les trésors de Birkenau qui alimentent le Marché noir ne visent qu'un seul objectif: celui de se procurer des vivres pour améliorer la ration ordinaire. Et presque jamais le Capo qui fait usage d'un ouvrier qui lui cache son trésor et lui passe les victuailles par la porte du Lager, presque jamais le Capo n'offre à son homme de confiance la moindre parcelle de vivres qu'il lui a introduit en contrebande à l'intérieur du Lager au risque de sa vie. Mais les simples internés, ne sont-ils pas des esclaves, non seulement des S.S. mais également des Capos?
Je suis maintenant Pflefer (infirmier) dans le Block 27 du Lager D. de Birkenau. La très grande majorité des internés de ce Block sont des Israélites grecs de Jannina, de Corfou, et d'Athènes arrêtés par les Allemands durant l'été de 1944, après la liquidation italienne, et arrivés ici tout récemment. Parmi le personnel subalterne du Block, avec moi, il y a entre autres le Stubedienst Isidore Sadicario de Salonique et le Nachtwache Bernard Tzifer d'Athènes. Je n'ai qu'à me louer de mes deux compagnons. Isidore, quoique d'une stature athlétique a un coeur tendre comme celui d'un enfant; je ne l'ai jamais vu battre un interné. Quant à Tzifer, on ne peut pas dire qu'il est un homme ordinaire: dans cet enfer où tous les caractères, ou presque, sont rapidement plus ou moins corrompus, il conserve intacte, sans effort apparent et tout naturellement, toute sa personnalité. De toute sa personne émane un charme spécial, et dès qu'on a fait sa connaissance, on lui accorde d'emblée toute son amitié et toute sa confiance. Avec cela, il est d'une intelligence remarquable et possède à perfection plusieurs langues: allemand, français, grec, etc. Il a la sympathie de tout le Block, du Blockältester, du Schreiber, des Capos, et jusqu'à celle du dernier des ouvriers. Nous sommes attachés d'une amitié réciproque; nous couchons dans le même Bucks et côte-à-côte, avec la différence que lui, par sa fonction de Nachtwache (veilleur de nuit) il veille la nuit et dort le jour. Tous les jours à midi, on le réveille à la distribution de la soupe.
Juste dans le Bucks d'à côté, dont nous ne sommes séparés que par un très étroit couloir, tout en haut, dans le troisième étage, demeurent quelques Russes, dont un Capo.
Aujourd'hui, Tzifer ayant avalé sa soupe, au lieu de se recoucher me dit:
— Docteur, je vais m'absenter quelques minutes; j'irai prendre mes chaussures que je fais réparer dans un autre Block; mais il faut que sous aucun prétexte tu ne t'éloignes pas un seul instant de notre Bucks, et je reviens tout de suite. Alors seulement, ne pouvant pas faire autrement pour mieux me mettre sur le qui-vive, il me confie son grand secret qu'il tient caché jusqu'à présent même de moi qui en qui il a le plus confiance: chaque matin, au départ des Kommandos, le Capo russe du Bucks voisin lui confie en garde une boîte de tablettes de chocolats, la lui reprend le soir, et la lui confie de nouveau le matin suivant. Aujourd'hui, la boîte contient vingt-cinq tablettes. Dans le Lager cela renferme toute une fortune; c'est l'équivalent de plusieurs kilos de pièces d'or. Avec une seule tablette de chocolat, on peut se procurer tout à la fois des cigarettes, du saucisson, des pommes de terre, de la margarine, etc.
Tzifer s'en va; et je m'installe dans le couloir entre les deux Bucks, bien déterminé à y rester jusqu'au retour de Tzifer. Mais, j'ai compté dans le Schreiber (secrétaire du Block).
Le Schreiber est un Polonais, et dans son bureau qui est en même temps sa chambre à coucher, il est toujours entouré d'une cours de trois-quatre autres Polonais fainéants, embusqués, qui sont ses protégés; il y en a un qui boite et qui est connu par son sobriquet "le Boiteux".
J'ignore comment cela est arrivé, mais le fait est que le Schreiber et sa clique de fainéants, a découvert le grand secret du Capo russe et de Tzifer. Dans le bureau du Schreiber la clique tient des conciliabules dans le plus grand mystère et dresse des plans pour voler le trésor confié à la garde de Tzifer. Et voilà que l'occasion idéale se présente, inespérée: Tzifer est absent du Block! Quant à moi, rien de plus facile au Schreiber de me faire abandonner mon poste. Aussi, prend-il un air sévère, et sous prétexte d'aller examiner ensemble un baril de chlorure de chaux, soi-disant détérioré, il me commande de le suivre à l'extrémité opposée du Block. Je ne puis faire autrement, le Schreiber est mon supérieur et je dois obéir. Mais il ne me reste aucun doute qu'il se trame une affaire grave; et au fur et à mesure que j'avance vers la sortie du Block, je retourne de temps en temps la tête pour surveiller mon Bucks. A un de ces moments, j'aperçois le Boiteux qui sort de l'étroit couloir entre nos deux Bucks, et tout pressé, il disparait dans la chambre du Schreiber. Peu après, le Schreiber jugeant que l'expédition a réussi me laisse libre. Il rentre dans sa chambre et je retourne moi-même à mon poste près du Bucks, tout bouleversé et ayant la certitude que le vol a été accompli; mais je n'ai ni le courage, ni la volonté de contrôler la boîte aux chocolats. Sous peu Tzifer rentre; sans rien me dire, il va tout droit contrôler les chocolats. Bon Dieu de bon Dieu! Au lieu de vingt-cinq, il n'y en a plus qu'une seule, que dans sa hâte le Boiteux a omis d'emporter aussi. Suffoquant de désespoir, Tzifer me demande si je me suis éloigné du Bucks. Je lui raconte ma mésaventure, et j'ajoute que je suis persuadé que c'est le Boiteux qui a volé les chocolats, de connivence avec le Schreiber. De ses poings, Tzifer se frappe la tête, il éclate en sanglots; je pleure avec lui. Quel compte va-t-on rendre au Capo russe? Mettant toute mon espérance dans l'estime que le Schreiber a pour Tzifer, je conseille ce dernier d'aller trouver le Schreiber, de lui faire comprendre que le Capo voyant la perte de son trésor, ne voudra rien savoir et qu'il est capable de le tuer; de l'implorer, de l'émouvoir, de le conjurer d'avoir pitié de lui et de lui rendre les chocolats. Tzifer se rend chez le Schreiber; mais, hélas! tout a été vain. Naturellement, car, si le Schreiber et sa clique ont volé les chocolats, ce n'est certes pas pour les rendre. Tzifer rentre du bureau du Schreiber et nos lamentations recommencent. Tzifer me dit entre les larmes qu'il ne voit plus maintenant qu'une seule solution à la situation: pour échapper à la fureur du Capo qui va rentrer bientôt avec les Kommandos, il va se jeter sur les barbelés électrisés.
Mais voilà qu'Isidore qui était pendant tout ce temps absent du Block, qui rentre. Il s'inquiète de notre agitation et nous lui expliquons ce qui nous est arrivé. Sans rien nous dire, il met immédiatement en action son plan d'opérations pour découvrir le voleur et lui reprendre les chocolats. Il suit, sans en avoir l'apparence, tous les mouvements, toutes les allées et venues de la clique du Schreiber. Comme dans un éclair, il a vu qu'il n'est pas possible au Schreiber de cacher plus longtemps dans sa chambre les chocolats volés, car, dans très peu de temps les Kommandos vont rentrer, et le Capo en apprenant que c'est le Schreiber qui a fait le coup, fera irruption dans sa chambre comme une bête sauvage enragée, perquisitionnera partout, et quand il va découvrir les chocolats, ce sera la fin du Schreiber et de toute sa clique. Isidore se poste dehors du Block, sur la route, et attend avec patience. A un moment donné, le Boiteux sort du Block, il a une couverture pliée sous le bras. Isidore a la conviction la plus absolue que dans la couverture sont cachés els chocolats et que le Boiteux les transporte dans un lieu sûr, dans un autre Block; Isidore le laisse s'éloigner de notre Block, puis il presse le pas et le rattrape; et sans autre préambule, il lui ordonne de lui remettre les chocolats qu'il cache dans la couverture. Le Boiteux proteste, il prétend ne rien savoir des chocolats; que dans la couverture il n'y a que des chemises sales, etc. Mais Isidore ne lui laisse plus le temps de continuer, et d'un brusque mouvement il s'empare de la couverture. Il l'ouvre: les chocolats sont là. En courant, il vient nous rejoindre, et étalant la couverture devant nous, il nous rend les chocolats. Il nous a sauvés et pleins de reconnaissance nous ne savons que le presser contre nous et le couvrir de baisers. Nous comptons les chocolats, il n'y en a que vingt-trois, la bande du Schreiber en a mangé une.
Bientôt le Capo rentre. Tzifer est obligé de lui expliquer le dramatique épisode, car, dans la boîte il n'y a plus que vingt-quatre chocolats au lieu de vingt-cinq. Le Capo estime que l'affaire s'est tout de même terminée heureusement, grâce à Isidore. Et, magnanime, le Capo fait don à Isidore de tout un chocolat; ce dernier le coupe en petits morceaux et le distribue parmi nous. Est-il besoin de jurer que c'est la seule fois que j'ai mangé un bout de chocolat dans le Lager?
Au Block 27 je retrouve une ancienne connaissance: Montag, l'ex gardien-de-nuit qui avait battu si sauvagement mon beau-frère Salomon. Il a été promu Ober-Stubediesnt, ce qui correspond au grade de second du Chef-de-Block. Je gagne tout de suite son amitié et sa confiance. Il m'en récompense en me faisant son homme coffre-fort: tous les matins il me confie un mouchoir plein de pièces de monnaie en or et de diamants qu'il ne reprend que les soirs. Et si durant la journée, un S.S. survient qui a l'envie de faire des fouilles, il n'aura que moi seul à abattre. Hélas! l'amitié de Montag pour moi s'arrête là; il n'est jamais question qu'il m'offre un bout de pain ou une pomme de terre qu'il se procure avec les pièces d'or que je lui garde.
Chapitre XIX. A la recherche d'un "Bon Kommando"
Dans le Camp, chaque groupe d'internés travaillant dans un même équipe forme un "Kommando, avec pour chef un Capo.
Il y a un "Kommando Canada". C'est celui qui est toujours présent à l'arrivée des Transports. Il s'empare des bagages des nouveaux venus, pour les remettre aux S.S.; c'est le Kommando qui a les plus fréquentes occasions "d'organiser", et par conséquent le plus riche; de là son nom de "Kommando Canada". Il y a un "Aufname Kommando"; c'est celui chargé d'enregistrer les arrivants admis dans le Camp et de leur marquer par tatouage le numéro d'ordre sur l'avant-bras gauche. Il y a un "Sonder Kommando"; c'est celui travaillant dans les Crématoria. Il y a un "Planirium Kommando", etc, etc.
Il y a même à Birkenau un "SCHAISE KOMMANDO". C'est celui chargé de vidanger les fosses d'aisance. Mais, ce Kommando est un privilège réservé exclusivement aux jeunes filles. Et lorsqu'il arrive que nous voyons sur la route, au delà des fils barbelés, le groupe de jeunes filles attelées à la voiture pleine de matières qu'on doit verser quelque part plus loin du Camp, quelques incorrigibles taquins, prenant une attitude officielle et saluant à la militaire, s'écrient: Attention! c'est le Schaise Kommando qui passe. Et malgré toute l'horreur de la situation, les jeunes filles ne peuvent pas se retenir de sourire; et même la femme S.S. qui avec son chien convoie le Schaise Kommando, fait un visible effort pour se contenir et garder un air sérieux.
A tant de tourments, s'ajoute bien souvent le souci de tomber sur un "Bon Kommando". En général, le travail dans un ou dans un autre Kommando n'offre pas de bien grandes différences; dans tous les Kommandos le travail est inhumain, abrutissant; dans tous les Kommandos il tombe des coups; et partout le travail se fait sans la moindre consolation dans l'espoir qu'un jour cela pourra prendre fin, sinon que par la mort.
Cependant, il y a tout de même des préférences possible entre Kommando et Kommando; et ce qui fait toute la valeur d'un "Bon Kommando" c'est quand il tombe le moins de coups. Aussi, le soir, quand on l'occasion de se rencontrer entre connaissances, la conversation la plus intéressante est-elle de se renseigner sur le Kommando de chacun.
— Chez toi, tombe-t-il beaucoup de coups? Et chez toi, le Vorarbeiter tape-t-il dur?
Dans le camp de Stuthof, un ami Salonicien travaille dans un "Bon Kommando": l'Electrischer Kommando. Désirant me faire profiter moi-même de travailler dans ce Bon Kommando, mon ami me conseille de me rendre de très bonne heure le lendemain matin à l'angle du Block X. C'est là que se rassemble chaque matin l'Electrischer Kommando pour son départ au travail. Et mon ami me Salonicien me recommande surtout d'avoir beaucoup de courage et de ne pas prêter trop d'attention aux coups de pieds que les autres camarades flanquent à droite et à gauche, pour faire sortir les nouveaux des rangs, afin que chacun puisse s'assurer de se maintenir dans le Kommando; la réputation de l'Electrischer comme un "Bon Kommando" s'est déjà répandue parmi un grand nombre d'internés; et un nombre toujours plus considérables d'esclaves se présentent pour y travailler. "Le travail, me dit mon ami Salonicien, est très facile; il consiste tout simplement à faire le tour du Camp durant toute la journée, le long des fils barbelés, d'en surveiller le bon état, et de faire des réparations, s'il y a lieu. Et, c'est là tout l'avantage, il y tombe très peu de coups".
Le lendemain, ayant encaissé avec beaucoup de stoïsme bon nombre de coups de pieds dans les jambes, je réussis à me maintenir dans les rangs auprès de mon ami, et l'Electrischer Kommando prend le départ pour le travail. Nous sommes vers la mi-novembre 1944, et une légère couche de neige couvre le sol. Nous marchons dans une forêt, à l'intérieur du Camp; et après une marche de peut-être un kilomètre, le Kommando s'arrête. Sur le sol, et recouverts par la neige, gisent de formidables troncs d'arbres abattus. Le Kommando est divisé par groupes de huit internés, et chaque groupe doit charger sur les épaules et transporter un immense tronc d'arbre. D'ordre du Vorarbeiter les 8 du groupe s'alignent par ordre de taille, le plus grand est placé le premier, du côté du tronc qui correspond à la racine qui est le plus épais et le plus lourd; et le plus petit du groupe est placé le dernier et saisit le tronc du côté correspondant aux branches et moins lourd. Chaque tronc d'arbre est d'un poids considérable, et tout humide qu'il est il est si lourd que nous avons toutes les peines du monde pour le soulever et le placer sur nos épaules. Nous partons; nous marchons avec précaution et tout doucement. L'écorce rugueuse et le poids formidable nous écrasent l'épaule; nous ne portons d'ailleurs uniquement qu'une chemise et qu'une veste en toile. Quand je fléchis très légèrement pour soulager un peu mon épaule et reprendre haleine, le Vorarbeiter tape immédiatement dans les jambes, pour me faire redresser tout droit. Nous transportons ainsi le tronc à une distance de cinq-cents mètres; à la fin, nous avons la sensation que les os de l'épaule sont comme fracturés. Ce jour-là, pour mon malheur, le travail à l'Electrischer n'a pas consisté simplement en une interminable promenade le long des barbelés, mais il a fallu transporter d'immenses troncs d'arbres; et je renonce à ce Kommando.
Le lendemain, dans un nouveau Kommando, on part pour les bords de la Vistule, à deux kilomètres du Camp. Une péniche sur laquelle je lis "Danzig" s'avance dans le fleuve; nous ne sommes donc pas très loin de ce port, et j'imagine que je me trouve en ce moment dans le fameux Corridore qui a été à l'origine de toutes nos calamités. A une très petite distance de la rive gauche du fleuve se dresse une fabrique de briques; et notre Kommando travaille pour le compte de la fabrique. Le long du petit quai sont rangées trois grandes mahones plein de sables, que le Kommando doit vider avec des pelles. Déjà quelques internés sont descendus dans la première mahone et de grandes pelletées de sable sont versées sur le quai. Un autre groupe repousse le sable plus loin, et d'autres encore plus loin, de façon à éviter l'amoncellement de sable au même endroit et pour maintenir tout le temps le quai en état de recevoir de nouvelles quantités de sable. Avec beaucoup d'autres camarades, je travaille à la pelle au premier groupe sur le quai. Tous les internés travaillant avec zèle, car, de toute façon, il s'agit de vider la mahone. De l'autre côté du fleuve, à plus de deux-cent mètres de nous, un S.S. avec son chien policier, fait le guet. Il n'est pas là pour se mêler directement de notre travail, il est là pour nous surveiller et prévenir toute tentative d'évasion. Après de longues heures de travail consciencieux et harassant, à un moment donné survient le Kommando-Führer. A son approche, et tout exténués qu'on est, les coups de pelles redoublent de vitesse. Mais le S.S. qui fait la garde de l'autre côté du fleuve, et quoique de toute évidence ne puisse pas bien distinguer d'une telle distance ce qui se passe chez nous, par de longs cris, appelle le Kommando-Führer. Et, histoire de s'amuser, lui désigne un interné, qui, prétend-il, ne travaille pas bien. Aussitôt l'interné est gratifié de vingt coups sur le derrière avec le tube de caoutchouc. La plaisanterie ayant si bien réussi, le garde S.S. désigne ensuite un autre interné, puis moi-même, et d'autres et d'autres encore. Nous recevons tous vingt coups sur le derrière. Ainsi nous sommes assurés que pendant au moins vingt jours, nous aurons les derrières tout noirs d'échymoses.}
Chapitre XVIII {XX}. Passe-temps nazi
Je travaille aujourd’hui dans un Kommando sur la voie ferrée. Nous sommes dans le camp de Stuthof près de Dantzig. Il s’agit de pousser tantôt dans un sens, tantôt dans un autre sens, des wagons chargés de pommes de terre, de carottes, de vielle ferraille, etc… Des deux côtés de la rame de wagons, de nombreux S.S. nous convoient. Ils sont armés de gros bâtons. Ils les utilisent fréquemment sur nos échines, avec beaucoup d’adresse tout en hurlant sans arrêt «schieben, schieben» (poussez, poussez). Tout le long de la ligne de chemin de fer, à très peu de distance, un mur de fils de fer barbelés non électrisés; de l’autre côté de cette clôture des postes avec des chiens policiers. À un moment donné, un des postes interpelle un des détenus, n’importe lequel, il n’a pas de choix; c’est celui que le hasard a mis à ce moment le plus près de lui. Ce pouvait être moi, mais ce fut un autre pauvre diable:
— Komm, Komm, Komm.
Le détenu quitte le wagon et s’approche du poste. À ce moment, un S.S. qui surveille notre travail et qui nous accompagne dans la manœuvre de va-et-vient des wagons, s’approche aussi du poste. Ils sont maintenant là tous les trois: de l’autre côté du barbelé, le poste avec le chien, de ce côté-ci, l’interné et un S.S. Le poste ordonne au détenu de se courber et de passer la tête entre les fils de fer, en même temps il lâche son chien pour qu’il le morde au visage. Le détenu instinctivement {Instinctivement le détenu} se redresse et fait un mouvement de recul. Le S.S. lui donne des coups de pied, le saisit à la nuque et l’oblige à se courber de nouveau Le poste relâche le chien à l’assaut; cette fois-ci il réussit à lui emporter un lambeau du visage. Les deux S.S. sont contents de leurs exploits; ils rient aux éclats, tandis que le pauvre diable hurle de douleur et d’épouvante. Comment veut-on que des S.S. s’amusent d’une façon plus innocente et plus joyeuse? Durant cette scène, nous, les autres détenus, continuons à pousser les wagons aux cris de «schieben, schieben», tandis qu’une grêle de coups de bâton caresse nos dos.
Tandis que nous travaillons au Planirium, deux S.S. s’approchent ; ils avancent les mines sombres et l’air préoccupé. L’un d’eux a les mains sur le dos: il y tient caché un gros manche de pelle. On pressent qu’un malheur va arriver. Ils interpellent le premier ouvrier qui se trouve devant eux, «Komm, Komm, Komm,… was machst du hier?» Que fais-tu donc ici? On ne peut s’empêcher de se demander: est-ce donc la voix, les timbres naturels que ces hommes avaient dans le civil? S’efforcent-ils put être d’émettre des sons formidables pour rendre leurs voix plus terribles? L’atmosphère vibre avec l’intensité du rugissement d’une bête sauvage. Ces S.S. sont tourmentés par un doute. Ils sentent confusément que dans leurs souffrances quelques Juif s ont trouvé un refuge d’où il est difficile de les déloger. Quoi, est-il permis à un honnête S.S. de tolérer qu’un Juif puisse se consoler des horreurs de ce monde en se blottissant par la pensée dans le repos et la paix du ciel, là où un jour prochain son âme ira planer? De sales Juifs sont si souvent capables de telles spéculations métaphysiques, que tout est possible de leur part. Un S.S. se doit de les poursuivre jusque dans leur dernier retranchement; il faut détruire en eux toute espérance, même celle de l’au-delà…
Aussitôt, un des bourreaux sort son revolver. Il applique le canon froid sur la tempe de la malheureuse victime. L’autre S.S., celui qui tient caché le manche de pelle s’est placé derrière le Juif, et sans que ce dernier s’en aperçoive, il soulève sa massue et lui assène un coup formidable sur la tête. La victime est par terre. À coup de botte, ils l’obligent à se remettre debout. Le pauvre diable est encore pris de vertige, sa tête tourne, ses oreilles bourdonnent, il ouvre de grands yeux étonnés, ayant perdu notion de toute chose. Les S.S. sont satisfaits, leurs consciences de S.S. sont tranquilles, ils estiment que leur coup a réussi. Ils demandent au Juif:
— Eh bien, tu as été faire un petit tour dans l’autre monde, qu’est-ce que tu as vu? Y a-t-il des Allemands! Oui, il y en a sûrement.
Et, du moment que ce sont eux qui l’affirment, pour eux, c’est suffisant. Ils sont certains qu’ils ont ainsi pu convaincre un Juif que dans l’autre monde aussi il y a des Allemands ; des Allemands qui naturellement terrorisent et martyrisent les Juifs de l’au-delà exactement comme ceux de ce monde ci terrorisent et martyrisent les Juifs d’ici-bas. De cette façon, il est exclu que le Juif qui souffre ici puisse se consoler par anticipation en pensant que dans l’autre monde il jouira d’une vie meilleure.
Chapitre XIX {XXI}. L’Appel
Tous les soirs à la rentrée des Kommandos, c’est l’Appel. Pour un S.S. l’Appel c’est ce qu’il y a de plus important, de plus cérémonial dans le camp. Nous sommes placés devant le Block, en plein air. Le chef de Black commande: «Mützen ab!» (tant que dure l’Appel, on doit avoir la tête découvert). Un S.S., le Block-Führer, passe devant chaque Block et compte les détenus. Les divers Block-Führer font leur rapport au Rapport-Führer, lequel à son tour rend compte au Lager-Führer (commandant du camp) du nombre total des internés du camp. S’il vient à manquer un ou plusieurs détenus, on recommence l’Appel, on sonne l’alarme d’évasion, la sirène siffle, tous les Capos font «eintreten» et sortent à la recherche des manquants. Tant que l’Appel ne donne pas le chiffre exact des internés ou tant que les évadés éventuels ne sont pas retrouvés, on reste alignés devant les Block. Fréquemment, après une journée harassante de travail, plus morts que vifs, pouvant à peine nous tenir sur les jambes, il nous arrive de rester debout, par la pluie, la neige, la tête découverte, durant deux à trois heures. Cela se répète souvent, deux, trois et quatre fois par semaine. On m’a rapporté des cas authentiques d’Appel ayant commencé le soir pour ne finir que le lendemain dans la journée; toute la nuit, les internés étaient retenus debout dans la cour, à l’Appell-Platz du Block, grelottant de froid, tenaillés par la faim, défaillant de fatigue. Dans ces conditions la loque humaine n’a plus qu’un seul désir: de toute la puissance des dernières forces qu’il lui reste, elle souhaite mourir pour en finir avec cette vie misérable.
Chapitre XX {XXII}. Le Zigeuner-Lager
Entre le Lager D ou Arbeiter-Lager (camp des travailleurs) et le Lager F ou Krankenbau (Hôpital), il y a le Lager E habité par les Tziganes, le «Zigeuner-Lager». Pour nous qui avons le cœur déchiré par la douleur de l’assassinat de nos familles et de nos êtres les plus chers, les Tziganes sont le prototype des gens heureux de ce monde. Leurs conditions générales de vie sont à peu près les mêmes que dans notre camp: suppression de toute liberté, défense de toute lecture, régime alimentaire presque identique. Mais par contre un grand et immense avantage: les Tziganes vivent en famille.
A travers les fils de fer barbelés, nous les voyons évoluer hommes et femmes ensemble ; des enfants de tous les âges courent et jouent à cache-cache ; on leur a même construit un manège avec chevaux de bois et voitures ; une institutrice leur enseigne parfois le chant. Nous ne pouvons pas nous empêcher de jeter dans le Zigeuner-Lager des regards curieux, en nous disant: que ces gens sont heureux! Si nous pouvions être comme eux avec nos femmes et nos enfants; eux du moins, comme tout semble l’indiquer, vivront ainsi jusqu’à la fin de la guerre.
Durant quelques mois la vie dans le Zigeuner-Lager s’écoule sans incident notable. Un jour, sans que rien le fasse prévoir, nous apprenons qu’on y a fait un «Transport». Les jeunes gens robustes ont été sélectionnés et envoyés personne ne sait où, dans un autre Lager. Quelques jours plus tard, au cours de la nuit, nous entendons des vrombissements d’autos, des clameurs déchirantes de femmes et d’enfants. Le lendemain matin, aucun bruit n’arrive plus du Zigeuner-Lager; un silence de mort y règne. Nous nous rendons facilement compte qu’il a été vidé. Des prisonniers non-tziganes nettoient les baraques et évacuent les vêtements, les couvertures et les matelas des Tziganes: durant la nuit, tous les tziganes ont été jetés au four. Où sont-ils les gosses bruyants et insouciants qui hier encore, comme les enfants de tous les pays du monde, se pourchassaient gaiement et faisaient des grands cercles montés sur les chevaux de bois tout en se chamaillant? Réduits en fumée. Et pourquoi donc les Allemands les ont-ils gardés des mois durant, dans des conditions de vie presque supportables, avec toute l’apparence de vouloir les conserver ainsi jusqu’à la fin de la guerre, et puis tout à coup les ont-ils envoyés au Créma? Mystère!… Mais est-il possible qu’un esprit non germanique soit assez aigu pour pénétrer toute la profondeur de la philosophie teutone?
Chapitre XXI {XXIII}. Le Sport
Le Lager a aussi ses embusqués. Tous les matins, il se fait une véritable chasse à l’homme, cruelle, impitoyable, sauvage. Les chefs de Block, par des coups de fouet rudement administrés ; font sortir les gens hors de leurs baraques respectives, et des Capos armés de gros bâtons les chassent devant eux, d’une extrémité à l’autre du camp, les refoulant, les balayant vers la porte e sotie du Lager où se rassemblent tous les Kommandos se rendant au travail, tous ceux qui ne peuvent pas justifier leur présence dans leur camp. Il y a tout de même tous les jours des types qui parviennent à rester dans le Lager, pour ne pas avoir à travailler toute la journée. Mais gare au contrôle! Car de temps en temps ce sont des S.S. qui font personnellement le contrôle des embusqués. Tous ceux qui se font prendre, font d’abord une heure de «Sport», puis ils sont envoyés au travail.
Le terme «Sport» suscite dans l’imagination de tous des tableaux gais et plaisants. Quand je dis «Sport», je vois des jeunes gens courant dans un pré et jouant au football, ou bien ce sont des jeunes filles s’amusant au tennis; ce sont des cavaliers s’adonnant à l’équitation; d’autres font une course en vélo d’autres encore savourent le plaisir du canotage et de la natation. Mais les Allemands qui renversent toutes les choses ont donné au mot «sport» une signification toute différente; c’est une de leurs plus cruelles punitions.
Je les vois encore assemblés après un contrôle. Ils sont une trentaine de détenus. Rangés par cinq, (toujours «zu fünf») ils obéissent au commandement du S.S. qui leur fait faire du «Sport».
— «Courez!» (ils courent quelques pas){, et immédiatement après,}.
— «Étendez-vous!» (ils roulent dans la poussière et la boue). Puis [immédiatement encore] {alternativement et très vite}, «Courez… étendez-vous… courez… étendez-vous…»
En vitesse ils courent et ils roulent sur le sol. Cela dure dix minutes, un quart d’heure ; cela suffit pour esquinter déjà les plus robustes. Puis, «mettez-vous sur la pointe des pieds, position demi-assise, sautez… avancez… sautez haut… avancez!» Au bout de quelques minutes le supplicié se sent à tel point extenué qu’il est absolument incapable d’exécuter à temps les commandements du S.S. Alors pleuvent sur lui les coups de fouet, il a bientôt tout le corps couvert de larges barres violettes; le sang gicle de son visage. Un pauvre prisonnier russe, tout gros et tout rond n’en peut plus; il est constamment au dernier rang; il souffle, il râle; c’est sur lui que s’abattent de préférence les coups de cravache, car au Lager il n’existe pas de pitié; les faibles doivent mourir. Mourir par les gaz, ou mourir par les coups.
A un moment donné et tandis que le «sport» continue, survient le Lager-Führer, le lieutenant Ober-Schwartz. Il a la réputation d’être un bon Lager-Führer. Le S.S. lui explique la raison pour laquelle il fait faire du «sport». Le jeune Russe halète, il semble sur le point de rendre l’âme. Un instant, j’ai le sentiment qu’Ober-Schwartz, ému va ordonner de l’exclure du «sport». Il fait en effet quelques gestes en désignant le Russe; mais, combien suis-je dans l’erreur; combien, après 16 mois de Lager suis-je encore ignorant de la mentalité et de la sensibilité allemandes. Le bon Lager-Führer constate simplement que le Russe n’exécute pas assez rapidement les divers mouvements du «sport» et qu’il convient de le stimuler par des coups de fouet supplémentaires. Le S.S. ne se le fait pas répéter; les coups s’abattent à un rythme accéléré. Le petit Russe reste finalement étendu sur le terrain plus mort que vif.
Un «sport» de ce genre quand on le pratique une fois, laisse des traces des semaines durant par les ecchymoses et les cuissons des coups, par les douleurs musculaires dues aux tiraillements des mouvements violents.
Chapitre XXII {XXIV}. Le «Zaehne-Konrolle» à Echterdingen
Je suis envoyé dans un transport de six cents individus à Echterdingen. Nous sommes internés à l’aérodrome de Stuttgart. Ici ce n’est pas un Lager systématique comme ailleurs. Un hangar d’avions, isolé du reste de l’aérodrome par des barbelés non-électrisés, nous sert de baraque. Aux quatre angles du champ formés par les barbelés, il y a quatre miradors avec des postes. Quelques rangées de lits à trois étages contre les quatre parois du hangar laissent au centre un espace libre tellement vaste, qu’on a l’impression que la baraque est vide, même lorsque les six cents internés se trouvent à l’intérieur et occupent les lits. Il n’y a pas de plafond, la toiture du hangar forme jusqu’au-delà du centre une voûte très élevée. Nous sommes en décembre 1944 et il fait un froid de chien. Au centre de l’espace libre, un seul poêle, qu’on allume seulement les soirs à la rentrée des Kommandos, doit réchauffer soi-disant les ouvriers qui travaillent dans la neige, mais ne modifie en rien la température glaciale de l’endroit. Que le poêle soit éteint ou qu’il soit allumé, c’est tout à fait la même chose. Seulement sa présence nous fait rappeler que lorsqu’on n’est pas en captivité, c’est une excellente machine à répandre la chaleur. Très rapidement, cinq plaies: le froid, la faim, les poux, le typhus, et les sélections, telles des plaies de Pharaon, déciment notre Transport. Durant les deux mois de notre séjour à Echterdingen, on procède à deux sélections; au total cent cinquante internés sont envoyés au four d’un Lager plus ou moins éloigné, ignoré de nous. Lorsqu’au mois de Janvier 1945 nous quittons Echterdingen pour Ordruf en Thüringe, nous sommes à peine deux cents. Tout le reste, soit deux cent cinquante individus environ sont morts dans l’intervalle, emportés par l’entérite, la pneumonie et le typhus.
A l’intérieur du hangar, on a réparé dans une section spéciale quelques rangées de lits: c’est l’hôpital. À côté, il y a une petite chambre pouvant contenir serrés les uns contre les autres cinq lits à deux étages et réservés aux malades les plus graves. Tous les jours nous avons des morts; et dès qu’un malade meurt la première chose à faire c’est de noter, outre son nom, son numéro, tatoué sur l’avant-bras gauche, et de compter attentivement ses dents en or: c’est que lorsque le Lager-Führer (sous-officier) vient réclamer les dents en or de morts, il faut faire vite, schnell, schnell.
L’ablation des dents se fait toujours en présence du Lager-Führer qui s’amène à cette intention tous les quatre ou cinq jours. {Dans l'entre-temps, tous, les cadavres qu'on recueille tous les jours, sont amoncelés hors du hangar, dans la neige, jusqu'à la nouvelle visite du Lager-Führer.} Lorsque toutes les dents ont été arrachées, il faut les désinfecter, les laver soigneusement et les remettre toutes propres.
Cette fois-ci [se sont accumulés] une vingtaine de cadavres porteurs de dents en or {se sont accumulés dans la neige}. Le Lager-Führer arrive ; on transporte en vitesse tous les morts à l’intérieur de la baraque. Le médecin en chef commence de suite l’opération ; mais les tenailles, les marteaux, les haches sont aujourd’hui impuissants ; impossible entrouvrir les mâchoires, les cadavres ne sont plus en chair, la congélation les a transformés en pièces d’acier. On essaie de couper les joues pour élargir les commissures de la bouche, mais impossible, le métal plie et la chair congelé ne cède pas. Devant l’inutilité de tant d’efforts, le Lager-Führer ajourne au lendemain matin l’arrachement des dents. Dans l’intervalle nous devons dégeler les cadavres. On installe tout autour du poêle des bancs, formant comme les rayons d’une roue autour du moyeu ; on y place tous les cadavres, la tête du côté et le plus près possible du poêle. Toute la nuit durant le Nachtwache, le gardien de nuit, pour qui le médecin en chef a «organisé» un pain pour payer sa corvée, est chargé d’entretenir le feu du poêle et de retourner convenablement de temps en temps les têtes des cadavres pour en dégeler les mâchoires. Le lendemain matin le Lager-Führer arrive, et heureusement pour nous, l’opération réussit.
Chapitre XXIII {XXV}. Le Krankenbau
A Birkenau, l’hôpital forme à lui seul un Lager spécial d’une vingtaine de baraques. Il est sous la dépendance directe du Lager-Arzt le médecin du camp. À juger par l’importance de ses fonctions, cet officier nazi jouit de toute la confiance des chefs suprêmes du parti. N’est-il pas là, {le Doctor Mengele ou} le doctor Thilo pour présider aux «sélections» plutôt que d’avoir soin des malades? N’est-ce pas lui le grand pourvoyeur des Crématoires, celui-là même qui, d’ordre de son criminel gouvernement évidemment, a sur la conscience l’assassinat par les gaz de centaines de mille, que dis-je, de plusieurs millions d’êtres innocents?
Le Lager-Arzt visite l’hôpital trois ou quatre fois par semaine. Là, il règne constamment une atmosphère d’inquiétude, d’angoisse, de peur, de terreur. Tantôt on annonce le médecin en chef, le terrible polonais Zinckteler; qui, quoique prisonnier comme nous, [il] a pris l’habitude de battre les malades et les médecins, il a le poing leste et toujours prêt à s’enfoncer dans le creux de l’estomac; dès qu’il approche, on est saisi d’effroi; on ne respire que lorsqu’il est parti. Tantôt c’est le Lager-Arzt lui-même qui s’amène. Son nom circule de bouche en bouche avec terreur, pareil à un cataclysme naturel prêt à éclater… Lager-Arzt… Lager-Arzt… cela veut dire… attention… attention… danger de mort. Ici, c’est le maître suprême, c’est un Dieu, c’est plutôt Satan. Notre vie à tous dépend de ses caprices; un signe de lui, et nous sommes pulvérisés! Il envoie au four qui bon lui semble et dès que la fantaisie lui en prend. Mais que vient-il faire à l’hôpital aujourd’hui? Est-ce simplement pour nous ennuyer? Ne vient-il pas plutôt réclamer pour le four ses prochaines victimes? Quelque temps après, c’est le tour du S.D.G. (le remplaçant S.S. du Lager-Arzt) de faire sa visite. Plus tard encore c’est le Lager-Capo, etc… etc… Les alertes se suivent et tant qu’elles durent nous respirons une angoisse, une peur indicibles.
Pour combattre les poux, l’imagination nazie a trouvé une méthode très simple, simpliste même: les malades ne portent aucun vêtement, ils sont à poil. Durant des mois et des mois, été comme hiver, ils sont complètement nus. De temps à autre il y a aussi la désinfection: [on fait prendre une douche aux malades.]
{Vers la fin de l'automne 1943, la première fois que j'ai assisté à la désinfection des malades de l'hôpital, cela s'est passé dans des conditions épouvantables et dramatiques.
Tout à coup, dans les premières heures de la journée, le gong sonne à coups redoublés et précipités; et quand le gong sonne l'alarme, comme aujourd'hui, tout l'hôpital sait ce que cela signifie: c'est le "alle Pfleger eintreten", à l'Appel-Platz; tous les infirmiers (les médecins ici ne sont que des infirmiers) doivent se présenter d'urgence à l'Appel-Platz. Tout le personnel de l'hôpital interrompt immédiatement le travail et se rend en courant à l'Appel-Platz; le moindre retard peut coûter la vie, le S.S. est capable de vous abattre sans autre forme de procès.
A l'Appel-Platz nous trouvons un camion plate-forme sur lequel est hissé une énorme cuve qui peut bien avoir une dizaine de mètres de long, un mètre et cinquante de large et soixante-dix centimètres de hauteur. Elle est formée par d'épaisses plaques métalliques, ajustées par des boulons, et pèse de toute évidence plusieurs milliers de kilos. Et l'objet de notre présence à l'Appel-Platz, c'est précisément pour descendre la cuve du camion, et la ranger le long de la voie. En présence d'un S.S. qui tient un long tuyau de caoutchouc à la main, un Capo donne les ordres de manoeuvre nécessaires: serrés les uns contre les autres, une trentaine de médecins esclaves se rangent et épaulent la cuve d'un côté, tandis qu'une autre trentaine l'épaulent du côté opposé. Le Capo commande la manoeuvre, les médecins-esclaves se raidissent et essayent de faire avancer la cuve de quelques centimètres, mais au premier essai, ils ne parviennent même pas à la faire bouger. Mais le S.S. ne tient pas en main pour rien son tube de caoutchouc; aussitôt et tout en poussant des hurlements sauvages, il tape violemment et indistinctement sur les têtes et sur les échines des Pflegers. C'est ainsi seulement, pense-t-il, qu'on contraint cette canaille au travail. Après plusieurs heures d'efforts, aiguillonnés par les coups, meurtris dans nos chairs, nous posons la cuve sur la voie.
Le lendemain, de très bonne heure, la désinfection commence. La cuve est à demi remplie d'eau de puits, et quelques hommes, portant des masques, y dissolvent des gaz toxiques. Tous les malades des Blocks à désinfecter aujourd'hui (cinq-six Blocks) sont déjà rassemblés tout nus devant leurs Blocks respectifs. Ils ont tout le temps d'attendre leur tour; car, la cuve quelque grande qu'elle soit, ne peut contenir qu'une quarantaine de sujets à la fois; ils y baignent pendant quelques minutes, puis c'est le tour d'un autre groupe. Les malades déjà "désinfectés", tout ruisselants, car il n'y a rien pour s'essuyer, s'étendent sur le sol, en plein air, devant le Block, à quelque distance des non-encore désinfectés. Tous les malades de l'hôpital prennent le bain dans le même liquide, puis on y désinfecte également les couvertures en les plongeant tout simplement pendant quelques minutes dans la cuve. A la tombée de la nuit seulement, lorsque la désinfection de tout le secteur de l'hôpital est terminé, les malades encore vivants, sont enfin autorisés d'entrer dans le Block et d'aller se reposer sur les couvertures désinfectées toutes trempées encore. Les cadavres restés devant les Blocks sont ramassés par le "Leichen-Halle". Les jours suivants, la désinfection se poursuit pour les autres Blocks, dans la même cuve, et dans le même liquide.
{Plus tard, on a installé des douches à l'hôpital de Birkenau, et la désinfection se fait au "Wach-raum". Eté comme hiver, les malades se rendent au Block} [Même en hiver ils se rendent dans le block] aux douches, le «Wasch-raum», entièrement nus,
{en hiver} enveloppés seulement dans leur couverture. Les malades très graves qui ne peuvent pas se rendre aux douches par leurs propres moyens, sont transportés sur le dos des médecins. Tous les malades sont tenus ce jour-là de prendre la douche, quelle que soit la gravité de leur état général. Aussi, toutes les fois d’innombrables cadavres gisent dans la salle de bain. Les jours qui suivent la désinfection, la mortalité est effroyable. Ici, les malades qui prennent un bain doivent au préalable faire leur testament. Du reste, la mortalité en général au Block de l’hôpital, en dehors des périodes de désinfection, est très élevée; elle a atteint un chiffre record en Janvier ou Février 1944 au Block 12 où je suis médecin. Sur 250 malades environ 74 sont morts une fois en un seul jour!{}
{Comme dans le Lager des ouvriers, à l'hôpital aussi}Chaque Block est sous la direction d’un chef-de-Block [altester] {ou Blockältester avec des}, [puis il y a les] Stubedienst avec un Ober-Stubedienst. Tous ceux-là ne sont pas des médecins et pourtant ils s’imposent et passent des ordres aux médecins, parce que souvent ils sont plus anciens dans le camp. Tous les matins, les médecins transportent des barils d’eau des puits, lavent le parquet, nettoient les vitres et les tabourets ; ils vont chercher à la cuisine le thé {"thé"} et la soupe de midi, ils rincent et nettoient à grande eau le tonneau servant à transporter la soupe ; et quand un malade salit sa couverture parce qu’il a la diarrhée, c’est son médecin qui la lave. Aussi reste-t-il très peu de temps au médecin pour pratiquer la médecine. Du reste, assez souvent les soirs quand enfin on espère prendre un peu de repos, survient le Lager-Capo et commande: Pfleger eintreten (Pfleger, c’est-à-dire infirmier, car à l’hôpital de Birkenau les médecins ont droit au titre d’infirmier seulement) Pfleger eintreten, et il fait exécuter au personnel de l’hôpital des travaux de terrassement durant une heure ou deux; souvent il y pleut aussi des coups. Les parterres aménagés devant le Blocks doivent avoir l’apparence d’être soignés; on y cultive des fleurs et des légumes. Peu importe que ceux qui les sèment, envoyés au four dans l’intervalle, ne les verront jamais pousser.
Très souvent il faut aider le Kommando du Leichen-Halle à charger les cadavres dans les voitures. Ce travail se fait la nuit. La première nuit de mon installation à l’hôpital, il y en avait dans une baraque pus de 200. On y attend l’arrivée des voitures. Jamais on ne sait à l’avance à quelle heure précise elles arriveront ; parfois il y a des retards de plusieurs heures ; mais le Leichen-Halle est tenu d’attendre et d’être prêt. Enfin arrivent deux camions et immédiatement commence le travail ; il faut alors aller vite… schnell… schnell… comme toujours. Il fait noir, il y a de la boue, on glisse, on vous tape dessus, il faut quand même faire vite. À deux nous saisissons un cadavre ; moi par les pieds, mon compagnon par les épaules, et d’un mouvement de balançoire en criant, ô, ô, hop! nous le basculons dans le camion; puis nous courons chercher un autre, ô, ô, hop! nous le lançons également dans la voiture, et ainsi de suite jusqu’à charger tous les cadavres. Dans l’obscurité, j’ai empoigné plus d’une fois des plaies, des abcès, des phlegmons qui ont crevé entre mes mains. Le travail terminé, j’avais les mains pleines de pus et de sang! {Et je me couchais les mains puantes, il n'y avait pas d'eau pour se laver.}
Le mouvement des malades dans le Block de l’hôpital est très actif. Tous les jours presque il y a des entrants et des sortants des «Zugang» et des «Abgang». Les nouveaux arrivent soit directement du camp de travail du Lager D, soit des autres Blocks de l’hôpital; parfois il en arrive par groupes de plusieurs dizaines, de plusieurs centaines, des hôpitaux des camps plus au moins lointains, Buna, Yavorzna, etc… Ces {derniers} malades sont destinés au four. Ils ne sont admis à l’hôpital que pour attendre leur tour d’aller au Crématoire; les sortants sont dirigés inversement soit vers le camp D de travail quand ils sont considérés guéris, soit transférés dans un autre Block de l’hôpital d’une autre spécialité, soit enfin, après une «Selection» envoyés directement au four.
Ce qui est de toute première importance, c’est que tous les Zugang {(entrants)} doivent être minutieusement rasés; le Lager-Arzt l’a personnellement ordonné. On doit être rasé au visage, aux aisselles, au pubis, au cul.. Ah! des culs, ce qu’on en a contrôlés! C’est obligatoire. Le sujet est à poil, naturellement, debout sur ses jambes, il se courbe en avant. De ses mains il écarte ses fesses et en même temps il pousse comme quand il va à la selle; il met ainsi la région de l’anus bien en évidence, et le médecin fait alors le contrôle avec une parfaite aisance. Souvent c’est le Lager-Arzt lui-même qui fait ce contrôle. Il s’amène armé d’une pince, et quand il découvre un poil autour de l’anus, il l’arrache et le montre au médecin-chef du block, au bout de sa pince. Tout le personnel du Block est alors gratifié d’une heure de «Sport». Aussi quand les malades vont d’un Block à un autre, la première chose à faire, c’est de les inspecter attentivement et de s’assurer qu’ils sont parfaitement bien rasés; autrement, il faut les renvoyer à leur Block d’origine, les y faire raser avec soin et suivant les règlements tacitement admis, et ne les accepter dans le Block qu’alors seulement.
C’est pourquoi une des personnalités les plus importantes des Blocks de l’hôpital, c’est le coiffeur, le Friseur: c’est le bras droit du médecin en chef du Block. Pour que le friseur puisse conserver son poste très convoité, il faut qu’il «organise» lui-même son instrumention, d’ailleurs très rudimentaire: une machine à couper les cheveux, un ou deux rasoirs, un blaireau, une petite tasse et un bout de savon à barbe.
«Organiser»… c’est le terme consacré du Lager. Tout est compris dans ce mot «Organiser» c’est tout à la fois recevoir en cadeau, échanger contre des vivres, emprunter à un camarade, voler à un autre; bref, «organiser» c’est synonyme de posséder, peu importe comment.
Le coiffeur donc «organise» son attirail. C’est sur le savon à barbe surtout que s’exerce toute son ingéniosité pour l’économie. À cette intention il fait dans sa petite tasse une seule savonnade pour toute la journée et pour tous les sujets à raser; de temps en temps il y ajoute un peu d’eau, et si l’eau fait défaut, de la salive. Pour ne pas omettre une région à raser, il procède avec système: d’abord la barbe, puis il passe aux aisselles, au pubis et il termine par le cul. Avec la même savonnade, le même blaireau, et sans le laver naturellement, du cul d’un sujet, il passe à la barbe du sujet suivant. C’est comme une chaîne, dont les différents maillons sont représentés par les malades à raser et dont les liaisons se font entre le cul et la barbe… cul-barbe, cul-barbe.
Il est possible que dans la vie normale ordinaire cette façon de concevoir l’hygiène soit jugée avec quelque sévérité, voire même avec dégoût et horreur. Mais dans le camp, cela ne fait aucune impression. Qu’importent ces détails pour des internés dont les facultés intellectuelles sont émoussées par les privations et les brutalités de l’ambiance et qui vivent constamment avec la sensation de côtoyer les bords glissants du gouffre de la mort!
{Dans le camp, on n'a pas beaucoup d'efforts intellectuels à dépenser. Pour ceux des internés qui en ont les moyens, toute l'activité spirituelle ou presque, s'emploie à la question de pouvoir "Organiser". Organiser principalement un supplément de ration.
Les occasions "d'organiser" sont plus fréquentes et plus facile à l'hôpital que dans le Lager des ouvriers. Ne sort-on pas tous les jours un nombre considérable de morts de chaque Block? Les morts sont surtout très nombreux au Block 12 où je travaille moi-même; il en meurt plus que partout ailleurs, parce que c'est le Block des diarrhéiques. Les rations de pain laissées par les morts échouent en héritage aux Pflegers. Avec des précautions infinies pour ne pas être surpris, car tout trafic est formellement interdit, on échange ce pain contre des pommes de terre que les internés travaillant dans le Kommando des pommes de terre volent en les cachant dans les jambes de leurs pantalons.
Pour avoir un repas du soir complet, il suffit d'Organiser des pommes de terre, un peu de margarine, et un bout de saucisson, et, si on est très riche, un oignon ou un ail. On Organise presque toujours auprès des malades Polonais chrétiens qui reçoivent des colis des leurs.
Au Block 12, le Dr. Golz de Paris, le Dr. Horeau de Cany (Normandie) et moi-même, nous avons formé une association: nous mettons en commun tout ce que chacun de nous peut Organiser dans la journée; et le soir, quand on a quelque chose, on prend le repas ensemble.
Justement, derrière le Block 12, il y a une très petite baraque en planches: c'est la morgue de Birkenau. Oui, si étrange que cela puisse paraître, dans le Lager de Birkenau où les morts et les assassinats se comptent par milliers tous les jours, il y a tout de même une morgue. Le Lager-Führer et le Lager-Artz tiennent absolument à faire toute chose en bonne règle: quand on recueille des suicidés qui se sont jetés sur les fils barbelés électrisés et percés par les balles tirées par les S.S. du mirador voisin, quand les S.S. abattent des internés pour une raison ou une autre, les cadavres sont envoyés à la morgue; et d'experts chirurgien-esclaves après en avoir fait l'autopsie, doivent rédiger des rapports circonstanciés expliquant la raison de la mort!
Presque en permanence il y a deux, trois, et même quatre cadavres sur les deux tables de la morgue. Ce ne sont évidemment pas des tables en marbre ou en porcelaine; ce sont simplement des tables formées par un assemblage de planches non rabotées, supportées par des branches tortueuses d'arbres. Les cadavres tout sanglants sont posés à même la planche, qui petit à petit s'est incrustée du sang d'anciens cadavres, formant ici et là des larges plaques laquées. La morgue de Birkenau, comme tout ce qui se fait dans le Lager, n'est qu'une imitation burlesque de la réalité de la vie libre. Mais pour notre association des trois médecins, c'est un refuge tout providentiel; et c'est justement à la morgue qu'on se délasse et qu'on prend le repas du soir, quand on a Organisé quelque chose d'extra. Ayant déplacé un peu les cadavres pour faire de la place, on pose sur la table la casserole fumante de pommes bouillies, presqu'au contact du cadavre, car, la table n'est pas très large; et tous les trois debout (il n'y a pas de chaises) nous prenons notre repas très tranquillement avec la compagnie des morts.
De temps en temps, la journée terminée et lorsque nous n'avons pas de travail supplémentaire ni du "Sport" à faire, nous nous asseyons sur le sol devant la morgue. Nous y échangeons quelques paroles tout en prenant l'air frais. A une très petite distance, par delà les fils barbelés il y a un mirador, avec un S.S. et sa mitrailleuse. C'est bien fait pour nous rappeler que notre situation est sans espoir. Mais personne n'y prête attention: rien ne peut plus nous émouvoir. Le mirador, le S.S., et le canon de sa mitrailleuse qui se profilent sur le ciel ne sont simplement qu'un détail du tableau quotidien fait de baraques, de barbelés et de cheminées des usines de la mort.}
Chapitre XXIV {XXVI}. Les Sélections.
A Birkenau les modes d’exécution sont multiples et variés. Dans la même journée certains meurent à l’hôpital, soit disant de mort naturelle, en réalité d’un état systématisé par les Allemands d’épuisement, de cachexie, d’avitaminose et de diarrhée terminale. D’autres sont ramenés morts des Kommandos, tués par des Capos pleins de zèle. D’autres encore, las d’une vie si misérable, se sont volontairement électrocutés en se jetant sur des fils de fer barbelés. Quelques-uns sont pendus pour tentative d’évasion. Certains sont tués par des armes à feu, la figure totalement déformée par les balles. D’autres succombent au cours des expériences de l’S. D. G. au moyen d’injections intraveineuses et intracardiaques de pétrole et de phénol ; L’S. D. G. s’ennuie, il veut se divertir tout en essayant son adresse à réussir la veine. (Cette méthode d’exécution, je ne l’ai pas vue moi-même mais elle est authentique et m’a été rapporté par des médecins internés, plus anciens que moi à l’hôpital).
Par-dessus tout, couvrant tout le camp de Birkenau de la faux immense de la mort, sévit l’extermination en masse dans les Crémas ; dans les usines infernales, engloutissant, gazant, brûlant des milliers de personnes tous les jours. La clientèle des Crémas se recrute principalement dans les «Transports». Au fur et à mesure que les Juifs arrivent de leur pays natal le Lager-Arzt procède de suite au triage et dès la descente du train envoie aux gaz les trois quarts environ du «Transport». Il ne conserve que le minimum de chaque «Transport» pour utiliser ces gens directement ou indirectement au travail colossal que demande l’incinération quotidienne parfois de quinze mille individus. Dès cette première «Sélection», le Lager-Arzt envoie au four tous ceux qu’il juge inaptes au travail; non pas seulement les malades et les invalides, mais aussi tous ceux au-dessus de cinquante ans et au-dessous de quatorze-quinze ans, ces derniers ensemble avec leurs mamans.
Mais ceux qui sont reconnus aptes au travail ne sont pas pour cela à l’abri des gaz. Pas du tout, le Lager-Arzt se réserve la bonne bouchée pour plus tard, lorsque au bout de deux, trois mois ils seront devenus squelettiques. Alors le médecin-assassin, l’ange de la mort, passe dans tous les Blocks du camp, sans oublier naturellement l’hôpital, et y fait ce qu’on appelle du nom si euphonique de «Sélection».
Tous les Israélites des différents Blocks — alle Juden eintreten — défilent nus et en vitesse devant le Lager-Arzt. Dès qu’ils sont suffisamment maigres, ils sont bons pour les Crémas. Le Créma est, dirait-on, une bête féroce et vorace, ayant bien d’analogie avec les monstres de la mythologie, une espèce de Minotaure se repaissant de victimes humaines. Quand il n ‘y a pas de «Transport» et qu’il chôme, il se rabat sur les détenus du camp. Il ne lui suffit pas alors d’engloutir tous les malades; ce qu’il lui faut c’est un chiffre déterminé de personnes à dévorer, que ce soit des invalides ou des gens pleins de santé. Pour assouvir sa faim vorace, inextinguible, pour entretenir, dirait-on, en bon état ses organes monstrueux il réclame, deux, trois, quatre mille victimes à la fois. Et le Lager-Arzt, l’Ange de la Mort, qu’on ne peut pas sans mauvaise foi accuser de manque de zèle, ne trouve pas le nombre suffisant de malades et de moribonds à offrir au Créma. Il lui faut quand même et coûte que coûte compléter son chiffre; il se rattrape sur ceux qui lui tombent sous la main; sur les ouvriers bien portants qu’il va chercher aux chantiers, sur le personnel des Blocks et même sur le personnel de l’hôpital. J’ai vu partir, j’ai aidé à monter sur les camions les transportant au Créma, des parents et des êtres chers: mon beau-frère Samil Moise Nahon, mon neveu Salomon Eliezer Djivré, Peppo Salomon Azouz, Chapat Bohor Alcabés, Marco Raphael Béhar et tant et tant d’autres. Presque tous, je puis l’affirmer, sont partis à la mort, sachant bien qu’on les conduisait au Crématorium, avec un grand courage, presque en souriant contents de mettre un terme à une vie infernale
Chapitre XXV {XXVII}. Égards nazis
Les Allemands ont bien soin de faire coïncider les grandes «Sélections» du Lager avec les fêtes juives. Que des croyants Israélites adressent des prières à leur Dieu, s’ils en ont envie; pour les Nazis, c’est justement l’occasion de démontrer qu’ils sont invulnérables et plus puissants que Jehovah. Ils se moquent bien du Dieu d’Israel; que Jehovah le veuille ou non, les Juifs ne leur échapperont pas. Les «Sélections» se font conjointement dans les Blocks des hommes et dans ceux des femmes. Le monstre Créma ne réclame-t-il pas une nourriture mixte, hommes et femmes?…
Les expéditions au Créma se font le plus souvent en voiture, même quand il s’agit des sujets pris dans les Blocks qui ne sont distants du four que de 600 à 800 mètres. Mais aujourd’hui les victimes prises à l’hôpital sont conduites à pied au Créma, par cinq, «zu fünf!» Tous déjà sont à poil. Survient le Lager-Arzt, pour présider au départ. Les voyant nus, il fait semblant d’être pris de pitié. Il ordonne de donner un manteau à chaque sujet. Puis, paternel et tendre, s’adressant à ceux que la mort va faucher dans quelques minutes et dont les corps seront tout à l’heure sur un brasier ardent: «Couvrez-vous bien, boutonnez-vous le haut du col, vous allez prendre froid»…
On se sent pris de vertige quand on songe à la profondeur du cynisme [allemand] {nazi}!
Ce matin il fait froid, très froid ; nous sommes en Novembre 1943. Comme tous les jours, à 4h30 je suis à la corvée de l’eau. Tout à coup. J’entends des cris de femme ; ils viennent en direction de la route conduisant au Créma. Bientôt on voit 1, 2, 3, 7 à 8 voitures découvertes, chargées de femmes et de jeunes filles. Elles sont complètement nues ; on se rend facilement compte que si elles poussent des cris, c’est surtout qu’elles souffrent terriblement du froid. Ainsi les Allemands ont des intentions toutes spéciales pour les femmes, après les avoir obligées à peiner deux, trois, cinq mois dans des conditions dures et infernales, leur faisant exécuter des travaux exténuants et répugnants, après les avoir plongées dans la vermine et la gale, ils les expédient au four, nues, et dans des conditions telles qu’elles aient à souffrir physiquement par le froid, et moralement par la terreur du Crématorium. Car, si elles sont expédiées nues, ce n ‘est certes pas par hasard ; tout est machiné, calculé pour qu’il ne leur subsiste aucun doute sur leur destinée. Dans ce «Transport» il y avait aussi ma sœur Rachel.
Derrière chaque «Transport» au Créma, qu’il s’agisse d’un «Transport» de nouveaux arrivés ou qu’il s’agisse d’un Transport» d’invalides du camp, derrière chaque «Transport» et comme fermant la procession, il y a toujours une voiture de la croix rouge allemande. Pourquoi de la Croix-Rouge? Cela c’est un mystère allemand. Les Allemands arrivent à renverser l’ordre des choses le plus sacré! Les «Transports» de la mort sont convoyés par la Croix-Rouge, qui est dans le reste du monde le symbole de l’espérance et qui en Allemagne nazie sert à camoufler la Mort, car la voiture de la Croix-Rouge transporte justement les gaz destinés à l’extermination du «Transport»!…
Chapitre XXVI {XXVIII}. Les «Créma» et les «Sonder-Kommando»
Il y a à Birkenau quatre Crématoria. Ils sont désignés par des chiffres: Crématorium No. 1, No. 2, No. 3, No. 4. Les Crématoria No. 1 et No. 2 sont de construction récente et les deux plus grands avec une seule cheminée chacun; les Créma No. 3 et No. 4 sont plus anciens et quoique plus petits ont deux cheminées chacun6.
Souvent ils fonctionnent tous les quatre à la fois ; on a même creusé deux fosses immenses où l’on brûle les Juifs au moyen de gros troncs d’arbres après les avoir gazés. À cette intention, on applique à l’avance et on renouvelle constamment un stock immense de bûches énormes. Ce, sont exclusivement des Juifs qui exécutent ce travail, car si c’est un principe quasi absolu de l’Allemagne nazie de se refuser à utiliser pour son compte le travail juif, parallèlement c’est une loi aussi absolue que seule la main-d’œuvre juive doit être employée directement ou indirectement à la destruction des Juifs. En chargeant et en déchargeant les wagons de bûches, souvent on se dit, mi-sérieux: ça c’est ma bûche! elle servira à me brûler moi-même.
On a toujours en réserve plus de deux cents wagons de bois à brûler des Juifs. Il n’y a que les fosses d’ailleurs qui brûlent du bois, les Créma consument du charbon. Mais les fosses, quoique à titre auxiliaire, fonctionnent bien souvent: il y a tellement de travail urgent dans le camp!…
Quand les fosses fonctionnent le Lager entier est saturé d’une odeur insupportable de rôti, de chair brûlé ; l’atmosphère en est toute imprégnée: on dirait que l’odeur colle sur les habits, sur les couvertures des lits. Le Lager Arzt lui-même en est incommodé et fait bien souvent pulvériser des parfums dans son bureau, à l’heure où il vient visiter le camp.
Les ouvriers des Crématoria, le «Sonder Kommando» sont tous des Juifs, sauf une trentaine de Russes arrivés de Lublin après l’évacuation de cette ville par les Allemands. {(Ces Russes avaient été utilisés pour exterminer le dernier "Sonder-Kommando" juif de Lubin).} Une partie du Sonder-Kommando est logée dans les Crématoria mêmes. Ces gens n’en sortent jamais; ils y sont comme enterrés vivants. Ils ne peuvent être en communication avec les internés du Lager que tout à fait exceptionnellement. Le reste du Sonder est logé au Lager, dans deux Blocks spéciaux, très surveillés. Il est interdit à ces internés également d’être en contact avec les autres détenus. Vers la fin de la guerre cependant, un peu avant l’évacuation de Birkenau, la surveillance s’était bien relâchée et on pouvait converser assez facilement Ceux-là, et même ceux logés dans les Créma ont divulgué bien de détails sur les méthodes de «Travail» dans les Créma.
Mon ami Benardis, reporter des journaux athéniens, habite dans le Lager D, la même baraque que moi, la baraque 27. Il est tout émotionné de reconnaître parmi les gens du Sonder une de ses anciennes connaissances d’Athènes, un jeune homme de bonne famille et jadis d’une très bonne éducation. Comme nous tous ici, il est actuellement méconnaissable. À leur seconde rencontre, ce dernier le prend à part et lui fait le récit de son calvaire.
— «Dans ton regard, dit-il, j’ai lu l’étonnement, le mépris, le dégoût même que t’inspire ma profession d’aujourd’hui, celle de brûleur de cadavres. Ah! Combien pouvez-vous être loin de vous douter de ce que moi-même et mes camarades du Sonder souffrons de notre état! Mais les Allemands sont des maîtres quand il s’agit d’éduquer leurs esclaves pour le but qu’ils se proposent. Dès mon arrivée à Birkenau je suis jeté, avec tout mon «Transport» au Quarantaine-Lager. Aucun travail, presque pas de nourriture non plus. Nous souffrions terriblement de la faim. Plusieurs fois par jour Eintreten, Appel. À peine rentrés au Block, de nouveau Eintreten. Nous passons toute la journée à nous aligner devant le Block, nous sommes exténués, nous mourons de fatigue. L’Appel réglementaire du soir est interminable! plus de deux heures debout dans la cour. La nuit, nous nous couchons tout heureux de penser pouvoir nous reposer enfin quelques heures. Une heure après, coups de sifflets stridents et impératifs, hurlements terribles de Stubendienst… Aufstehn… Appel… schnell… schnell….
«Nous devons nous rendre en courant à l’Appel-Platz. Nous passons encore une heure debout dans la nuit, sans aucun but, pour nous épuiser complètement, puis nous rentrons au Block, nous nous recouchons. Vers le milieu de la nuit, mêmes coups de sifflets, mêmes hurlements… Aufstehen… Appel. Chaque nuit l’appel se répète deux fois, trois fois; impossible de jouir d’un sommeil continu. Ce régime continue durant un mois. Puis un beau, jour nous voyons venir le Lager-Arzt. Il procède à une Selection. Il choisit les plus forts d’entre nous, à certains il tâte les membres. La Selection terminée, nous sommes conduits au Lager D. et versés dans les baraques 9-11, celles du Sonder-Kommando. Ici, la situation change complètement. Personne ne nous embête plus; plus aucun Eintreten. Toute la journée nous restons étendus dans nos lits; nous ne sommes plus réveillés la nuit; la nourriture est substantielle et abondante. À chaque repas, on nous sert quelques verres de Schnaps, cela dure quelques jours et chaque fois la dose de Schnaps augmente. Mais pourquoi donc tous ces égards, tous ces petits soins après un mois de jeûne? Tous se le demandent. Il doit se passer quelque chose d’insolite, les Allemands nous préparent sans doute un mauvais coup. Pour ne pas trop y réfléchir, nous nous jetons avec passion sur le Schnaps distribué de plus en plus abondamment. Les S.S. nous voient boire et nous encouragent de leurs sourires… Certains deviennent affectueux, ils tapent familièrement sur les épaules des internés… gut? gut? Nous noyons notre pensée dans les vapeurs de l’ivresse. Au troisième jour, un Capo fait son apparition. «Allez, les enfants dit-il, un dernier petit verre, et l’on va ensuite travailler un petit peu». Rangés par cinq, à demi-ivres, nous sommes conduits quelque part. Nous approchons, d’une bâtisse en briques flanquée d’une haute cheminée: une fabrique? Mais pourquoi donc le silence si profond et si impressionnant de ce lieu éveille en chacun de nous et fait remonter à surface les sinistres soupçons que nous avons tous enfouis par l’alcool dans le tréfonds de notre pensée? Une lueur instinctive nous avertit: dans cet endroit lugubre il se commet des assassinats…
«Nous entrons dans la cour, puis, nous traversons la porte de la bâtisse au-dessus de laquelle je lis le mot «Baden». On nous conduit donc au bain? Nous sommes introduits dans une grande salle, dans le sous-sol. Rien de particulier, au fond une porte; aux murs des centaines de crochets numérotés pour suspendre des habits. Je m’obstine cependant à chercher, à découvrir quelque mystérieuse machine à donner la mort. Le plafond, les murs peut-être recèlent-ils des appareils ingénieux pour foudroyer les gens? Les Allemands sont si subtils. Mais rien. Cette salle est comme toutes les autres salles… et pourtant une angoisse inexplicable m’étreint la gorge. Tout à coup, des voitures vrombissent; elles s’arrêtent devant la porte. Nous voyons entrer dans la salle, des femmes et des enfants; puis d’autres encore. Ils sont au nombre de 250 à 300. Les voitures s’éloignent, la porte est refermée. Dans la salle circulent maintenant plusieurs S.S. et quelques internés anciens. Ils ordonnent aux femmes de se déshabiller… schnell… schnell… los, los… Déjà les cravaches commencent à taper, des pistolets brillent… Il faut se déshabiller et en vitesse. On fit comprendre aux femmes de placer leurs effets avec soin sur les accrochoirs et surtout de bien retenir le numéro, pour éviter la confusion à la sortie du bain. Par pudeur de se voir à poil devant tant d’hommes, quelques femmes conservent encore leurs combinaisons. Mais il faut tout enlever… Alles… Alles…. Je n’oublierai jamais une Française qui me dit en ce moment en me suppliant. «Monsieur, ayez soin, je vous prie, de mes effets, les Boches nous ont déjà tout pris, c’est tout ce qui me reste.»
«Combien était-elle loin de se douter de ce qui l’attendait de l’autre côté de la porte du fond! On ouvre cette porte, on y refoule toutes les femmes et tous les enfants puis on la referme sur eux. De nouveau au dehors le bruit des voitures se fait entendre; de nouveau des femmes et des enfants sont introduits dans la salle, en nombre sensiblement égal au précédent. Mêmes injonctions: déshabillez-vous, schnell… schnell… Ce groupe également est refoulé de l’autre côté de la porte du fond. Puis, de nouvelles voitures arrivent, déversant toujours des femmes et des enfants.
«Cette manœuvre se répète cinq, six fois. Un officier demande «combien sont-ils?» Mille quatre cents. Le capo nous ordonne: Eintreten par cinq; c’est assez travaillé pour aujourd’hui. Nous rentrons au Block. Arrivés à la baraque., on nous sert à manger. Mais personne n’a faim, personne ne touche aux mets. Notre esprit est ailleurs. À travers la porte du fond, chacun de nous veut percer le mystère horrible de l’arrière salle. C’est là le Crématorium dont nous entendons parler depuis quelque temps, nous en avons l’intuition certaine. Mais comment cela se passe-t-il? Quelle machine diabolique les Allemands ont-t-ils inventée pour exécuter 1400 personnes à la fois? Et ces pauvres gens, en attendant la mort qui va les délivrer, y souffrent-ils beaucoup? Combien de temps ce drame cruel dure-t-il? Et nous-mêmes, pourquoi nous ont-ils conduits là-bas, comme à une répétition? Ah, pouvoir ne plus penser, voir sombrer son intelligence! Là est la délivrance… Nous nous jetons avec avidité sur le Schnaps; il est servir toujours avec plus de largesse. Boire, boire toujours, nous imbiber d’alcool jusqu’à effacer toute trace de sentiment. Deux jours de suite les nouveaux du Sonder Kommando ne mangent presque pas, ils ne demandent que du Schnaps. Puis le Capo arrive. Eintreten, par cinq, on ira au travail. Nous sommes conduits à la même salle. Les accrochoirs sont surchargés d’habits mais cette fois ce sont des habits d’homme. Le même officier de l’autre fois demande: «Combien sont-ils?»
— Deux mille…
— «Est-ce prêt, peut-on commencer?»
— Tout est prêt.
On ouvre la porte du fond. J’approche… J’approche… Elle donne sur un couloir. Sur l’un des côtés une autre porte avec les battants entourés de bandes de caoutchouc; cette porte ferme hermétiquement. Au-dessus d’elle une horloge électrique et une espèce de lucarne fermant par une vitre très épaisse. Un S.S. ouvre une caisse; il en sort deux bouteilles, tout-à-fait semblables à des bouteilles isolantes, à des thermos; ce sont des bouteilles à gaz, du cyclone. Il ouvre la lucarne, y lance avec force les thermos et referme précipitamment. Quelle heure est-il à l’horloge électrique? Huit heures cinq. Dans leur chute, les thermos se brisent en provoquant une détonation. Immédiatement après j’entends un second bruit: on croirait à la crevaison de pneus d’auto, ou au sifflement de centaines de serpents.
«Des cris de détresse, des hurlements atroces montent de plus en plus forts. Suis-je dans l’enfer? Les parois de la chambre à gaz tremblent sous les coups désespérés des asphyxiés. Des bras cognent sur la vitre de la lucarne dans une tentative de la briser. Nous sommes tous pâles, les cheveux se dressent sur les têtes, une sueur froide perle sur les fronts… Certains se sentent défaillir. Les cris perdent maintenant de leur intensité, ils sont plus rares. Ce ne sont plus que des gémissements sourds, lointains. Puis c’est le silence absolu. Combien de temps cela a-t-il duré? Trois minutes, cinq minutes? Le S.S. consulte du regard l’horloge. Il presse un bouton électrique. À l’intérieur de la salle à gaz des ventilateurs nettoient l’atmosphère. On ouvre la porte. Quel horrible spectacle! Un amas de cadavres, pêle-mêle les uns sur les autres; les membres entrelacés, les yeux hors des orbites, la bouche écumante, la face émaciée; du sang, des souillures… On retourne les cadavres et on procède de suite au Zähne-Kontrolle; les dents en or sont arrachées et déposées dans une caisse. Aux femmes on coupe les cheveux qui prendront le chemin de l’Allemagne. Des ascenseurs spécialement aménagés montent à l’étage supérieur; où sont les fours crématoires, ce qui reste des deux mille êtres humains tout à l’heure vivants…
«Au bout de quelques jours, les surveillants décident que les nouveaux sont suffisamment exercés au travail; ils leur suppriment le Schnaps. Mais pour les gens du Sonder, le Schnaps c’est la vie même. Alors ils l’achètent à leur Capo, contre de l’or, des diamants. Le capo lui-même se procure l’alcool chez les civils polonais, qui viennent tous les jours de leurs villages travailler dans le camp. Les pièces d’or, les diamants, les brillants, les bijoux; les esclaves du Sonder les «Organisent» en contrôlant sous l’œil des Allemands, et pour leur compte naturellement, les doublures des vêtements des victimes. Ces «Organisations» se font au su des Allemands qui les tolèrent tacitement. Mais il faut être adroit et ne pas se laisser prendre; dès qu’un interné est surpris avec l’or ou les bijoux sur lui, il est fusillé sur place.
«Dans les Créma, il y a plusieurs équipes de travail. Des ouvriers retirent les cadavres des chambres à gaz et les montent à l’étage supérieur jusqu’au four; d’autres entretiennent la propreté des salles et en lavent les parquets à grade eau après chaque opération de gazage pour effacer les traces des souillures et de sang que les pauvres gazés ont laissées de leur horrible agonie; d’autres encore travaillent aux fours, d’autres équipes enfin, au moyen de grands marteaux-pilons en bois pulvérisent les débris d’os calcinés. Les cendres sont ramassées, chargées sur des camions et dispersées dans la Vistule. Ainsi, des quelques milliers d’individus qui ont été gazés, au bout de quelques heures il ne reste plus aucune trace matérielle; pas même une parcelle d’os. C’est comme si ces gens n’avaient jamais existé.
«Les divers Kommandos exécutent ces travaux sous la surveillance directe des S.S. qui les forcent à chanter tout en pilant des os humains. Certains S.S., natures perverses, cyniques, s’amusent à tripoter les organes génitaux des cadavres des femmes avec l’extrémité enflammée d’une bûche. Est-ce une espèce de folie du doute, pour stériliser radicalement toute Juive, quoique déjà morte, et empêcher la reproduction de la race maudite et abhorrée des Juifs?».
«… Il arrive que le nombre de gens à tuer n’est pas assez élevé; cela ne vaut pas la peine de faire fonctionner la chambre à gaz; le cyclone coûte cher; il s’agit de massacrer tout simplement cent, deux cents individus, Alors c’est le chef des créma, l’Oberschaft-Führer Moll qui les exécute au moyen de son pistolet. Il a des plaisanteries avec ses victimes: «As-tu l’odorat fin… sens-tu bien cette rose?» Et il tire dans le nez. Durant tout le temps que ce bandit sanguinaire a eu l’occasion de passer à Birkenau, il a eu indubitablement la satisfaction d’assassiner de sa propre main plusieurs dizaines de milliers de victimes.
«Les incidents dans les Créma sont tout-à-fait exceptionnels, les gens des «Transports» nouvellement arrivés ne se doutant pas de ce qui les y attend, s’y rendent comme des agneaux à l’abattoir. Un jour, une jeune femme très belle, dit-on, une artiste attend avec son «Transport», dans l’antichambre de la chambre à gaz. Comme toutes ses compagnes, elle est déjà toute nue et ne porte sur elle que son cache-sexe. Le Rapport-Führer Schillinger (tout Birkenau connait le Rapport-Führer Schillinger, c’est le plus féroce des bandits) lui ordonne d’enlever son cache-sexe. La jeune artiste refuse. Schillinger s’approche d’elle pour le lui arracher. Alors il se passe quelque chose d’extraordinaire, mais d’authentique: d’un mouvement foudroyant la jeune femme s’empare du pistolet de Schillinger suspendu à sa ceinture et tue le misérable d’un seul coup avec sa propre arme. Dans la journée même tout le Lager apprend la mort de Schillinger et en fait une petite fête.
«Beaucoup de S.S. se découvrent de l’éloquence et s’estiment grands orateurs. Un «Transport» de condamnés vient d’entrer au Crématorium. Dans quelques minutes ils seront la proie des flammes. Un S.S. tient à leur faire un bref discours: «Là-bas, au loin, pendant des mois vous avez travaillé dur pour le bien et la grandeur du pays. La patrie reconnaissante vous doit une récompense. Dans cette Maison de Repos, spécialement construite pour vous, vous serez traités comme de véritables héros que vous êtes.»
«Cette rhétorique laisse l’assistance parfaitement froide; tous les visages sont placides. On ne souhaite qu’une chose: finir vite.
«Par étapes de quatre, cinq, six mois, parfois un peu plus, les cadres du Sonder Kommando sont rénovés. On se débarrasse des anciens ouvriers de la façon la plus simple: on les envoie eux-mêmes au four. Les gens du Sonder savent tous ce qui les attend. Pendant qu’ils lancent jour et nuit des centaines de milliers de cadavres dans le brasier ardent, qu’ils pilent sans relâche des os humains calcinés, ils fredonnent sans cesse des refrains circonstanciés faisant une claire allusion à leur sort inéluctable qui ne saurait tarder. Leur tour d’être brûlés et calcinés approche chaque jour de son échéance avec une évidence mathématique. Mais l’habitude est telle qu’ils continuent leur travail macabre avec des chants revenant automatiquement, comme une obsession.»
Chapitre XXVII {XXIX}. Les derniers Transports
Vers la fin Octobre 1944, les Allemands commencent l’évacuation de tous les camps de la région d’Auschwitz. Pressentent-ils une grande offensive russe? On se débarrasse la hâte d’un nombre considérable de jeunes femmes juives en les expédiant au four. Le reste des Juifs est envoyé dans les différents Lager d’Allemagne; non pas que ces derniers par une faveur spéciale soient destinés à survivre. Dans l’esprit des Nazis, dans les intentions de Himmler, il est bien arrêté que tous les Juifs doivent périr, à commencer naturellement par ceux qu’ils tiennent sous la main. Mais, dans le travail de destruction systématique des Juifs, la main d’œuvre étrangère ne doit pas intervenir; seuls des Juifs doivent fournir l’effort nécessaire à l’anéantissement de leur propre race; et il y a encore au moment de l’évacuation de Birkenau, éparpillés dans les innombrables camps allemands assez de Juifs nécessitant d’autres Juifs pour les exterminer.
Je suis expédié dans un camp de la région de Dantzig, à Stuthof. Les Russes avancent dans cette direction également; peu de jours après nous sommes transférés à l’extrémité opposée de l’Allemagne, Erchterdingen (Stuttgart) puis de là à Ordruf, près de Gotha en Thuringen. Tous ces déplacements se font dans des conditions déplorables. De nombreux prisonniers meurent de froid et de misère physiologique. Quand nous avons faim, nous nous nourrissons d’une poignée de neige dérobée par les interstices des wagons. Puis, finalement le 3 Avril 1945 commence le dernier acte notre tragique épopée. Vers 6h du soir, tous les Lagers dépendants d’Ordruf forment un «Transport» pour une destination inconnue. On entend nettement des coups de canon; la bataille ne doit pas être loin d’ici, on chuchote même que les Américains sont déjà à Erfurt et à Gotha à une vingtaine de kilomètres. Si on avait la chance d’être rejoints par eux! Pour la première fois depuis que nous sommes entre les mains des tigres, une lueur d’espoir apparaît dans esprit [sic]. La nuit ne tarde pas à venir; il fait une obscurité compacte. Le «Transport» prend un chemin de traverse dans les montagnes et les forêts de Thuringe.
Ce n’est pas une route, ce ne sont que des ornières, on patauge toute la nuit dans la boue, bousculés par les S.S., harcelés par les chiens. La journée suivante la marche continue, sans aucune halte. Chaque pas provoque des tiraillements douloureux des muscles des cuisses ; mais il n’y a pas moyen de s’arrêter, de se reposer pour reprendre des forces. Il faut marcher marcher continuellement. Devant moi, à quelques pas, je vois un interné effondré sur le bord de la route, épuisé. Il a les traits décomposés et on se rend tout de suite compte qu’il n’est plus capable d’avancer d’un seul pas. Mais, en même temps que lui, je vois un S.S. Il s’est planté devant lui ; il enlève tranquillement son fusil qu’il a épaulé par une courroie ; il place le bout du fusil à quelques centimètres seulement de la tête du malheureux et tire. Il exécute tous ces mouvements mécaniquement, comme s’il s’agissait simplement d’un exercice. Le pauvre diable meurt foudroyé, sans pousser un seul soupir. À Birkenau, j’ai vu des montagnes de cadavres ; j’ai été témoin et j’ai assisté au départ de milliers et de milliers de transportés aux gaz ; je pensais être réfractaire à toute émotion ; mais, l’impression causée par cet assassinat perpétré là, devant moi, méthodiquement, si froidement, est très forte. Le même jour et les jours suivants ces exécutions sommaires se répètent par milliers. Et les cœurs endurcis à longue à ce mode d’exécution aussi, nous finissons par rester insensibles devant la longue pile de cadavres sur la route.
Chez les Allemands, il y a des choses qui semblent aux non-Allemands illogiques et paradoxales. Tantôt ils nous font faire des marches forcées, sans aucune halte, en nous obligeant à parcourir presque au pas de course 60 kilomètres dans la journée ; tantôt ils nous font entrer dans la forêt pour y rester à la même place deux, trois jours durant. Puis la marche recommence, toujours pressée. Après Buchenwald, à Weimar ils nous font prendre le train. Nous couvrons environ 70 kilomètres en trois jours, puis nous continuons la marche. à pied. Plus loin sur un autre tronçon de quelques dizaines de kilomètres nous prenons encore le train. Trois jours plus tard, nous descendons à Dachau, pour compléter à pied le trajet allant de Ordruf (à 90 kilomètres de Weimar) jusqu’à Dachau. Partis d’Ordruf le 3 Avril, nous atteignons Dachau le 27 du mois.
A partir de Flossenburg, et durant une dizaine de jours, notre «Transport» ne reçoit aucune nourriture, aucune ration, Rarement, tous les deux ou trois jours, des paysans charitables distribuent quelques pommes de terre, presque crues. Beaucoup d’internés se sont habitués ne plus manger; ils n’ont plus aucune sensation de la faim. D’autres, croyant soutenir leurs forces, broutent de l’herbe Et par intervalles rapprochés les coups de feu crépitent et exterminent ceux de nos camarades qui ne peuvent plus se traîner.
La marche en colonne est entravée par le passage incessant de véhicules de toutes sortes emportant sur les routes des S.S. de marque en déroute qui fuient devant les Américains. Sans cesse la voix des S.S. hurle Aufgehn… rechte Hand… accompagnés de coups de bâtons. Continuellement les avions américains survolent les convois. Tant que nos avançons à pied, les aviateurs américains se rendant compte de notre identité de prisonniers nous laissent tranquilles. Mais, durant les deux courts trajets en train, nous subissons quatre attaques aériennes, avec comme résultat 150-200 tués chaque fois, sans compter les blessés. La nuit, si nous ne marchons pas, nous couchons dans une grange de village ; mais c’est rare. Le plus souvent nous nous étendons sur une prairie, nous dormons dans la boue sans aucune couverture. Parfois nous couchons sur les pavés humides de quelque grande ville. Nous traversons le Danube à Traubing. Enfin le 27 Avril au soir, nous arrivons à Dachau. La plus grande désillusion nous y attend. Nous pensions pouvoir nous y reposer durant quelques jours mais des signes nets de préparatifs d’évacuation de ce camp nous plongent dans le plus noir désespoir.
Tous mes camarades encore vivants et moi-même sommes incapables de continuer la marche ; et si l’on évacue Dachau, nous n’avons d’autre choix que de nous étendre sur la route et nous laisser tuer, comme tant d’autres milliers de nos camarades. Ainsi donc toutes nos souffrances de ces derniers jours, la faim, la soif, la pluie, les coups, les plaies aux pieds, tout a été inutile. Demain ou après-demain, si nous quittons Dachau, nous allons être presque tous exécutés.
Chapitre XXVIII {XXX}. La Libération
Le 29 Avril 1945, vers 17 heures, des chuchotements étranges circulent de bouche en bouche. On dit que les Américains sont tout près de Dachau et qu’on les y attend d’une minute à l’autre. Déjà, dit-on, les S.S. ont hissé des drapeaux blancs sur les miradors. Nous n’osons pas prêter foi à des nouvelles si sensationnelles et si réconfortantes. Malgré ma grande faiblesse, je me traîne hors du Block et je vois en effet des drapeaux blancs sur les miradors. Mais comment a-t-on pu avoir les autres nouvelles? Je n’en sais rien: c’est un fait que quelques heures avant l’entrée des Américains à Dachau, leur arrivée imminente y était connue. Les coups de canon et de mitraille augmentent graduellement d’intensité et de violence.
A 17h30 environ, un tonnerre formidable secoue toute la baraque, tout le camp. Des cris partant des milliers de poitrines vibrent dans l’atmosphère: voici les Américains, ils sont arrivés! Vivent les Alliés, à bas les S.S. Tous se précipitent dehors. Les portes ne suffisent plus, on fait sauter les fenêtres. Entraîné par la foule, je sors sur la route, et que vois-je? De l’autre côté des barbelés, les Américains sourient et mâchent leurs chewing gums. Les uns vont à pied; d’autres roulent sur des jeeps. Ils nous saluent amicalement. Nous leur devons la vie. Eux, semblent trouver tout naturel ce qu’ils ont fait pour nous! Au même instant, je vois se réaliser mon plus ardent souhait de la captivité. Durant mes deux années d’internement, plusieurs fois je me suis dit que je donnerais tout pour voir ces S.S. si orgueilleux tomber eux-mêmes prisonniers. Et que vois-je mon Dieu? Un groupe de S.S. les bras en l’air, est conduit par des Américains baillonnette au canon. Tous les internés réclament leur mort et les traitent de canailles, de misérables et de bandits. Moi-même je m’écrie: «la Providence a voulu que je vois des S.S. privés de leur liberté, maintenant je puis mourir tranquille».
Puis la foule se dirige vers la grande place du camp ; c’est un torrent fougueux, indomptable. Sur une tour de l’Appel-Platz, un chapelain américain se fait difficilement entendre. Enfin, le silence se fait. Dans une courte prière, le Chapelain rend grâce à Dieu, de nous avoir sauvés. Puis, on observe, pour les morts, une minute de silence. Les acclamations recommencent, délirantes. Instantanément le camp se couvre d’une quantité énorme de drapeaux alliés ; Américains, Russes, Anglais, Polonais, Français, Grecs, Belges, Hollandais, Tchèques, Yougoslaves, Espagnols, etc… Mais d’où a-t-on sorti tous ces drapeaux? C’est un mystère.
Les jours suivants, c’est une fête ininterrompue. Ils ont donc disparu à jamais les lugubres Aufstehn du matin, l’harassant Appel du soir ; les durs travaux de la journée, les coups sauvages des Capo, les pluies, la vermine, la gale, les Selections, le Crématorium!
Mais, hélas! nous les Israélites nous avons payé très cher le tribut de cette guerre. J’ignore un chiffre précis; mais on parle de plus de six millions de victimes juives de la fureur teutone.
De Grèce, partis plus de soixante mille, il ne reste de survivants que moins de deux mille. Il est encore tôt pour établir un compte exact.
Quant aux Israélites de ma ville, Didymotihon-Néa-Orestias, arrivés à Birkenau au nombre de mille soixante dix, nous ne sommes plus qu’une vingtaine. Jamais pareille catastrophe n’a été enregitrée dans l’histoire de l’humanité.
Et elle a été exécutée de propos délibéré, sans aucune provocation, sans raison aucune, froidement, méthodiquement, par un peuple qui hier encore se prétendait être à l’avant-garde de la civilisation! L’histoire seule sera juge de ce crime inqualifiable!…
DACHAU – AUSBURG {AUGSBURG}7 Juin-Juillet 1945
Epilogue
Tous les peuples se préparent fiévreusement à livrer la dernière bataille, la bataille de la paix. Tous, suivant leur importance et suivant leurs possibilités, mobilisent les moyens puissants dont dispose la technique moderne pour faire entendre leurs voix.
Presse, radio, propagande, représentations officielles et semi-officielles, ambassades: ordinaires et extraordinaires, tout, tout est mis à contribution pour l’ultime bataille. Et dans la balance des revendications les experts de chaque nation jetteront le poids éloquent de leurs pertes en vies humaines et en matériel, en villes détruites et en biens disparus, pertes subies du fait des attaques de l’Axe.
Les revendications du peuple juif, qui les faira-t-il [sic] valoir. Nous, nous ne disposons ni de presse, ni de radio, ni de propagande, ni de représentations. Nous, nous n’avons pas la voix internationale, notre nation est muette. Et, d’abord, que fera-t-on pour éviter à l’avenir la répétition d’un crime aussi formidable que l’assassinat de sept millions de personnes avec préméditation coupable et sans justification aucune? Je sais qu’il y a un Etat Palestinien, mais j’ignore dans quelle mesure cet Etat est qualifié pour défendre la cause des Juifs. Mais ici je ne parle pas de «Palestine», je parle d’un autre Etat Juif. Y a-t-il donc un autre Etat Juif? Mais a-t-on la mémoire si courte pour qu’on puisse déjà oublier les déclarations de l’Allemagne nazie faites par la bouche du Dr. Goebbels peu de temps encore avant la fin de la guerre?: «L’Allemagne ne s’oppose pas à la création d’un Etat Juif, mais en dehors de la Palestine».
Lorsque Goebbels faisait cette déclaration, l’œuvre d’extermination de 6 à 7 millions de Juifs touchait à sa fin, et l’Etat Juif des Nazis, il faut sans doute le chercher dans le ciel polonais au-dessus des cheminées fumantes des Crématoria de Birkenau, de Treblinka, et de Lublin [Maïdanek] où se tiennent toujours suspendues les âmes de 6 à 7 millions des nôtres. Et nous, les cent mille rescapés des camps allemands, nous sommes en définitive les émigrés de cette nouvelle patrie juive, formant en quelque sorte une nouvelle Diaspora.
Il faut avouer que Goebbels ne manquait pas d’humour, humour nazi naturellement.
C’est de ces Juifs que je parle, des Juifs dont on a assassiné tous les parents en Pologne, dont les Allemands ont tout pillé, et qui rentrent chez eux, nus comme un ver. Ils appartiennent à toutes les nationalités de l’Europe: Juifs polonais, hongrois, norvégiens, allemands, autrichiens, hollandais, belges, français, grecs, yougoslaves, tchèques, roumains, etc… On peut supposer que chaque nation, dans sa liste des revendications, voudra aussi inclure les réparations de ses nationaux Israélites. Mauvaise solution, ou plutôt solution aucune. Car, nul n’ignore que chaque nation a des intérêts extrêmement importants à défendre, intérêts touchant à l’avenir même de la nation. Il est naturel qu’on défende les intérêts permanents et qu’on néglige ceux de tels ou tels individus pris isolément ou même en bloc. De plus, les Israélites dispersés dans tous les Etats de l’Europe sont maintenant si peu nombreux, qu’on peut les considérer comme une quantité négligeable, et par conséquent, il n’est pas nécessaire qu’on s’occupe d’eux
J’ignore totalement s’il existe ou non des Organisations juives qui revendiquent des réparations pour les juifs et jusqu’où vont s’étendre ces réparations. Je suis un Juif moyen et j’émets mon idée personnelle. Il faut que les Allemands remboursent les Juifs au comptant et en or, jusqu’à concurrence de ce que chaque Juif possédait avant la guerre. Les Allemands ont eu d’ailleurs soin de rendre cette opération extrêmement facile: quoi de plus aisé d’indemniser cent ou cent cinquante mille survivants quand on a assassiné 6-7 millions? L’or? Les Allemands le possèdent; ils ont pillé la presque totalité des Juifs de l’Europe, qu’ils transportèrent dans les camps de concentration sans nombre. Pour peu qu’on veuille se donner la peine d’une enquête auprès des Capos du Canada et du Sonder Kommando, après des Tatas, des Lager-Führer et des Block-Führer de Birkenau par exemple, on en sera vite convaincu.
C’était un formidable trafic quotidien de métal jaune et de pierres précieuses. Et tout cela ne provenait que de ce que les Capos pouvaient voler sous l’œil inquisiteur et expert de l’S.S. qui assistait au contrôle ; ce n’était donc qu’une insignifiante partie des richesses des Juifs ; comme on dirait les reliefs d’un banquet copieux dont les plats de résistance étaient dévorés par les requins de Berlin. Il existe donc en Allemagne actuelle plusieurs dizaines de millions de livres or provenant des Juifs. Faut-il aussi calculer les biens, les magasins, les fabriques des Juifs. Ce sont des chiffres vertigineux…
Je suis au courant de la vieille tactique allemande qui consiste à pousser des hauts cris, de prétendre qu’on les assassine qu’on les égorge dès qu’on leur demande de réparer. Cette méthode leur a réussi si bien après la première guerre générale, que de Plan en Plan, et de Réduction en Réduction, on a finalement abouti aux Réparations et aux Crédits gelés, c’est-à-dire à zéro, et à tracer tout simplement une barre rouge sur les dettes allemandes. Et maintenant que les Allemands ont si bien assimilé les enseignements de Goebbels pour qui le mensonge, le parjure et la mauvaise foi étaient d’un usage courant et si correct, il n’y a aucun doute que les Allemands prendront le ciel et la terre à témoin de leur incapacité de payer. Mais j’espère que les Alliés, profitant de l’amère expérience de l’autre guerre, seront cette fois plus prudents. Du reste, je l’ai dit, tout l’or juif de l’Europe est actuellement en Allemagne. Les Alliés ont le moyen de le reprendre ; et dans la répartition des réparations, je suppose que les Juifs auront la priorité.
J’admets qu’il se trouverait peut-être des personnalités… mettons bien intentionnées, qui plaignant la misère du pauvre peuple allemand, s’élèveront dans une campagne enflammée contre ceux qui, soi-disant, veulent introduire et perpétuer le paupérisme dans les masses allemandes. Mais il est bon de déclarer dès maintenant que nous ne réclamons que ce que les Allemands nous ont volé. Et puis, je me demande si ces personnalités… bien intentionnées auraient vu naître et grandir en elles une sympathie si profonde pour le peuple allemand, si, comme nous, elles avaient assisté à l’assassinat par les Allemands de tous les membres de leurs familles…
Si dans une conférence des Grands, on la curiosité de faire une petite expérience, si on consacre une minute de silence à la mémoire des morts de la guerre, si alors on ferme les yeux et l’on fait un effort de l’imagination pour voir ces morts comme dans un film cinématographique, aucun doute que dans ce colossal défilé, les morts juifs seront à la place d’honneur. On assistera au défilé de la phalange interminable des morts Juifs, jeunes et vieux, hommes et femmes, tous pêle-mêle ; des juifs pauvres et crasseux portant papillotes, jusqu’aux fiers et riches banquiers juifs occidentaux, modèles de raffinerie et d’élégance ; des Juifs croupissant dans l’ignorance et la superstition, jusqu’aux Juifs allant à l’avant-garde du progrès et possédant les secrets les plus mystérieux de la science dont toute l’humanité a largement bénéficié ; des vieux épuisés ayant déjà un pied dans la tombe ; jusqu’aux plus jeunes, aux boules blondes, aux yeux flamboyants, aux joues potelées et roses, respirant de toutes leurs petites personnes la joie de vivre… Mais voilà qu’un S.S. survient, il lance rapidement et sans hésiter un petit flacon ; instantanément, sur les millions de figures tout-à-l’heure souriantes, apparait dans une convulsion effroyable la grimace atroce de l’agonie et l’horreur de la mort…
Il se peut que certaines gens puissent se dire: que viennent maintenant réclamer ces Juifs? De leur propre aveu, n’ont-ils pas souffert tous les martyrs dans les camps allemands? Ne mouraient-ils pas tous les jours sous les coups, le travail, le froid, la faim, les Crematoria? Ne leur suffit-il pas qu’on les ait retirés de cet enfer et qu’ils se sentent libres maintenant? C’est que là-bas, dans les camps, il s’agissait de mourir, tandis que maintenant il s’agit de vivre. Si on nous abandonne à notre sort; sans aucun secours, sans aucune réparation, nus comme nous sommes, c’est donc qu’on souhaite notre mort? Mais, il n’est pas possible qu’on souhaite notre mort. Car, nous, nos fils, les fils de nos fils, dans un avenir lointain et lorsque le passé se sera tassé et effacé, nous serons les témoins uniques, les témoins vivants et éternels de la barbarie nazie. Et lorsque dans cinq cents, mille, deux mille ans, le monde se sera enfin civilisé, les Allemands pourront enseigner l’Histoire dans leurs écoles:
— Autrefois les Allemands s’appelaient les Boches ; c’était un peuple barbare. Entre autres barbaries, une de leurs plus monstrueuses, leur plus monstrueuse a été de s’attaquer à un petit peuple sans défense, sans provocation aucune de sa part, sans même que ce petit peuple eût une haine particulière contre les Boches. Ils s’emparaient à l’improviste de toutes les familles, les enfermaient dans des petites boîtes roulantes qu’on appelait wagons de chemin de fer, et les expédiaient vers une destination inconnue, distante de trois mille kilomètres de leur point de départ (ce qui pour cette époque était énorme) «Arrivés à destination au bout de dix jours, les pauvres gens avaient à peine eu le temps de détendre les jambes engourdies par l’immobilité qu’on les envoyait dans les usines que le Allemands appelaient «Crématoria» où tous les voyageurs étaient immédiatement mis à mort!
«Enfants, les gens que vous voyez, sont justement les descendants des cent mille Juifs échappés par miracle au massacre de sept millions de leurs pères assassinés par nos aïeux les Boches…».
Sources
Le texte est conforme à l’édition originale de 1948 (Dr. M. Nahon, Birkenau, le Camp de la Mort, Istanbul: Kağıt ve Basım İşleri A.Ş, 1948, 76 p.) qui rend publique la plus grande partie du récit rédigé par Marco Nahon en juin et juillet 1945 en Allemagne, complété de son épilogue rédigé à Athènes en septembre 1945, et au tapuscrit original pour les parties manquantes dont nous disposons. La version imprimée a fait l’objet d’une réédition en 1992 au sein d’un volume incluant le récit de l’expérience de Elie Jaffé recueillie et publiée par David Benbassat-Benby une première fois en 1945, Je reviens du Camp de Bergen-Belsen, en Turquie (à Istanbul, par Gözlem Gazetecilik Basin ve Yayin A.S.). Cette édition inclut une préface inédite de David Benbassat-Benby. Une traduction en anglais, complète, à partir du tapuscrit original, et non de la version française publiée en 1948, est parue en 1989 (Marco Nahon, Birkenau: Camp of Death, traduction Jacqueline Havaux Bowers, édité par Steven Bowman, University of Alabama Press, 1989). Si elle n’est pas la première version publiée, ce fut longtemps la seule version complète (compte non tenu de la publication en Grec de 1945). L’ouvrage de 1989 propose des compléments bibliographiques importants dont nous avons repris certains éléments pour notre introduction.
La liasse tapuscrite originale est conservée dans les archives de Yad Vashem (initialement sous la cote manuscrite 2o 82-826). C’est le feuillet titre de ce tapuscrit original qui est partiellement montré en haut de la présente page.
Bibliographie & liens…
- Rena Molho, «La politique de l’Allemagne contre les juifs de Grèce. L’extermination de la communauté juive de Salonique (1941-1944)», Revue d’Histoire de la Shoah, 2006/2 (no 185), En ligne…
- Steven Bowman, The Agony of Greek Jews, 1940–1945, Stanford: Stanford University Press, 2009. Ouvrage de référence sur l’histoire des Juifs grecs pendant la Seconde Guerre Mondiale.
- Steven Bowman, The Holocaust in Salonika: Eyewitness Account, New York: Sephardic House, 2002.
- Rebecca Camhi Fromer, The Holocaust Odyssey of Daniel Bennahmias, Sonderkommando, Tuscaloosa: The University of Alabama Press, 1993.
- Giorgos Antoniou & A. Dirk Moses (éd.), The Holocaust in Greece, Cambridge University Press, 2018.
- Le fils de Haïm Nahon a donné des entretiens enregistrés. Ils sont en ligne sur le site de l'USHMM… (nous en avons tiré plusieurs précisions qui figurent sur la présente page).
Notes de PHDN
1. L’épisode est rapporté antérieurement par le Sonderkommando Zalmen Gradowski dans son second manuscrit rédigé au printemps 1944, enterré et retrouvé après la guerre (voir Zalmen Gradowski, Au coeur de l'enfer: document écrit d'un Sonderkommando d'Auschwitz-1944, Kimé, 2001, p. 155. Une édition plus complète, chez le même éditeur est parue en 2013 sous le titre Écrits I et II: témoignage d’un Sonderkommando d'Auschwitz, dirigée comme la première par Philippe Mesnard). Il apparaît également dans un rapport secret soviétique sur Auschwitz daté du 31 août 1944 (en ligne…). Un autre Sonderkommando, Alter Feinsilber (Fajnzylberg / Samuel Jankowski), relate la même anecdote dès ses témoignages d’après-guerre, notamment en 1947. Sur la place et la signification de cet acte dans l’histoire et les récits des survivants, voir Kirsty Chatwood, «Schillinger and the Dancer. Representing Agency and Sexual Violence in Holocaust Testimonies», dans Sonja M. Hedgepeth and Rochelle G. Saidel (éds.), Sexual Violence against Jewish Women during the Holocaust, Waltham, Massachusetts: Brandeis University Press, 2010 ainsi que Nicholas Chare and Dominic Williams, The Auschwitz Sonderkommando. Testimonies, Histories, Representations, Palgrave Macmillan, 2019, surtout le chapitre 2.
2. La majorité des Juifs de Grèce seront acheminés à Auschwitz-Birkenau, du point de vue nazi effectivement situé en Allemagne puisque dans une région annexée au «Grand Reich». Toutefois, les historiens considèrent que Auschwitz-Birkenau est situé en Pologne.
3. Nous avons ici corrigé une coquille évidente dans l’original, «le plus sûr».
4. Il s’agit évidemment des élèves du lycée.
5. A Birkenau, les principales chambres à gaz faisaient partie des quatre immenses crématoires qui y avaient été construits en 1942/1943: les cadavres des personnes assassinées se trouvaient donc sur le lieu même de leur destruction. Marco Nahon utilise ici l’expression «four crématoire» par métonymie avec les chambres à gaz, une évidence pour tout esclave concentrationnaire ayant connu Birkenau.
6. Signalons que les historiens utilisent depuis longtemps une autre numérotation pour les crématoires, en réservant le numéro 1 à celui du camp principal à Auschwitz I, qui abrita également une chambre à gaz de la fin de l'été 1941 à fin 1942. Les quatre crématoires géants de Birkenau sont donc numérotés de 2 à 5, une numérotation en chiffres romains étant le plus souvent utilisée (I à Auschwitz I, II à V à Birkenau). Par ailleurs, Marco Nahon commet une erreur: les deux grands crématoires, 1 et 2 (II et III chez les historiens), avec une cheminée chacun (et une chambre à gaz en sous-sol) sont d’achèvement contemporain aux deux autres plus petits, 3 et 4 (IV et V chez les historiens), à deux cheminées chacun (Marco Nahon est d’ailleurs parfaitement fiable sur ces distinctions architecturales). Ils ont tous été achevés entre mars et juin 1943 (II et IV en mars, V en avril, III en juin). Par ailleurs, le récit que s’apprête à rapporter Marco Nahon dans les passages qui suivent, celui d’un Sonderkommando confié à un ami de Nahon qui le lui rapporte, contient quelques imprécisions sans gravité (sans qu’on puisse savoir si c’est la relation de Marco Nahon lui-même ou celle de son ami auquel le Sonderkommando s'est confié, qui en est à l’origine). La description des gazages et des incinérations qui les suivent, telle que rapportée par Marco Nahon ramasse les processus à l’œuvre dans les crématoires II et III d’une part (seuls munis de ventilations et de monte-charge) et dans les crématoires IV et V dans lesquels le Zyklon B (produit dont se dégageait l’acide cyanhydrique gazeux mortel pour l’homme) était en effet versé par des «fenêtres» latérale, d’autre part. Par ailleurs, il ne s’agit pas de «bouteilles» ni de «bonbonnes», mais de boîtes hermétiquement fermées contenant les granulés de Zyklon B imprégnés d’acide cyanhydrique, qu’on versait dans les chambres à gaz. Ces erreurs vénielles n’entachent évidemment en rien un récit d’une grande précision par ailleurs. L’utilisation de monte-charges dans les crématoires II et III est aujourd’hui bien connue, de même que les modalités d’introduction du Zyklon B par des fenêtres latérales dans les crématoires IV et V. La mention de ces informations, même mêlées de façon erronée, signe la qualité du récit rapporté par Marco Nahon.
7. Il y a bien ici une coquille dans le texte imprimé. La ville (et un sous-camp de Dachau) n'est pas «Ausburg» mais «AuGsburg». Le tapuscrit original mentionne correctement «Augsburg».

