De Moscou à Beyrouth
Essai sur la désinformation
Léon Poliakov
© Calmann-Lévy — Léon Poliakov 1983 — Reproduction interdite sauf pour usage personnel —No reproduction except for personal use only
Sommaire
Présentation de la version web
L’ouvrage de Léon Poliakov, paru en 1983 chez Calmann-Lévy, succède et complète son précédent De l'Antisionisme à l’Antisémitisme, paru en 1969. Voici un passage de la présentation de l’éditeur:
«Lors de l’été 1982, l’engagemement d’Israël au Liban et les crimes qui lui furent alors reprochés suscitèrent de violentes réactions au sein de l’opinion occidentale. Israël se vit accusé, par les mass-média, de génocide à l’égard du peuple palestinien et ses actes se trouvèrent comparés à ceux des nazis. Dans la presse des pays socialistes comme dans celle des pays arabes, ce genre d’assimilation est monnaie courante depuis la création de l’Etat d’Israël. En Occident, en revanche, comme le montre Léon Poliakov qui étudie surtout ici le cas de la France, une telle entreprise de désinformation a des racines plus profondes. […] mai 1968 vit une partie de la jeunesse s’enthousiasmer pour les luttes révolutionnaires du tiers monde, plaçant l’O.L.P. sur le même piédestal romantique que le vietnam. La puissance des propagandes soviétique et arabe, relayées de multiples façons à travers le monde entier, fit le reste pour compromettre Israël à l’échelle internationale, et en faire «le Juif des nations». À travers la violence de l’explosion anti-israélienne de l’été 1982, c’est, par le biais de désinformation, à un relâchement des censures qui entouraient l’antisémitisme depuis les persécutions hitlériennes que l’on a en fait assisté. Cet ouvrage de Léon Poliakov, qui se montre aussi brillant polémiste qu’analyste subtil, permet de prendre conscience, avec quelque recul, de ce que dissimulent les passions de l’été 1982.»
Compte tenu d’une actualité (en 2023) qui voit se reproduire la configuration rhétorique et médiatique de ce début des années 1980, la mise en ligne des analyses et faits apportés par Léon Poliakov offre une profondeur historique urgente et indispensable aux discours qui se déploient dans le monde entier et aux conséquences délétères qui ne manqueront pas d’en découler. Nous présentons l’ouvrage en une seule page web. La numérotation des notes est propre à la présente version (la version papier présente les notes en bas de page, la numérotation reprenant à chaque page). L’avant-propos comporte une répétition (de «Du fait de la disparité notoire» à «s'allumèrent en [été] 1982» pages 11 et 12) que nous avons laissée telle quelle. Nous avons apporté de nombreux ajustements typographiques par rapport à la version imprimée, afin d’améliorer la lisibilité du texte à l’écran. Le lecteur est vivement encouragé à en acheter la version papier qui est disponible et permet une lecture plus pratique et confortable. Cette lecture est à compléter par un premier ouvrage de Léon Poliakov, De l'Antisionisme à l’Antisémitisme, Paris: Calmann-Lévy, 1969.
Avant-Propos
L’entrée de l’armée israélienne au Liban, au début de juin 1982, suscita d’emblée une vive indignation dans la presse française écrite. Quant à la télévision, le choix des images, mais surtout la violence de certains commentaires, sont encore présents, je le suppose, à la mémoire de tous. Les antisémites français, et il en existe encore, étaient à la fête. La presse juive (survoltée par ailleurs par une série d’attentats commis ou inspirés par l’O.L.P. à Paris même) s’employa, avec la passion qu’on devine, à défendre l’État juif. Mais elle ne pesait pas lourd et elle n’eut que peu d’alliés. Un certain nombre d’organes, il faut le reconnaître, s’efforcèrent de rester fidèles à la déontologie professionnelle, c’est-à-dire au respect de la vérité. Il n’y alla pas de leur faute s’ils succombèrent eux aussi, surtout au début, au flot de désinformation qui, venant de Beyrouth-Ouest, était répercuté à travers le monde entier par les agences de presse et les équipes de télévision. Par contre, certains journaux dits de gauche ou simplement avides de sensations multiplièrent les invectives et parlèrent même d’un génocide, en se fondant sur les chiffres diffusés par l’O.L.P.: plusieurs dizaines de milliers de tués et de blessés au sein de la population civile, 600 000-700 000 réfugiés libanais errant sur les routes. La propagante israélienne, plus timide, mais surtout démunie des haut-parleurs (soviétiques, arabes, etc.) dont disposait l’O.L.P., restait pratiquement inaudible. L’Humanité put s’en donner à cœur joie. En conséquence, Beyrouth-Ouest se vit couramment comparé au ghetto de Varsovie, et les Israéliens, aux nazis.
Or, il importe de savoir que ce n’est pas en France que le ton monta le plus haut. Il s’en faut. On peut même dire que cette campagne de désinformation fut universelle. Parmi les pays qui bénéficient d’une information libre, c’est assurément à la Grèce que revient la palme, suivie par l’Espagne et l’Allemagne de l’Ouest, à propos de laquelle on se reportera à l’étude du Dr Rudolf Pfisterer, à la fin de ce livre. Mais en Italie aussi, l’indignation fut plus forte et s’exprima sous des formes plus militantes qu’en France. La presse et les mass media des pays anglo-saxons ajoutèrent également leur voix au concert, à cette différence près que, de bonne heure, ils se livrèrent à une sorte d’examen de conscience. Aux États-Unis, la revue libérale The New Republic annonçait dès le 2 août 1982 qu’elle avait été induite en erreur, et ses révélations sur le processus de la désinformation firent boule de neige. À la cadence près, les Britanniques suivirent le même chemin.
Pour en revenir à la France, le principal clivage opposait, plutôt que la gauche à la droite, l’intelligentsia aux Français moyens, qui, dans leur ensemble, ne portaient à cette agitation qu’un intérêt relatif, ou même se révélaient des amis indéfectibles de l’État d’Israël. Ce clivage est ancien: songeons à la séparation entre les clercs et le peuple, prolongée par l’opposition entre les élites et les masses. À la veille de l’avènement du IIIe Reich, Albert Einstein déplorait la vulnérabilité de la caste intellectuelle à la contagion du papier imprimé (voir sa lettre à Freud, 20-7-1932. Leur correspondance portait sur les moyens de tous ordres qui pourraient contribuer à les préserver de la paix…).
En 1982, comment en est-on venu là? Le but du présent essai est d’examiner les racines historiques, proches ou lointaines, d’une campagne à propos de laquelle des auteurs — dont tous n’étaient pas juifs — ont parlé bien à la légère d’une résurgence de l’antisémitisme français d’antan. Mais l’entreprise était autrement vaste. Et d’abord, était-on contre les Juifs ou pour les Arabes? En 1975-1976, lorsque l’O.L.P. s’empara de vive force d’une partie du Liban et y fit régner la terreur, on ne se soucia guère de la cause des chrétiens. Les sympathies des mass media allaient par excellence au camp «islamoprogressiste», et déjà, ce vent soufflait aussi bien de Moscou que de La Mecque; il s’agissait donc d’une convergence entre deux Églises dogmatiques qui se combattent sur tant de fronts, mais qui ont aussi en commun l’égale conviction que le temps travaille pour elles.
Ainsi, les facteurs des passions de l’été 1982 sont multiples. L’un d’eux remonte à des millénaires, et comme de nos jours on l’ignore ou on l’oublie, j’ai tenu à résumer dans un chapitre introductif les résultats de vingt années de recherches1. Les autres remontent à 1945-1948, lorsque s’est enclenché le drame actuel. Dans son évolution Moscou a joué un rôle primordial, qu’il convenait de décrire avec précision, phase par phase. Il en va de même pour la propagande et les objectifs des États arabes, sur le fond des guerres successives qui les ont opposés à l’État juif. Du fait de la disparité notoire des moyens ou richesses de tous ordres, du bouleversement de l’échiquier mondial et de l’éclipse de l’Europe, le petit État, porté jadis sur les fonts baptismaux par les Nations-Unies, est devenu le Juif des nations. Dans le cas de l’Occident, la désinformation a surtout exercé ses ravages parmi les générations montantes, celles pour lesquelles les crimes nazis n’étaient qu’un mythe, douteux ou controuvé pour certains, agaçant pour beaucoup d’autres. C’est à travers cette histoire de notre temps que je conduirai mon récit jusqu’aux passions qui s’allumèrent en 1982.
Un mot encore: il est évident qu’une injustice suprême a été infligée en 1948 au peuple palestinien et que, depuis, son sort, resté en suspens, est dramatique. Sans doute l’eût-il été moins si tant d’États ou d’instances — les puissances arabes, l’O.L.P., les Nations-Unies, Moscou et ses satellites, un secteur de l’intelligentsia occidentale — voire le Vatican — ne s’étaient arrogé le droit de parler directement ou indirectement en son nom. Cette sollicitude ne s’est étendue ni aux Kurdes, ni aux Afghans, ni aux dernières tribus de l’Amazonie. À peine aux Cambodgiens… La liste serait longue. En évoquant le destin des Palestiniens, on ne saurait oublier cet arrière-plan.
Du fait de la disparité notoire des moyens ou richesses de tous ordres, du bouleversement de l’échiquier mondial et de l’éclipse de l’Europe, le petit État, porté jadis sur les fonts baptismaux par les Nations-Unies, devint le Juif des nations. Dans le cas de l’Occident, la désinformation a surtout exercé ses ravages parmi les générations montantes, celles pour lesquelles les crimes nazis n’étaient qu’un mythe, douteux ou controuvé pour certains, agaçant pour beaucoup d’autres. C’est à travers cette histoire de notre temps que je conduirai mon récit jusqu’aux passions qui s’allumèrent en été 1982. Je n’y traiterai que marginalement du problème des Palestiniens, dont la dispersion s’étend actuellement du golfe Persique aux États-Unis. En effet, ce problème, avec toutes ses ramifications internationales, éthiques ou politiques, économiques ou militaires, n’aurait pu être convenablement traité que dans un ouvrage de fond.
Pour conclure, je me limiterai à une brève remarque. Il est de fait qu’une injustice suprême a été infligée en 1948 au peuple palestinien, et que depuis, son sort, resté en suspens, est dramatique. Sans doute l’eût-il été moins si tant d’États et d’instances — les puissances arabes, l’O.L.P., les Nations-Unies, Moscou et ses satellites, un secteur de l’intelligentsia occidentale, voire les Églises chrétiennes — ne s’étaient arrogé le droit de parler directement ou indirectement en son nom. Cette sollicitude ne s’est étendue ni aux Kurdes, ni aux Afghans, ni aux dernières tribus de l’Amazonie. À peine aux Cambodgiens… La liste serait longue. En songeant au destin des Palestiniens, on ne saurait oublier cet arrière-plan..
Chapitre premier De l’antisémitisme
Les Juifs ont de tout temps stimulé l’imagination des peuples environnants, suscité des mythes, le plus souvent malveillants, une «désinformation» au sens large du terme. Ces affabulations, dont l’Europe médiévale fut le principal théâtre, y ont de nos jours sombré dans l’oubli (du moins sous leur forme première), tout en étant repris, de la façon qu’on verra, dans les pays dits socialistes ou à travers le tiers monde. Avant d’entrer dans le vif du sujet, un rapide survol de l’antisémitisme occidental des siècles passés semble donc nécessaire.
Il importe d’abord de savoir que depuis la naissance et la diffusion du christianisme, la relation entre Juifs et chrétiens est marquée par une asymétrie fondamentale. Héritière d’une révélation sans laquelle la foi chrétienne eût reposé sur du vide, l’Église restait tributaire de la pensée hébraïque et la révérait en conséquence, mais les Juifs en chair et en os, dépourvus de toute capacité politique, «arrachés de leurs pays, exterminés et dispersés dans l’univers» (saint Augustin), constituaient au sein de la chrétienté médiévale une puissance négligeable. Inversement, pour la Synagogue, les chrétiens auraient pu aussi bien ne pas exister — ses écritures sacrées n’en auraient pas été modifiées d’un iota — cependant que dans la vie réelle et quotidienne, le sort des Juifs dépendait pour ainsi dire à chaque pas de l’humeur ou des dispositions des pouvoirs chrétiens (sans parler des éruptions de colère populaire contre la «race déicide»). On ne saurait dire que cette asymétrie ait épuisé tous ses effets: ceux-ci persistent et, sous nos yeux, affectent de manières diverses les sensibilités, voire les idéologies, même si la notion de «chrétien» et, à plus forte raison, de «juif» prête le flanc de nos jours, où les choses évoluent autrement vite que les mots, à bien des confusions.
Aux origines, aux temps d’Augustin et de Grégoire le Grand, l’asymétrie a sans doute assuré la survie des Juifs, «peuple témoin» au sein d’une chrétienté monolithique, car ils devinrent alors les seuls infidèles officiellement tolérés en Europe; et si, «coupables du plus grand crime de tous les temps», ils étaient tenus dans «une servitude perpétuelle2», leur existence, pour humiliante, incertaine et angoissante qu’elle fût, n’en bénéficiait pas moins d’un équivoque privilège. C’est que, conformément à une définition canonique, «être juif est un délit, non punissable cependant que le chrétien, contrairement au cas de l’hérétique3». Sans entrer plus avant dans ce sujet, remarquons simplement que «qui peut le plus, peut le moins»: la licence de prêter impunément à usure (de «faire le juif») ne fut pas la seule prérogative des fidèles de Moïse; les prélats, conformément à une tradition bien établie du Saint-Siège, protégeaient souvent, en même temps que leur vie, le libre exercice de leur culte, ou même engageaient des controverses publiques avec les rabbins — pour mieux les humilier. L’Espagne, tant qu’elle fut partagée entre l’islam et le christianisme, constitua un cas à part, un havre; ailleurs, les Juifs furent, tout au long du Moyen Age, ballottés de pays en pays, à l’occasion pieusement massacrés, méprisés et détestés, et l’on peut conclure avec Érasme: «S’il est d’un bon chrétien de détester les Juifs, alors nous sommes tous de bons chrétiens.» L’humaniste ironisait sur l’opinion communément admise, et reflétée par la langue4; qu’une telle adversité singularisait à outrance un groupe humain, sûr par ailleurs de détenir l’ultime vérité, se passe de commentaire.
L’aube des Temps modernes n’apporta pas de grands changements à la condition des Juifs européens (si ce n’est dans la péninsule Ibérique). Mais certains points sont à signaler. D’abord, le début d’un confusionnisme sémantique: à l’époque où s’ébauchent dans la chrétienté de nouvelles notions séparatrices, telles que «confession», ou «nation», bientôt suivies de «race», on ne sait trop à quelle catégorie se rapportent les Juifs; le plus souvent, on tend à voir en eux une «nation transnationale». Puis, des aires se dessinent, plus ou moins hospitalières à cette nation errante: tandis que la catholicité s’en tient, dans les grandes lignes, aux errements anciens, on note un certain revirement d’inspiration calviniste ou sectaire, auquel s’oppose la dureté théologique luthérienne. La sainte Russie, pour sa part, à peine libérée du joug mongol, expulse et condamne à tout jamais les ennemis du Christ. Enfin, un phénomène d’origine d’ailleurs ancienne, le marranisme espagnol, se précise: des dizaines de milliers de Juifs, baptisés le plus souvent contre leur gré, s’accoutument à vivre sous le masque chrétien et s’initient à la culture chrétienne: ils sont donc fertilisés par deux traditions et cette hybridation, qui en vient à produire un Spinoza ou un Montaigne, suscite aussi l’aspiration à un État juif; une colonisation s’esquisse en Galilée. Car la tradition rabbinique de l’exil, elle, considère désormais le pouvoir étatique comme une «affaire de goyim»: si, de siècle en siècle, d’innombrables pèlerins se rendaient en Erets Israël, c’était pour y prier et y mourir, non pour y fonder un État, en attendant que l’Éternel, apitoyé par les malheurs de son peuple, entende ses prières et lui envoie le Messie libérateur. Les ferveurs de cette attente ont d’ailleurs, de tout temps, suscité des imposteurs, et l’accueil fait dans la seconde moitié du XVIIe siècle par l’ensemble de la diaspora au plus célèbre de tous, Sabbataï Zevi, donne la mesure de la détresse juive, après l’expulsion d’Espagne et les grands massacres de Pologne.
La grandiose révolution des Lumières, qui coïncide avec l’une des périodes les plus tragiques de l’histoire juive, marque l’avènement d’une ère nouvelle. Les grandes figures de proue (nous nous limiterons ici à celles de la France) débattent plus que jamais du cas de cette nation barbare, d’autant que sa fonction de témoin acquiert une dimension supplémentaire: pour les déistes et autres esprits éclairés, les Juifs deviennent les grands témoins des erreurs de la religion établie. Mais, dans le détail quelle variété de jugements! À la parfaite équité de Montesquieu, à la commisération admirative de Rousseau, ou encore à la salutaire impassibilité de Diderot, s’opposent les fureurs, déjà typiquement antisémites, de Voltaire: plutôt que d’en offrir un florilège, citons son jeune commensal, Charles-Joseph de Ligne, qui, non sans un grain de sel voltairien, plaidait la cause de l’émancipation des Juifs:
«Et les Israélites enfin, en attendant les décrets impénétrables de la Providence sur leur endurcissement dans le genre des torts de leurs aïeux, seront au moins dans ce monde-ci heureux, utiles, et cesseront d’être le peuple le plus vilain de la terre. Je conçois très bien l’origine de l’horreur qu’inspirent les Juifs, mais il est temps que cela finisse. Une colère de mille huit cents ans me paraît avoir duré assez longtemps!»
Le prince de Ligne, qui connaissait son Europe sur le bout des doigts, n’ignorait pas qu’à Amsterdam ou à Bordeaux, les «Juifs portugais», c’est-à-dire, les ex-Marranes, vivaient désormais, s’ils étaient suffisamment riches, sur un pied d’égalité avec les seigneurs chrétiens. Il avait en vue les misérables «Juifs tudesques», encore que certains tendaient à se hisser à des hauteurs semblables et que surgissait à Berlin le premier philosophe moderne de souche tudesque, Moïse Mendelssohn. Les relations, philosophiques et autres, contribuèrent à l’émergence, dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, d’une nouvelle vision théo-politique impliquant un transfert des responsabilités: le séculaire avilissement des «Tudesques» ne serait nullement dû à leurs pratiques, aux sornettes du Talmud et encore moins aux décrets de la Providence; il serait imputable aux superstitions et mauvais traitements du monde chrétien environnant. En conséquence, ne faudrait-il pas les aider à se régénérer? Car les premiers émancipateurs restent d’accord sur la gravité de leurs tares actuelles (avec des exceptions de faveur pour ceux qui sont suffisamment riches5: ils sont «une nation dégénérée à qui ni la gloire, ni l’honneur, ni rien de tout ce qui flatte le cœur de l’homme ne peut appartenir», comme s’exclamait l’historien Lacretelle, un de leurs premiers avocats.
C’est dans ces conditions que l’émancipation des Juifs, déjà projetée par Louis XVI et son ministre Malesherbes, est votée par la Constituante en 1790-1791. Elle est beaucoup plus facilement acquise pour les «Portugais» que pour les «Tudesques», ce qui se comprend d’autant mieux que ces derniers, dans leur majorité, sont hostiles à la rupture avec le mode de vie et les traditions ancestrales; mais ils s’y soumettent avec obéissance, respectueux du grand principe talmudique: «La loi du pays est “ta” loi6.»
D’autre part, il est intéressant et instructif de noter qu’au cours de la tourmente révolutionnaire, les Juifs en leur ensemble paraissent se départir de toute la gamme de leurs rôles symboliques. De sorte que les émigrés, qui à Londres et ailleurs multiplient les interprétations démonologiques de la Révolution, ne pensent même pas à les citer comme fauteurs, aux côtés des francs-maçons, des philosophes, voire des protestants. Toutefois, cette éclipse ne dure guère; dès 1807, ils acquièrent subitement — et à l’échelle internationale — une stature menaçante d’un genre nouveau, puisque laïcisée.
Il aura suffi que Napoléon, qui vient de décréter le blocus continental, cherche à rallier les Juifs du monde entier à son projet, et tente à cette fin, pour leur complaire, de rétablir le «Grand Sanhedrin» (une entreprise qui d’ailleurs tourne court), pour que l’Empereur des Français soit aussitôt diffamé — notamment par l’Église russe — comme Messie des Juifs. À Pétersbourg, Joseph de Maistre cherche à éclairer Alexandre Ier: «Il ne faut s’étonner si le grand ennemi de l’Europe favorise les Juifs d’une manière si visible… tout porte à croire que leur argent, leur haine et leurs talents sont au service des grands conjurés. Le plus grand et le plus funeste talent de cette secte maudite, qui se sert de tout pour arriver à ses fins, a été depuis son origine de se servir des princes mêmes pour les perdre.» À Paris cependant, Louis de Bonald publie, à l’intention de Napoléon, une mise en garde contre les dangers inhérents à l’affranchissement de la secte: «Et qu’on ne s’y trompe pas, la domination des Juifs serait dure, comme celle de tant de peuples longtemps asservis, et qui se trouve au niveau de ses anciens maîtres; et les Juifs, dont toutes les idées sont perverties, et qui nous méprisent ou nous haïssent, trouveraient dans leur histoire de terribles exemples…» De plus amples détails, censés provenir directement du Saint-Siège, sont fournis par l’abbé Augustin Barruel, chanoine de Notre-Dame, qui assure que les Juifs s’emploient à noyauter l’Église catholique, et ont déjà réussi en partie, leur objectif étant de devenir les maîtres du monde7.
Sur le coup, cette démonologie d’un genre nouveau resta sans effet, puisqu’en 1815, l’Europe s’apaisa, et que les Juifs y demeuraient encore quantité négligeable. Il fallut (pour résumer en une formule paradoxale une évolution multiforme et complexe) que l’émancipation réussisse — que les Juifs, dûment intégrés et devenus des citoyens à part entière, se distinguent à la faveur de leur génie particulier ou de leur souplesse, dans tous les domaines de l’existence, pour qu’elle aboutisse à la tragédie que l’on sait. Entre-temps, et en nous limitant au cas de la France, rappelons les premières ascensions retentissantes: Rothschild, les Pereire, mais aussi Crémieux, Rachel, Offenbach…
En 1842, les Archives israélites font entendre un curieux son de cloche. L’organe se réjouit des progrès de l’émancipation, qui s’expriment notamment par un élan patriotique: «Le Juif dont l’âme est à Jérusalem tandis que son corps est en France n’existe plus guère de nos jours; la nation juive ne se trouve plus sur le sol français.» Mais il déplore la manière dont, d’ores et déjà, les Juifs font travailler les imaginations littéraires:
«Il n’y a pas un romancier, pas un apprenti nouvelliste, pas le plus piètre fabricant de feuilleton qui n’ait dans son sac la peinture fantastique du Juif. Au théâtre, depuis Shakespeare jusqu’à Scribe, dans les romans, depuis Ivanhœ jusqu’au Paul de Kock; dans les journaux, depuis qu’il y a des écrivains qui commencent des feuilletons et un public qui consent à en avaler quotidiennement… crac! on vous improvise un Juif comme on ferait des œufs sur le plat. Que le ciel vous préserve de la couleur locale de ces messieurs!»
En 1856, Alfred de Vigny en fournit un exemple à son insu, permettant au surplus de faire la part de l’imagination et de la réalité:
«Note sur les Juifs: cette race orientale et enflammée, race directe des patriarches, remplie de toutes les lumières et de toutes les harmonies primitives, a des aptitudes supérieures qui la mènent au sommet de tout dans les affaires, les lettres, et surtout les arts et la musique avant les autres beaux-arts. Cent mille Israélites à peine sont établis au milieu de trente-six millions de Français et ils ont sans cesse les premiers prix dans les lycées. Quatorze d’entre eux à l’École normale avaient pris les premières places. On a été obligé de réduire le nombre de ceux à qui il serait permis de concourir aux examens publics.»
Notons que d’emblée, Vigny parle de race. Nous voici en effet au temps de la vulgarisation des vérités scientifiques qui se veulent définitives.
Celles, par exemple, de l’anthropologie, qui au siècle précédent avait inventé et hiérarchisé les races humaines en fonction de leurs couleurs (et n’en connaissant donc que quatre ou cinq) et qui, maintenant, s’avise de départager la race blanche en «Aryens» et «Sémites»; d’autres la divisent en «Germains», «Latins» et «Slaves». Sous peine d’anachronisme, il importe de tenir compte de ce qu’à la fin du XIXe siècle, l’inégalité des races paraissait un fait acquis, pour le plus grand nombre8.
Ou celles de la sociologie, lieu privilégié de toutes les confusions, dont l’une et non la moindre porte sur la notion même de «Juif»: c’est ainsi que Karl Marx, fils d’un avocat déjà converti, se rangeait lui-même parmi les non-Juifs, tandis que le monde environnant tendait à attacher une réelle signification à ses origines, ce qui ne sera pas sans conséquences pour l’histoire du XXe siècle. Comme on le sait, l’auteur du Capital, qui identifiait métaphysiquement le monde bourgeois au judaïsme, se plaisait à dénigrer les Juifs, à l’instar, hélas, de bien d’autres bâtisseurs de systèmes socialistes, eux aussi, dûment scientifiques. Contentons-nous de citer Charles Fourier et Joseph Proudhon. Ce dernier accordait déjà une grande importance aux caractères négatifs de la race de Sem: «Il faut renvoyer cette race en Asie ou l’exterminer.»
Toutes ces spéculations nous font entrer dans l’ère suicidaire antisémite, qui n’affecte la France que par contrecoup, les trois grands centres de l’angoisse européenne se constituant, dans leur style respectif, au cours des années 1870-1880 à Berlin, Pétersbourg et Rome.
En Allemagne, l’antisémitisme (le terme fut forgé par l’ex-socialiste Wilhelm Marr, dont le pamphlet s’achevait sur l’exclamation: Finis Germaniae!) se voulait rigoureusement scientifique. Il n’en reposait pas moins sur une longue tradition nationale (voir certains écrits de Luther, ou certaines digressions de Kant et de Fichte) mais à partir de 1815, la judéophobie germanique fut singulièrement activée, dans les milieux patriotiques, par l’émancipation des Juifs imposée aux temps de l’occupation napoléonienne. Cette émancipation était désormais dénoncée comme «antipatriotique», tandis que les jeunes Juifs francophiles, tels Börne ou Heine, en raillant la mégalomanie nationale naissante, jetaient de l’huile polémique sur le feu. C’est dans ces conditions que «la question juive» fut de bonne heure placée à l’ordre du jour (aux côtés des problèmes majeurs de liberté politique et de réunification de l’Allemagne) et que les Juifs furent condamnés à militer dans le camp qui allait devenir celui de la gauche9. Ces tensions étaient dûment stimulées par la position des Juifs de Cour allemands10 dans la haute finance, mais aussi, par le rôle pionnier des savants allemands dans l’élaboration des théories raciales, qu’il s’agisse d’histoire, de philologie ou d’anthropologie.
Ainsi se préparait le terrain de l’explosion qui survint vers 1875, lorsque la fièvre nationaliste consécutive à la reconstitution d’un empire allemand coïncida avec une crise économique dont les Juifs furent volontiers rendus responsables. Une partie de la grande presse allemande et autrichienne déclencha alors des campagnes antisémites, et des partis et ligues se constituèrent, qui interprétaient le devenir germanique, voire mondial, en termes de lutte entre «Aryens» et «Sémites»: une mystique raciste, attisée par des chapelles, dont celle de Bayreuth, sous l’égide de Richard Wagner, fut la plus influente, déferla jusqu’à la cour impériale. L’antisémitisme devint alors comme la face intérieure du pangermanisme; l’un et l’autre comptaient de nombreux champions disposés à combattre à mort l’adversaire, et qui ne s’en cachaient pas. C’est dans ce climat mental que naquit, rejeté d’ailleurs par la majorité des Juifs dont certains se voulaient plus allemands que nature, le mouvement sioniste.
Il va de soi que le courant romain se plaçait sous un tout autre signe. Dans l’ensemble, les dispositions du Saint-Siège envers les Juifs avaient été peu affectées, avant le pontificat de Léon XIII, par les bouleversements du monde moderne; mais vers 1878, dans le cadre de l’aggiornamento qui suivit l’abolition de l’État pontifical, les Juifs furent englobés dans la séculaire campagne antimaçonnique de l’Église romaine, et c’est alors qu’avec d’inévitables nuances, le clergé de tous les pays catholiques se joignit aux dénonciations de «la finance juive», de «l’esprit antisocial juif», ou même des «meurtres rituels juifs». En France, ce clergé vint fournir et surtout recruter les principaux effectifs du mouvement antisémite déclenché (à l’exemple allemand?) par le krach d’une banque catholique, l’Union générale, dûment attribué aux Juifs; ce dont Maupassant, Zola, Paul Bourget11 et une foule d’écrivains de moindre renommée se firent l’écho, chacun à sa manière. Les haines en apparence inexpiables de l’affaire Dreyfus survinrent, une dizaine d’années plus tard: on n’en appréciera que davantage une relative tiédeur du camp antijuif12, quelles qu’aient pu être les fureurs verbales, voire les appels à la guerre civile; cette tiédeur permet de mieux comprendre l’indéfectible attachement des Juifs à une France qui restait pour eux celle de 1789, et dans laquelle les élites laïques, bien plus qu’eux-mêmes, furent les artisans de la victoire du bon droit. Aussi bien l’appel sioniste ne rencontra-t-il en France que des oreilles complètement sourdes. Témoin, la note désabusée du journal tenu par Théodore Herzl: «On ne peut tirer aucun profit des Juifs français; à la vérité, ils ne sont plus juifs.» «Mais ils ne sont pas français non plus», continuait l’apôtre du sionisme. Certes, il avait l’œil perçant. Mais pour celui qui voudrait connaître les dispositions profondes de tous les protagonistes, avec leurs innombrables nuances, Marcel Proust, complété par Maurice Barrès, plus superficiel, reste un bien meilleur témoin.
En définitive, l’antisémitisme le plus lourd de conséquences au XIXe siècle fut celui des tsars, les premiers à l’utiliser comme moyen de gouvernement. À partir de l’abolition du servage, qui en 1861 posa à l’autocratie surannée autant de problèmes qu’elle en régla, l’histoire de la Russie devint une course poursuite entre la refonte des structures étatiques et la catastrophe. Les périls étaient aggravés par le mécontentement des allogènes, qui constituaient près d’un tiers de la «prison des nations» tsariste. Les Juifs, devenus sujets russes en même temps que les Polonais, ne tenaient pas plus qu’eux, et si possible moins, à se faire convertir. Mais la jeunesse, sensible aux souffles venus d’Occident, s’émancipait d’elle-même, récusant la tradition ancestrale de soumission, et pour une partie, passait alliance avec les révolutionnaires russes. Le Gouvernement répliqua en montant ou en stimulant des pogromes, constituant les Juifs en boucs émissaires du mécontentement et des troubles: l’agitation révolutionnaire ne pouvait être que le fait de la secte maudite. Une initiative, lourde de conséquences, fut prise en 1881-1882, au lendemain de l’assassinat du tsar Alexandre II par l’organisation «Narodnaïa Volia»: un groupe d’aristocrates forma alors une société secrète, «La Sainte Légion», afin de combattre le terrorisme en lui empruntant ses moyens: de surcroît, pour mieux affaiblir l’ennemi en troublant ou en égarant la jeunesse russe; les contre-terroristes impériaux mirent au point les principaux procédés de la désinformation moderne13. La police politique, la fameuse Okhrana, reprit le flambeau. Elle fabriquait notamment des écrits destinés à dénoncer la conspiration juive, reprenant les vieux mythes médiévaux ou en inventant de nouveaux: l’une de ses productions, Les Protocoles des Sages de Sion, était appelée à connaître un succès prodigieux au lendemain de la Première Guerre mondiale.
Par ailleurs, sans les millions de Juifs d’Europe orientale, enracinés dans leur culture même lorsqu’ils avaient rompu avec la synagogue, le sionisme, faute de troupes, serait demeuré une utopie d’intellectuels. Ainsi donc, persécutés, soumis à des lois d’exception, diffamés tant par l’État que par l’Église russes, les jeunes Juifs émancipés, lorsqu’ils voulaient militer pour un avenir meilleur, suivaient l’appel sioniste, ou s’engageaient aux côtés des activistes russes.
Lors de la guerre civile de 1918-1920, les propagandistes des armées blanches reprirent et intensifièrent le thème du complot juif, provoquant des pogromes au cours desquels plusieurs dizaines de milliers d’innocents furent égorgés. Mieux encore, ils réussirent à exporter ce thème à l’étranger, et cela, de bien des façons. Je me limiterai au cas majeur des prétendus Sages de Sion. Au début de 1920, le Premier ministre britannique, Lloyd George, jugeant perdue la cause des Blancs, voulut négocier avec les Rouges; l’aile dure du parti conservateur s’y opposa, et pour discréditer les nouveaux maîtres du Kremlin, The Times se prêta au lancement des «Protocoles» en Occident. Le 8 mai 1920, sous le titre Le Péril juif, l’augure de la presse mondiale décortiquait et citait l’écrit, en insistant sur son caractère prophétique. Certains passages de l’article, en laissant planer un doute, n’en devenaient que plus convaincants pour un public cultivé:
«… Il est certain que le livre a été publié en 1905. Or, certains passages ont l’aspect de prophéties dûment accomplies, à moins d’attribuer la prescience des Protocoles au fait qu’ils sont effectivement les instigateurs secrets de ces événements. Quand on lit “qu’il est indispensable pour nos plans que les guerres n’entraînent pas de modifications territoriales”, comment ne pas songer au cri (bolchevik) de “Paix sans annexions” […] Que signifient-ils, ces “Protocoles”? Sont-ils authentiques? Une bande de criminels ont-ils réellement élaboré pareils projets, et se réjouissent-ils en ce moment même de leur accomplissement? Sont-ils faux? Mais comment expliquer alors le terrible don prophétique qui a prédit tout ceci?…»
En conclusion, l’article brandissait l’insupportable menace d’une «Pax hebraïca» imposée au monde entier. Un tel lancement assura au sinistre écrit nombre d’adeptes des deux côtés de l’Atlantique, dans les chancelleries aussi bien que dans le grand public — jusqu’à ce que, le 17 août 1921, The Times lui-même fasse amende honorable, en révélant que les Protocoles étaient, pour l’essentiel, le plagiat d’un pamphlet antibonapartiste de l’avocat français Maurice Joly14. Il n’empêche que ce texte garda ses fidèles, comme toujours en pareil cas, et que la propagande nazie s’en empara pour lui assurer, en fin de compte, une audience planétaire. Oubliés en Occident après la Deuxième Guerre mondiale, les Protocoles des Sages de Sion furent alors relancés à grande échelle par les rois d’Arabie, suivis par une cohorte d’éditeurs indiens, latino-américains ou africains, et ils constituent, de nos jours encore, une nourriture spirituelle pour des millions d’hommes naïfs qui ne sont pas tous des Arabes. Les services de propagande israéliens ne disposent pas de munitions de ce genre: les rêves de Khadafi ou de Khomeini ne font apparemment peur à personne.
Le IIIe Reich avait créé dès ses débuts une situation explosive, qui ne pouvait aller qu’en s’aggravant à mesure que montait la menace d’une nouvelle guerre mondiale. L’asymétrie entre Israël et les nations se manifesta alors avec une force extraordinaire, mais d’une façon toute nouvelle. Promu au rang de prêtre d’une religion d’État, l’antisémite partait toujours gagnant, accommodant à son goût le Juif quoi qu’il en veuille, avec l’aide involontaire de tout un chacun. Car: si je fais la guerre à Hitler, je m’allie bon gré mal gré aux Juifs; si je cède à ses exigences, je déserte une cause qui me paraissait bonne en soi, mais qui est d’abord leur cause. De toute manière, je les singularise. Les Juifs ainsi définis, et de plus diffamés par le IIIe Reich à l’échelle mondiale, réagissent tôt ou tard en Juifs, et renouent leurs vieux liens, même à leur corps défendant, de sorte que l’antique solidarité, qui pour un grand nombre n’était plus qu’un mot, voire un sujet de vergogne, commence à redevenir ce qu’elle avait été avant l’émancipation. Renforcée par le réveil d’odieux souvenirs, elle transcende toutes les frontières et sème des méfiances qui deviennent «aryennes» par la force de la nouvelle séparation, mais surtout par crainte d’une guerre juive.
Tel fut le cercle vicieux hitlérien, lorsque les anciens combattants de tous les pays clamaient: plus jamais cela! Cette conjoncture suscitait les étranges propos de Georges Bonnet et de son collègue Jean Giraudoux15 ou les «lâches soulagements» de Léon Blum, juif. Elle expliquait aussi le tour pris par la vision antisémite de Céline: «Nous irons à la guerre des Juifs. Nous ne sommes bons qu’à mourir…»
En ce qui concerne le génocide, je me limiterai à quelques observations. Il y eut d’abord la question de savoir et celle de pouvoir, sous le règne d’une raison d’État devenue quasi totalitaire. Les puissances alliées, qui savaient, repoussèrent ou sabotèrent bon nombre de projets qui auraient pu sauver des centaines de milliers de victimes, par crainte notamment de donner prise au soupçon de sacrifier leurs soldats pour le compte du judaïsme. Ce thème central de la propagande du IIIe Reich était particulièrement redouté par Staline, qui exigeait l’inaction, d’autant qu’il ne portait pas les Juifs dans son cœur. D’autres monstres froids, dont l’Italie et l’Espagne fascistes, ainsi que d’une autre manière le Japon16, se montrèrent plus secourables. Il en fut de même pour les petits pays neutres; la Finlande, qui se battit aux côtés du Reich, mérite une mention spéciale.
Certains théologiens, tant qu’ils ne surent pas, proférèrent des énormités, en se couvrant de l’enseignement patristique17. Lorsqu’ils surent, ils agirent dans les limites de leurs possibilités: saluons la mémoire du pape Jean XXIII, à l’époque légat en Slovaquie, qui se dépensa sans compter. Seuls les prélats allemands se turent dans leur ensemble, puisqu’il ne s’agissait que de Juifs18, et leurs silences permettent de mieux comprendre ceux de Pie XII.
Si de nombreux Juifs — plus de deux cent mille, en France — purent survivre dans l’Europe occupée, ce fut en bonne partie grâce à l’aide de petites gens, qui du reste ne savaient pas, ou savaient peu. En France comme presque partout ailleurs, nombre d’antisémites firent autant que les «philosémites». Les convictions ou les idéologies s’effaçaient devant un réflexe de solidarité humaine, face au malheur, chez les royalistes aussi bien que chez les communistes, et sans parler du commun des mortels. Cet aspect du génocide, moins spectaculaire qu’Auschwitz, mériterait d’être mieux connu.
Il reste que la majorité des contemporains, écrasés en ces années cruelles par leurs propres soucis, restait indifférente, d’autant que la peur s’en mêlait; d’ailleurs, les Juifs n’étaient-ils pas officiellement ostracisés par l’État français du maréchal Pétain, dont la propagande ne cessait de clamer qu’ils étaient les grands responsables du malheur national? En résultat, la terrible épreuve les marqua beaucoup plus profondément que l’affaire Dreyfus et toutes les autres campagnes antisémites du passé; de nos jours encore, il en reste quelque chose, sans doute le sentiment, difficile à définir, d’un destin particulier.
Après la Libération, ces miasmes flottèrent encore, avant que n’advienne, avec un certain recul, le temps du grand remords. Sur le fond d’une condamnation universelle du racisme, identifié à l’hitlérisme, l’Europe redevenue libre, non contente de proscrire l’antisémitisme homicide, se repentit, au-delà de ses complicités vichyssoises et autres, de ses séculaires errements. Souvenons-nous du revirement des Églises et du Concile Vatican II (mais l’opposition des catholiques espagnols et latino-américains, sans parler de ceux du Proche-Orient, empêchèrent les Pères de reconnaître le lien spécial entre les Juifs et la terre d’Israël; seule, l’Église de France eut le courage de le faire19. Pour ce qui est de la pensée française, souvenons-nous de François Mauriac, évoquant l’immense croix juive, ou de Jean-Paul Sartre et de ses jeunes admirateurs, clamant qu’ils étaient tous des Juifs allemands; sans parler de tous les livres, films, pièces de théâtre et autres manifestations qui mettaient à l’honneur le Juif persécuté.
Arrêtons-nous aux points de vue d’André Schwarz-Bart et de Joseph Losey qui bornent approximativement l’époque du remords. Est-ce parce que Le Dernier des Justes avait choisi de son plein gré son indicible destin qu’on pleura tellement sur ce Christ recrucifié? Et pourquoi, à vingt années de distance, fut-il imité par l’«aryen» Monsieur Klein qui, fasciné par le destin juif, est de ce fait contraint, le cœur chaviré, d’emprunter le même horrible chemin? La boucle était-elle bouclée? En tout cas, en ces temps, un tabou plana en Occident sur l’antisémitisme, désormais considéré comme un péché capital de l’esprit.
Quant aux Juifs eux-mêmes, dont la solidarité joua à plein pendant la guerre des deux côtés de l’Atlantique, la première leçon qu’ils tirèrent fut qu’un État juif, en ouvrant toutes grandes ses portes, aurait fait échec à la solution finale des Nazis. À l’exception de ceux, assez nombreux, qui plaçaient leur foi dans un avenir socialiste ou communiste, ils devinrent donc sionistes, fût-ce à la mode occidentale, c’est-à-dire pour aider leurs frères en détresse, en premier lieu les survivants des camps de la mort (qui en 1945-1948 restaient internés en Allemagne). Ceux des États-Unis firent le siège du président Truman, qui devint en conséquence, paradoxalement aux côtés de Staline, l’un des deux grands parrains de l’État d’Israël. C’est dans ces conditions qu’en novembre 1947 les Nations-Unies décidaient le partage de la Palestine en deux États, dont elles fixèrent les frontières. Les Juifs palestiniens acceptèrent, les Arabes, de l’Égypte à l’Irak, refusèrent, et le 15 mai 1948, au lendemain du départ des troupes britanniques, les armées de la coalition panarabe attaquaient. À la surprise générale, Israël gagna cette première guerre, clôturée par les armistices du printemps 1949, qui devinrent, aux yeux du monde, le certificat de viabilité de l’État nouveau-né.
Un bref retour en arrière s’impose ici, afin d’exhumer une page d’histoire que, depuis 1948, chaque génération européenne tend à réécrire d’une manière nouvelle et qui, pour le reste du monde, demeure un livre scellé. Ainsi comprendra-t-on mieux la genèse du conflit inexpiable qui allait s’ensuivre.
Comme je l’ai mentionné, dès les années 1880, quelques milliers de jeunes idéalistes juifs commençaient à coloniser la Palestine afin de s’y régénérer, moralement et physiquement, en cultivant la terre ancestrale. En 1894-1898, l’appel de Théodore Herzl, contemporain de la grande crise de l’antisémitisme européen, et directement inspiré par les fureurs de l’affaire Dreyfus, vint fournir un cadre international à leurs aspirations. Son «sionisme politique» reflétait la mentalité générale de l’époque: il envisageait le développement d’un nouveau nationalisme, couronné par la création d’un État qui, pour le plus grand bien de l’Europe, retirerait à l’antisémitisme le sol sous les pieds — point capital, à ses yeux — et deviendrait un avant-poste de la civilisation, face à la barbarie asiatique, conformément à la vision dominante du temps. Le «Judenstaat» rêvé par lui, et destiné à rassembler tous les Juifs persécutés, devait être entièrement laïc — et germanophone: il espérait le placer sous le protectorat de Guillaume II. Mais, malgré tous ses efforts, Herzl ne réussit pas à obtenir du sultan de Turquie une «charte» sur la Palestine. Il n’empêche qu’il avait lancé un mouvement, créé une «Organisation sioniste» internationale, et l’argent qui afflua permit d’intensifier la colonisation juive (à l’effroi de la trentaine de milliers de Juifs pieux qui vivaient dans les villes saintes de Jérusalem, Safed, Tibériade et Hébron, en stricte conformité avec la pratique séculaire).
Au lendemain de la Première Guerre mondiale, la Palestine devint un protectorat (mandat) britannique, destiné à abriter un «foyer national juif», à l’époque même où les jeunes nationalismes orientaux, de l’Egypte à l’Inde, commençaient à s’insurger contre le colonialisme. Ce fut aussi le temps où, aidé par une nouvelle immigration d’élite, surtout venue de Russie, le Yichouv20 ressuscitait à son usage une langue morte, fertilisait les déserts, extirpait la malaria et inventait le kibbutz, c’est-à-dire l’unique forme de socialisme volontaire et intégral qui subsiste de nos jours. Le pays reverdi attira une immigration arabe. Mais l’idylle ne pouvait durer; les Arabes anticolonialistes se faisaient la main en pratiquant d’ores et déjà le terrorisme aveugle des pogromes; le Yichouv dut s’armer. Certains songeaient à un État binational, mais en face, le clan modéré des Nachachibi se faisait massacrer par le clan extrémiste des Husseini (celui du Mufti de Jérusalem). Jusqu’en 1936-1937, les colons juifs s’abstinrent de rendre œil pour œil, se contentant de se défendre; un Écossais excentrique, Orde Wingate, futur héros de Birmanie, vint enseigner au jeune Moshé Dayan et à ses amis qu’il n’est de meilleure défense que l’attaque. Cependant, le gouvernement britannique, voyant la menace monter, Rome et Berlin lier parti avec le Mufti et ses belliqueux fidèles, basculait du côté arabe et restreignait l’immigration juive, pour la stopper dans son principe à l’instant le plus critique, c’est-à-dire à la veille de la Seconde Guerre mondiale.
À ce moment, la Palestine comptait en chiffres ronds 900 000 Arabes et 400 000 Juifs. Ces derniers combattirent de mille façons, se faisant tuer à Bir Hakeim, parachuter en Hongrie, confier des missions-suicide en Irak ou ailleurs; mais ils ne purent rien faire, ou pas grand-chose, pour aider leurs frères, parents, enfants d’Europe, pris dans le filet nazi. À la raison d’État des Alliés, ils opposèrent la résolution de créer leur propre État, quoi qu’il en coûtat. Le terrorisme juif naquit, qui aboutit au départ des Anglais, décision accélérée par l’indignation qu’avait provoquée, à l’échelle internationale, la flotte britannique, en s’attaquant aux rafiots bondés de survivants des camps de la mort.
Les guerres israélo-arabes s’ensuivirent, précédées, quoi qu’on en veuille, par un échange de populations de facto (il importe de signaler que, contrairement à l’opinion dominante, les Arabes de Palestine quittèrent, pour la plupart, leur pays en 1948, à l’instigation de leurs propres chefs)21. Par la suite, Israël, en proie aux incursions meurtrières des fedayin, n’en aspira que davantage à la paix; les États arabes, solidaires sur ce point parce que meurtris au plus profond de leur honneur, refusaient de la négocier, sinon à la condition d’un retour global des réfugiés, dont ils étaient les premiers à proclamer qu’il ferait exploser l’État ennemi. En attendant, ils gardaient ces réfugiés dans des camps, où on les éduquait en futurs combattants. C’est ainsi que se cimenta un nouveau peuple palestinien. Le conflit était unique en son genre, comme l’a bien exprimé, au lendemain de la guerre des Six Jours, M. Abdallah Laroui:
«… Le conflit judéo-arabe au sujet de la Palestine n’est sans doute pas unique, les disputes au sujet de la Silésie, de la Bessarabie, de Trieste, du Cachemire… lui sont comparables sous un aspect ou un autre. Mais aucun n’a mis en branle autant d’intérêts, mobilisé autant d’énergies, cristallisé autant de sentiments. Il semble que toutes les contradictions ethnico-nationales, économiques, politico-diplomatiques qui divisent le monde contemporain y trouvent une expression et un symbole…»
«… Quelles contradictions? Dans la crise de 1967, continuait M. Laroui, l’Occident généralement favorable à Israël se trouva opposé aux peuples non occidentaux — socialistes, islamiques ou neutralistes — plutôt favorables à la cause arabe22.»
Mais pourquoi? Les réponses, qui sont diverses et nombreuses, formeront le sujet des chapitres suivants. .
Chapitre II
La propagande soviétique
(1918-1983)
En Union soviétique, les Juifs se trouvèrent placés, dès 1918, au cœur de la guerre civile, puisque les armées blanches, de même que les bandes anti-bolcheviques autonomes, qui voyaient en eux les principaux responsables de la Révolution, les massacrèrent par dizaines de milliers, les poussant ainsi dans les bras du nouveau pouvoir (ce qui n’est pas sans présenter quelque analogie avec ce qui allait se produire dans l’Europe nazifiée, un quart de siècle plus tard). Ils devinrent donc, le plus souvent à leur corps défendant, des partisans du système communiste. Ajoutons qu’aux yeux de Lénine, l’antisémitisme était le symbole même de l’abjection bourgeoise. Dans ces conditions, au cours des années 1920, son «extirpation» devint une affaire d’État: les campagnes éducatives alternaient avec les procès publics et il était périlleux de se montrer antisémite, même si des millions de Russes regrettaient, avec la passion propre aux ci-devant, le bon vieux temps des tsars. À la même époque, les Juifs, comme les autres allogènes, pouvaient librement choisir leur nationalité (russe ou juive) et développer leur culture yiddish. Mais d’un autre côté, ils étaient soumis, comme tous les Soviétiques, à la propagande antireligieuse, doublée, dans leur cas, d’une lutte antisioniste que facilitait la création, en Sibérie, dans le lointain Birobidjan, d’une «région autonome juive23».
Cependant, dès les débuts de l’ère stalinienne, la situation particulière des Juifs, sur le fond de la collectivisation et des grandes purges, commença à se gâter: les admonestations publiques d’antisémites prirent fin, et la colonisation du Birobidjan fut stoppée. L’orage s’annonça lors du flirt germano-soviétique, quand les attaques publiques contre le IIIe Reich furent interdites, et la diplomatie soviétique, à commencer par son chef Maxime Litvinov, «déjudaïsée». Les vannes populaires purent s’ouvrir à loisir pendant la guerre, dans les territoires occupés par les Nazis comme ailleurs, et en Ukraine tout particulièrement: le thème d’une guerre faite pour le compte des Juifs trouvait facilement créance, le cercle vicieux hitlérien tournait bien. Pis encore, après la victoire, les victimes désignées du IIIe Reich apprirent que leur tragédie spécifique devait être passée sous silence, que leurs activités culturelles n’allaient pas reprendre, et que la «nationalité juive» ne servirait désormais qu’à les identifier, à des fins discriminatoires. On cherchait en outre à promouvoir la suprématie politique et culturelle de la nation grand-russe, dans tous les domaines et par tous les moyens. Cependant, le sort des Juifs russes relevait déjà tout autant des considérations de politique extérieure que des mesures dictées par le nouveau chauvinisme communiste. En effet, il semble bien qu’en 1946-1948 Staline, une fois de plus, se soit trompé dans ses calculs. Au Proche-Orient, son premier mouvement fut de placer tout son poids impérial dans la balance pour que le Yichouv palestinien puisse survivre, s’armer et se transformer en État. Il paraît évident qu’il voulait de la sorte compromettre les projets de la Grande-Bretagne (qui venait de constituer la Ligue arabe) et s’assurer d’un point d’appui dans la région. C’est dans ces circonstances qu’il se fit le grand parrain de la cause juive aux Nations-Unies, en 1947. Mais il vira de bord dès l’automne 1948, lorsque Golda Méir arriva à Moscou en qualité de premier ambassadeur de l’État d’Israël, et que se produisit le fait inouï d’une manifestation spontanée dans les rues, manifestation de Juifs en l’honneur de l’État juif24. Il flaira aussitôt un complot antisoviétique auquel il réagit à sa manière, déjà classique: en déclenchant des campagnes contre les «cosmopolites sans patrie», en ordonnant des purges administratives et des procès d’intellectuels et d’artistes. Ces procès, d’ailleurs, ne visaient pas les seuls Juifs; ils coïncidaient avec la persécution des savants et des intellectuels de toutes origines, la destruction totale, sous les auspices de Lyssenko, de la biologie, et l’épuration de toutes les autres disciplines. Une reprise en main générale, en quelque sorte.
Pour ce qui est des Juifs, il était naturel que leur persécution en vienne à s’étendre au plan de la politique extérieure. Ce nouveau cours se précise en 1951-1953, années durant lesquelles Staline s’attendait à un nouvel embrasement mondial et se préparait en conséquence25. De là, le tour pris par les procès de Sofia, de Budapest et de Prague, où des communistes, désignés le plus souvent par le Père des peuples lui-même, occupaient divers postes dirigeants. La Tchécoslovaquie servit notamment de banc d’essai. On prit une mesure d’ordre sémantique, géniale de simplicité: on substitua tout bonnement le terme sioniste à celui de juif, ce qui permit, à Prague, sur onze condamnés à mort, d’en pendre huit, en décembre 1952 — et parmi eux, le secrétaire général du parti Rudolf Slansky — sous prétexte qu’ils étaient des «sionistes bourgeois». Ils en convinrent d’ailleurs d’autant plus facilement que des spécialistes, formés à Moscou, firent préalablement subir un lavage de cerveau à ces combattants depuis longtemps dévoués au communisme. Ils avouèrent aussi, parmi d’autres crimes, celui d’avoir porté secours à l’État juif (à l’instigation de l’impérialisme américain). Ce fut le clou du procès: le dernier témoin, l’Israélien Simon Orenstein, révéla que la fondation d’Israël avait été décidée par le président Truman et ses secrétaires d’État, en la présence de Ben Gourion, au cours d’une réunion conspiratrice qui avait eu lieu à Washington, à la fin de l’année 1947. L’État créé dans ces conditions allait permettre de porter un coup décisif à l’Union soviétique, grâce à une base militaire secrète, qui serait installée à Haïfa; pour camoufler ce projet, il avait été convenu «qu’Israël feindrait la neutralité, tout en servant de base aux dirigeants sionistes, chargés d’entreprendre, au profit de l’impérialisme américain, des opérations d’espionnage et de sabotage dans les pays de démocratie populaire et en U.R.S.S.». Connus de quelques rares initiés, ces objectifs portaient le nom de «plan Morgenthau26».
Les résultats internationaux de ces révélations furent jugés suffisamment probants par Staline et ses sbires pour leur permettre de lancer sur-le-champ, à Moscou même, une bombe antisémite plus grosse encore: la fameuse affaire des «assassins en blouse blanche». Un groupe de médecins juifs aurait «sur les instructions de l’organisation internationale juive bourgeoise nationaliste» assassiné les dirigeants soviétiques Jdanov et Chtcherbakov, et était sur le point de commettre d’autres «assassinats médicaux». D’après les Izvestia du 13 janvier 1953 «les membres de ce groupe terroriste — Vovsi, B. Kogan, Feldman, Grinstein, Ettinguer et autres — avaient vendu leur âme et leur corps à la filiale des services de renseignements américains: l’organisation internationale juive bourgeoise nationaliste “Joint”27. De nombreux faits irréfutables permettent de mettre à nu l’horrible visage de cet ignoble organisme d’espionnage sioniste».
La campagne qui se développa au cours des semaines suivantes faisait appel à la «haine populaire» (Pravda Oukraïny, 16-1-1953) et mettait en garde contre les «crimes sionistes»» (Troud, 13-2-1953) et cette «meute de chiens enragés de Tel-Aviv» (Pravda, 13-2-1953). Les incidents antisémites se multipliaient dans les rues; dans les hôpitaux, les malades s’affolaient et refusaient de se faire soigner par des Juifs. La grande traque commençait-elle à s’ébaucher spontanément, conformément aux recettes éprouvées du IIIe Reich? Dès les premiers jours Raymond Aron posait la question, se demandant si les «survivants des horreurs hitlériennes n’étaient pas menacés par une persécution qui, elle aussi, mériterait peut-être demain le qualificatif de génocide» (Le Figaro, 17-1-1953).
À trente ans de distance, deux historiens qui, à l’époque, furent des témoins oculaires, apportent sur cette affaire, restée mystérieuse par maints côtés, les précisions suivantes:
«Beaucoup de médecins juifs furent chassés des hôpitaux et des dispensaires. Çà et là, on commença à dresser des listes d’employés juifs. Staline s’occupa personnellement du “complot des médecins”. Le scénario qu’il avait prévu comprenait plusieurs actes. Acte premier: condamnation des médecins après procès et aveux complets. Acte deux: pendaison des médecins. On affirme que cette exécution devait avoir lieu comme jadis sur la place Rouge à Moscou. Acte trois: pogromes dans tout le pays. Acte quatre: des personnalités juives du monde de la culture s’adresseraient à Staline pour lui demander de protéger les Juifs contre les pogromes, de leur permettre de quitter les grandes villes et de retourner à la terre. Acte cinq: déportation massive des Juifs, “à leur propre demande”, dans les régions orientales du pays. Le philosophe D. Tchesnokov, membre du Présidium du Comité central, avait écrit un livre où il expliquait les raisons de la déportation des Juifs. Il était imprimé et destiné à une diffusion restreinte parmi les dirigeants. On attendait seulement un signal pour le diffuser largement. Quant à l’appel au secours des personnalités juives, il était non seulement rédigé, mais déjà signé par elles28.»
Il va de soi que la presse des pays dits socialistes, de Sofia à Varsovie, se livrait, sous réserve de variations de détail, aux mêmes campagnes de haine, impliquant d’ailleurs d’implacables règlements de comptes entre les figurants mis en place par Staline. Je me contenterai ici d’évoquer le cas de Berlin-Est, qui, dans sa singularité, dépassait dès 1952 les prévisions orwelliennes les plus audacieuses29. Il s’agissait en effet de limoger les dirigeants communistes Paul Merker et Ernst Jungmann, sous le prétexte qu’ils avaient nié la responsabilité de la classe ouvrière allemande dans la montée du IIIe Reich. Comment la régie stalinienne s’y prit-elle? Tout d’abord, en nazifiant les Juifs. En effet, «Merker, qui reconnaît en paroles la culpabilité de la classe ouvrière allemande et de tout le peuple allemand, en ce qui concerne la victoire du fascisme, nie perfidement en réalité cette culpabilité, puisqu’il excepte explicitement de celle-ci la population juive allemande.» Il restait cependant à prouver que cette dernière était plus coupable que toute autre.
Dans la «République démocratique allemande» la population juive s’élevait, en 1952, à trois ou quatre mille personnes, dont l’âge moyen était de plus de cinquante ans. Au lendemain du procès Slansky, le commandant des troupes soviétiques convoquait quelques dirigeants communautaires, pour se renseigner sur les us et coutumes des sionistes. «D’où tenez-vous vos instructions? Les recevez-vous de la même manière que l’Église de Rome? Recevez-vous des lettres pastorales? Et pour quelle raison le “Joint” vous envoie-t-il des colis alimentaires?» En mars 1953, l’affaire fut prise en charge par le N.K.V.D., autrement dit les spécialistes chevronnés de Staline, qui se firent communiquer les listes des Juifs allemands et cherchèrent à se renseigner sur leurs liens de parenté internationaux. Tout porte à croire qu’un procès était en préparation, qui dans sa transparence hitlérienne aurait été le plus édifiant de tous30…
Il reste à rappeler que l’indomptable Yougoslavie de Tito fut le seul d’entre les pays socialistes à se tenir à l’écart de la chasse aux sorciers juifs31, et à ajouter qu’en Union soviétique même, les figures les plus glorieuses de la nouvelle intelligentsia dissidente abominaient ce genre de pratiques, renouant ainsi avec une tradition séculaire russe. On relira avec profit, à ce propos, Le Premier Cercle de Soljenitsyne, L’avenir radieux de Zinoviev, et surtout, La Liberté intellectuelle en U.R.S.S. d’Andréi Sakharov, où l’illustre savant n’hésitait pas à dénoncer publiquement les persécutions infligées à certains peuples allogènes et, en particulier, la recrudescence de l’antisémitisme.
Mais c’est sans doute au poète le plus populaire de la nouvelle génération, à Evguéni Evtouchenko, que les Juifs russes vouèrent leur reconnaissance, parce qu’il avait voulu panser dans Babyi Yar leur plaie la plus amère, le déni de leurs souvenirs et de leur calvaire, et parce que ce poème, qui lui attira en 1962 les foudres de Khrouchtchev, n’en connut qu’une plus grande popularité. Pendant longtemps, il fut sur toutes les lèvres, il était appris par cœur et récité dans les cercles d’étudiants, comme c’est l’usage en Russie. Il n’en est que plus intéressant de constater, en le lisant attentivement, à quel point les Juifs, au lendemain des persécutions hitléro-staliniennes, étaient devenus ou redevenus pour les Russes des Autres, en l’occurrence desservis par la longueur de leur histoire.
«Il n’y a pas de monument à Babyi Yar
Je ne vois qu’une pente abrupte. J’ai peur
Aujourd’hui, je suis aussi vieux
Que le peuple juif lui-même. […]
Je suis chaque vieillard martyrisé ici,
Je suis chaque enfant martyrisé ici. […]
Je n’ai pas de sang juif dans mes veines,
Mais je hais d’une haine inextinguible
Les antisémites, tout comme un Juif,
Car je suis un véritable Russe!»
Les retombées de la propagande soviétique en France
Ceux qui sont nés avant 1939 se souviennent peut-être de la sourde et permanente angoisse dans laquelle la «guerre froide» faisait vivre, en ces temps, l’Europe entière. En Corée, l’armistice n’avait pas encore été signé. Vieille mère des religions, la peur fortifiait chez les partisans de Staline la foi en sa bonté, son omniscience et sa toute-puissance. Les campagnes antisionistes faisaient monter la tension internationale. Les grands journaux communistes des pays occidentaux mettaient en garde les populations contre l’espionnage américain: «Voici qu’aujourd’hui les patrons américains des médecins criminels occupent notre pays; toutes les organisations d’espionnage créées par eux — et le “Joint” en particulier — opèrent ici même. Qui peut imaginer que ces officines ne cherchent pas à introduire chez nous leurs mouchards et leurs provocateurs?» (L’Humanité, 17-1-1953). Dix médecins communistes furent chargés de faire taire les doutes et signèrent une déclaration attestant que leurs confrères de Moscou étaient bien des empoisonneurs. Les organes destinés aux élites communistes mettaient l’accent, pour leur part, sur le sionisme international. Dans La Nouvelle Critique, Maxime Rodinson assurait que l’Union soviétique était le paradis des Juifs, expliquait que les sionistes étaient des séparatistes, des colonialistes, des racistes et des capitalistes; puis, s’essayant timidement à la démagogie, il ajoutait: ils «mènent les Juifs à l’abattoir, provoquent l’Union soviétique, et se font complices de l’antisémitisme32» (février 1953). Dans la même revue, M. Francis Crémieux décrivait les échecs successifs des impérialistes, dont les complots avaient été démasqués aux procès de Sofia, de Budapest et de Prague. En conséquence, l’ennemi avait dû se rabattre sur Israël, car «seules les organisations sionistes, les missions israéliennes se présentaient encore vierges, ou presque, de soupçon» (mars 1953).
La presse non communiste voyait les choses autrement et dénonçait le nouvel antisémitisme soviétique; mais déjà, des nuances apparaissaient çà et là. La plus remarquable se faisait jour dans L’Observateur, où Gilles Martinet posait la question sur le plan théorique, pour «rappeler que les positions prises par la plupart des marxistes (et pas seulement par les membres du parti communiste) devant le phénomène sioniste s’inspirent d’une analyse du problème juif développée bien avant l’existence du mouvement sioniste lui-même» (4 décembre 1952).
Cette analyse reposait sur la Question juive de Karl Marx. Cet obscur écrit de jeunesse se trouvait jeté dans la bataille pour la première fois, au xxe siècle. Lénine et les autres vieux bolcheviks, pour lesquels les écrits de Marx n’étaient pas encore des Écritures, ne s’y étaient jamais référés. Martinet en tirait diverses citations percutantes, qui lui permettaient de conclure: «Il est facile de montrer la continuité de pensée qui existe à ce propos entre le fondateur du socialisme scientifique et ses disciples (contemporains).»
Dans Ce Soir, un quotidien de gauche qui ne prétendait pas voler si haut, on relevait des accents semblables à ceux de L’Humanité; passant à la contre-attaque, ce «compagnon de route» mettait en cause les pays anglo-saxons, dans un article intitulé: La question est posée: où sont les antisémites? (6 février 1953).
Mais déjà, plusieurs écrivains indépendants de gauche — Roger Caillois, suivi de Jean Duvignaud, de Rémy Roure et de Jean Schlumberger — posaient des questions gênantes. Ainsi Duvignaud:
«Jusqu’ici, ce genre de généralisations, qui en appelle aux sentiments confus de l’inconscient collectif, restait intérieur à l’idée révolutionnaire: le “trotskisme” ou le “titisme” étaient des hérésies. L’“antisionisme cosmopolite” implique une ségrégation portant sur l’humanité tout entière, il s’adresse moins à la conscience révolutionnaire qu’à la conscience “nationaliste”, pour ne pas dire plus, il parle aux masses obscures, non à la classe. Là réside la gravité de l’affaire.»
Citons aussi Le Populaire de Léon Blum, dans lequel un commentateur perspicace prévoyait la chute prochaine de Laurent Beria (15 janvier 1953). Jean-Paul Sartre, pour troublé qu’il fût, voyait encore plus loin et il appelait un chat un chat:
«L’antisémitisme aujourd’hui n’est plus une doctrine. Drumont n’est plus possible. Les partis de droite qui professaient autrefois un antisémitisme systématique sont remplacés par des groupements qui ne se réclament plus de la droite, qui n’osent même pas dire leur nom. Par ailleurs, il est évident que nous assistons aujourd’hui à un antisémitisme “de gauche”. Les déclarations faites au procès de Prague, par exemple, sont extrêmement troublantes…» (Évidences, janvier 1953).
Des polémiques du même genre se déchaînèrent également en Italie; en miniature, elles trouvèrent leur pendant en Grande-Bretagne et dans d’autres pays européens, dès lors que le parti communiste y disposait d’une ossature. Elles ne durèrent, il est vrai, que l’espace d’un hiver. Autant en emporte le vent? Non point, car la graine était semée et les campagnes anti-israéliennes de Moscou allaient bientôt reprendre. Faisant le tour du globe, les germes s’implantaient à l’Est comme à l’Ouest, notamment parmi les populations asiatiques pour lesquelles Israël, tout comme les Juifs et leur «Joint», étaient encore des entités inconnues, mais l’impérialisme occidental — le pire des maux, ainsi que Moscou l’enseignait depuis l’époque de Lénine. Cette assimilation, tentée pour la première fois, devait aboutir une vingtaine d’années plus tard à une coalition anti-israélienne mondiale.
Déstalinisation
Le 5 mars 1953, Staline mourait. La population, dans un premier temps, fut loin de s’en réjouir; une sorte d’angoisse étreignit pour quelques jours le pays. Les Juifs, eux, furent soulagés, d’autant qu’un mois plus tard, le monde apprenait que le procès des empoisonneurs israélo-américains n’aurait finalement pas lieu. Un communiqué officiel annonçait que les arrestations avaient été illégales, les accusations, fausses, les aveux, arrachés sous la torture. Le surlendemain, la Pravda allait plus loin: elle dénonçait deux policiers de haut rang, Rioumine et Ignatiev, qui «avaient cherché à fomenter au sein de la société soviétique… des sentiments de haine nationale, qui lui sont profondément étrangers». À cette fin, ils avaient «par exemple, calomnié de cette façon une honnête personnalité soviétique, l’artiste du peuple Mikhoëls» (6 avril 1953).
En réalité, Mikhoëls était mort, «accidentellement», depuis plus de cinq ans. Pourquoi son nom seul, à l’exclusion de ceux des médecins, fut-il cité et couvert d’honneurs? Nul ne le sait et les détails de la machination demeurent obscurs. Il reste que les autorités avouaient qu’elle avait pour but de susciter un antisémitisme qu’elles évitaient d’appeler par son nom. Ce demi-aveu, par exemple, réitéré le lendemain, ne reparut jamais dans la presse soviétique.
Timidement, les successeurs de Staline tentèrent de tirer le pays du gâchis intellectuel et moral dans lequel il était plongé. Mais la régression, on le sait aujourd’hui, avait été trop profonde. Jamais encore dans l’histoire, l’esprit humain n’avait été asservi, infantilisé de cette façon. Lorsque Laurent Béria, le grand patron de Rioumine et Ignatiev, est exécuté à son tour en juin 1953, ce n’est pas sa disparition qui confond, c’est l’ordre adressé à tous les souscripteurs de la Grande Encyclopédie soviétique de découper l’article qui lui était consacré, de le renvoyer aux autorités, et de coller à la place la description de la mer de Behring. (Dans les pays arabes, on commémora la fin de Béria d’une autre façon; il aurait été exécuté en qualité «d’agent sioniste»). Les oisillons du Père des Peuples étaient unis par vingt années de complicité; ils étaient les profiteurs des grandes purges en même temps que leurs rescapés; il était scabreux, peut-être impossible, de renverser à fond la vapeur. Et c’est ainsi que commença, cahin-caha, l’ère de l’immobilisme soviétique. Au surplus, des voix s’élevaient dans le peuple: on aurait les youpins une autre fois. Les médecins furent libérés, mais des dizaines de milliers de Juifs continuaient à être détenus dans les camps; en Tchécoslovaquie et ailleurs, d’autres procès antisionistes suivaient leur cours. Pourtant, la propagande soviétique fut atténuée et après l’exécution de Béria, les relations diplomatiques furent renouées avec l’État d’Israël.
Trois ans plus tard, lors de la XXe conférence du parti, vint l’heure de la réhabilitation solennelle des victimes du stalinisme. Les Juifs surent alors d’une manière plus précise où ils en étaient. Les victimes étaient réhabilitées soit nominalement, soit collectivement, puisque justice fut rendue à des nationalités persécutées par Staline (Allemands de la Volga, Tchétchènes et Ingouches du Caucase). Cette justice ne s’étendit pas aux Juifs. La discrimination «nationale» fut maintenue à leur égard, notamment dans l’enseignement supérieur, où ils n’étaient admis qu’au compte-gouttes, dans les limites de certains pourcentages ou «quotas»; les postes à responsabilité, les fonctions qui donnaient influence et pouvoir leur furent totalement barrés dans le domaine politique, l’armée et la diplomatie. Cette condition est donc comparable, à certains détails près, à celle qu’ils connurent sous les tsars. Moins les pogromes, mais avec ceci de pire que les issues libératrices de tous ordres, telles que l’émigration, l’assimilation intégrale, le retour à la culture juive, voire la pratique religieuse, se trouvaient partiellement ou totalement interdites. En somme, un étouffement à petit feu, même si, comme me le disait un prêtre russe dissident, on «a encore besoin, là-bas, des cerveaux juifs». Il est de fait que quelques-uns conservent, encore aujourd’hui, une position scientifique ou littéraire assez élevée.
La propagande anti-israélienne et le tiers monde
On considère généralement que la prise de conscience du tiers monde en tant que nouvel espace politique remonte à la Conférence de Bandoeng (avril 1955). Sur l’initiative de l’Indonésie, dix-neuf États asiatiques et six États africains qui venaient d’accéder à l’indépendance débattirent en commun de leurs problèmes particuliers, espérant inaugurer une ère nouvelle dans les rapports internationaux, tout en défendant, désormais, leur place au soleil. L’opprobre du colonialisme excluait la participation du Japon (sans parler des pays occidentaux), mais l’Union soviétique ne fut pas invitée non plus, car la conférence se voulait résolument neutraliste. La participation de huit pays arabes33 excluait automatiquement la présence d’Israël. Chaque délégué arabe prononça sa philippique anti-israélienne; celle de Nasser ne fut pas la plus violente: le délégué de l’Irak le surpassa dans ses invectives contre «la grande force du malheur, le sionisme, l’un des plus noirs et des plus sombres chapitres de l’histoire humaine». Mais le personnage le plus remarquable fut un homme, arrivé à l’improviste pour parler au nom du Yémen où il n’avait jamais mis les pieds.
Une vieille connaissance, peut-on dire, puisqu’il s’agissait de Hajj Amine El Husseini, l’ex-mufti de Jérusalem. Échappant dès 1939 aux Anglais, il s’était réfugié dans le IIIe Reich et s’y était rendu utile, formant un régiment de S.S. musulmans et se distinguant de diverses façons quand on en vint à la «solution finale». Himmler prisait fort ses avis et le complimentait sur ses yeux bleus, dûment nordiques. «La lutte contre le judaïsme, lui écrivait-il, est le fondement de l’alliance naturelle entre le Reich national-socialiste et les musulmans épris de liberté, jusqu’à la victoire finale.» À ce titre, notre homme prêta aussi la main à Adolf Eichmann34. Mais qu’importaient aux Chinois et aux Indiens ces vieilles histoires européennes, surtout si l’on pense que pour l’Asie, où la Grande-Bretagne et d’autres démocraties avaient laissé le pire souvenir, le IIIe Reich ne faisait pas figure de puissance colonialiste. À Bandoeng, Hajj Amine put donc «révéler» à loisir les véritables visées sionistes: la formation d’un vaste empire s’étendant du Nil jusqu’à l’Euphrate. Les Juifs ne l’avouaient-ils pas eux-mêmes? «Ils ne nient pas qu’ils veulent inclure dans leur État tous les pays compris entre le Nil et l’Euphrate, autrement dit la Jordanie, la Syrie, le Liban, le Sinaï, le delta d’Égypte, l’Irak et le Nord-Hedjaz, et donc la fameuse ville sainte de Médine.»
Ainsi édifiés, tous les participants basculèrent du côté arabe, à la seule exception de la Birmanie, qui soutint Israël et lui garda son amitié pendant plusieurs années. «La résolution anti-israélienne a été le seul point d’accord de la conférence» (Le Monde, 20-4-1955). Qui plus est, en 1957, une assemblée plus vaste, groupant trente-cinq pays, se réunissait au Caire. Le nom de «fille de Bandoeng» lui reste attaché, et cette fois-ci, l’Union soviétique et ses satellites y participaient, sur les instances de Nasser. La quinzième et dernière résolution de cette conférence dénonçait Israël, «base de l’impérialisme et menace pour la paix au Moyen-Orient et dans le monde entier». C’est ainsi que se constitua un bloc diplomatique anti-israélien, assuré d’une majorité automatique aux Nations-Unies et représentant plus des trois quarts de la population de la planète.
Autour du procès Eichmann
Quels que fussent les méandres de la politique russe après la mort de Staline, la propagande anti-israélienne ne désarma pas. Dès 1955, au lendemain de Bandoeng, Khrouchtchev déclarait au Soviet suprême: «On ne peut faire autrement que de condamner les agissements de l’État d’Israël qui, depuis le premier jour de sa création, a commencé à menacer ses voisins et à mener une politique inamicale à leur égard.» Mais tout se tient; ainsi, au début, l’accent portait, dans le cadre général de l’action antireligieuse, sur les particularités fâcheuses de la religion juive, dont l’espoir d’un retour à Jérusalem fait nécessairement partie. En 1957, le futur spécialiste de ces campagnes, l’Ukrainien Trofime Kitchko, publiait son coup d’essai, La Religion judaïque, ses origines et son essence. La presse et la radio faisaient chorus: Radio Kirovgrad, par exemple, déclarait le 9 décembre 1959 que «Un procès ou une farce?». Mais c’est surtout le procès d’Adolf Eichmann à Jérusalem (1960-1961) qui fut le signal d’une campagne anti-israélienne, conformément à des ordres visiblement venus d’en haut. La revue diplomatique Temps nouveaux, publiée en plusieurs langues, y consacrait une série de six articles, et à travers le pays, peu de journaux manquèrent à l’appel. On peut citer: «Eichmann n’est pas seul au banc des accusés.» (Izvestia, 3-9-1961) et encore mieux: «La collusion entre la réaction israélienne et les revanchards de Bonn.» (La Flotte soviétique, 29-7-1959), ou dans le même style: «Un procès ou une farce?»» (Pravda 28-4-1961) et: «Le bourreau Eichmann et ses protecteurs» (Troud, 28-7-1961). C’est à cette occasion que le sionisme commença à être rapproché du nazisme, l’idée étant qu’en accordant une si grande publicité à Eichmann, Israël cherchait à protéger les vrais coupables, les nazis ou néo-nazis censés préparer, à Bonn, la Troisième Guerre mondiale. Les caricatures — Dayan travesti en Goebbels, la croix gammée superposée à l’écu de David — vinrent à la rescousse. Avec le temps, et surtout après la guerre des Six Jours, les accusations allèrent s’aggravant: L. Kornéiev reprochait ainsi à Israël d’avoir cherché, en montant le procès, «à camoufler les honteux trafics des sionistes et leur collaboration secrète avec les hitlériens au cours de la guerre» (Ogoniok, no 5, janvier 1977).
En l’occurrence, la presse communiste occidentale ne pouvait se permettre de reproduire de tels délires. Encore qu’une fois de plus, le Parti français se risquait à des allusions. Citons Maurice Thorez:
«Eichmann mérite un châtiment exemplaire. Il a pu, comme bien d’autres, échapper longtemps à la justice, en raison des appuis qu’il a trouvés chez certains qui feignent aujourd’hui de condamner ses actes.
«Dans la conduite du procès actuel apparaît d’ailleurs la tendance à jeter un voile sur les responsabilités profondes du grand capital allemand et international qui ont hissé Hitler au pouvoir. On veut aussi ménager certains dirigeants de la République fédérale allemande» (L’Humanité, 16-6-1961).
Mais revenons à Moscou. Il va de soi que la propagande dite antireligieuse continuait à jeter de l’huile sur le feu. En 1962, ses experts exhumaient un vieil ouvrage, qui avait circulé sous le manteau dans la France des Lumières, le Tableau des Saints du Baron d’Holbach, un ramassis de crimes imputés aux Juifs (et aux curés). La même année, l’Académie des Sciences de l’U.R.S.S. entrait en lice en publiant une Critique de la religion judaïque, ouvrage collectif de haute érudition, dans lequel une vaste place était accordée aux penseurs libres juifs Hayawaih de Balkh (IXe siècle) ou Baruch Spinoza (XVIIe siècle), mais où on pouvait lire, dès la page 19:
«La fraternisation de la Synagogue avec l’Église dévoile encore mieux l’essence réactionnaire du judaïsme et du christianisme. Comme l’écrivait William Foster, “L’Église catholique ne néglige aucun moyen pour sauver le capitalisme”. De même, la Synagogue ne recule devant rien pour protéger les intérêts des monopoles américains.»
Mais la propagande anti-israélienne se poursuivait surtout par voie d’articles de journaux, d’émissions de radio et de brochures dites de vulgarisation. Je me contenterai de citer deux auteurs.
Un certain F. Maïatski faisait ses débuts en 1964, sur le thème: Le Judaïsme contemporain et le sionisme. Il y était surtout question de l’État juif et Maïatski ne manquait pas de s’étendre sur la discrimination socioraciale qui y régnait — oppression des Arabes par les Juifs, des Juifs pauvres par les Juifs riches, des immigrés de fraîche date par les pères fondateurs sionistes. Il s’apitoyait aussi sur la condition moyenâgeuse de la femme, qui n’aurait le droit ni au travail ni au divorce. Maïatski assurait même que «les cléricaux» voulaient. interdire aux femmes l’usage des piscines dans ce pays semi-tropical, et qu’ils avaient remis, à cette fin, une pétition au… président des États-Unis.
Il allait de soi que ce président était le véritable patron d’Israël. Pour le démontrer, notre spécialiste exhumait de ses archives les procès-verbaux du procès Slansky, et plus particulièrement la déposition de Simon Orenstein. «Il est bien connu, écrivait-il, qu’en 1947, on avait convoqué à Washington les dirigeants sionistes. Comme on l’apprit par la suite, à cette réunion secrète, Truman, Acheson et le ministre des Finances Morgenthau conclurent un accord avec Ben Gourion et Sharett, selon lequel toutes les organisations sionistes, ainsi que les services diplomatiques d’Israël, devaient travailler pour le compte de l’espionnage américain.» S’y rattachait la véritable signification du procès Eichmann: «Lorsque quinze ans après, Eichmann comparut devant un tribunal israélien, les impérialistes américains firent tout leur possible pour que lui seul soit jugé, à l’exclusion du fascisme et du néo-nazisme.» Suivant la version de Maïatski, ces impérialistes, secondés par le chancelier Adenauer, auraient même tenté d’interdire l’ouverture du procès, mais les «masses populaires» israéliennes auraient déjoué ce complot.
Venons-en maintenant au second écrit, plus prétentieux, puisqu’il était publié sous les auspices de l’Académie des sciences d’Ukraine: Le Judaïsme sans fard de Trofime Kitchko. Il ne différait guère, quant au contenu, de la brochure de Maïatski: sous prétexte d’édification anti-religieuse, il y était également question de l’obscurantisme judaïque, de la finance internationale juive ou germano-juive et du rôle d’avant-poste joué par Israël dans la conspiration impérialiste mondiale. Mais cette brochure-là était abondamment illustrée, et le langage des caricatures antisémites n’a pas besoin d’être traduit ou commenté. En conséquence, les partis communistes occidentaux se sentirent obligés de protester. Pour une fois, l’Humanité donnait l’exemple: «La présentation, sinon le contenu de cette brochure est susceptible d’alimenter les haines antisémites. Elle est, en effet, illustrée de plusieurs caricatures malveillantes et de mauvais goût, qui risquent de flatter et favoriser le sentiment de mépris» (24.3.1964). L’Unità suivait: «Il faut lutter contre de tels phénomènes. L’abstention ou même une lutte hésitante ne peuvent que nuire à l’Union soviétique ou faire douter d’elle» (29.3.1964). Les autorités soviétiques réagirent aussitôt, en montant un simulacre de polémique: La Pravda parla d’affirmations erronées, allant jusqu’à écrire que «les illustrations… pouvaient être interprétées dans un sens antisémite» (5.5.1964). Mais Kitchko ne fit qu’y gagner et il put bientôt se surpasser.
Crescendo
En 1967-1968, on en était à l’ère Brejnev, lorsque quelqu’un, à Moscou, décida «d’augmenter la vapeur» (pribavit’parou). D’agent des diables impérialistes, Israël fut alors promu au rang de diable en titre, et même de diable majeur.
Dans quel but? Complaire aux Arabes, que l’U.R.S.S., qui les avait armés, avait été incapable d’aider, lors de la guerre des Six Jours? Décourager les Juifs soviétiques qui, à la suite de la victoire israélienne, se permettaient de redresser la tête? Le fait est qu’en été 1967, la presse soviétique battit des records. Les termes de «nazis», «gestapo», «génocide», fusaient, le général Dayan devenant «l’élève de Hitler et l’enfant chéri des néo-nazis». L’attaque israélienne de juin 1967 ne se laissait comparer qu’à l’attaque nazie d’octobre 1939: les femmes arabes auraient été violées, les enfants passés au fil de l’épée.
Mais la guerre des Six Jours n’étant qu’un épisode, plusieurs interprétations sont possibles, d’autant que le monde soviétique dut affronter en 1967-1968 divers autres problèmes.
Il y eut d’abord, en Pologne, la grande purge de mars 1968. De nombreuses autres, pareillement commandées par Moscou, l’avaient précédée depuis 1945, d’une part parce que l’usage le voulait, mais aussi, parce que le peuple tout entier s’opposait au joug soviétique de la manière qu’on sait. L’antisémitisme jouait son rôle dans ces sombres intrigues: dès 1957, le brillant jeune philosophe Leszek Kolakowski qualifiait ironiquement le régime polonais de «société dans laquelle quelqu’un est malheureux parce qu’il est Juif et où un autre est mieux parce qu’il ne l’est pas35». Mais la purge de mars 1968 fut spécifiquement antisioniste.
Des manifestations d’étudiants ayant eu lieu en hiver, le gouvernement Gomulka décréta que les trublions étaient juifs (il restait environ trente mille Juifs à l’époque en Pologne). Tout comme dans le IIIe Reich, une grand-mère juive suffisait à engendrer une suspicion qui n’épargnait pas nombre de purs Aryens. Qui plus est, l’ex-fasciste antisémite Boleslaw Piasecki, qui en 1936 avait fondé la «Phalange des chemises claires», fut chargé d’annoncer cette purge36. On retrouvait exactement la vieille orchestration nazie, mais modifiée au goût du jour. Une citation suffira:
«Le sionisme contemporain demande à tous les Juifs d’avoir des sentiments de conscience nationale juive, mais il dit ouvertement qu’une partie seulement pourra devenir des citoyens de l’État d’Israël. La seconde partie, de loin la plus grande, doit résider dans d’autres États, non pas parce que la Palestine manque de place, mais intentionnellement, afin de sauvegarder l’hégémonie financière mondiale des Juifs […] Ce programme est ouvertement proclamé et, dans les moments décisifs — ainsi que nous l’avons vu au moment de la dernière agression israélienne — il est appliqué avec un entier succès. Dans le monde capitaliste, les temps prophétisés par les Protocoles des Sages de Sion sont-ils venus, où “les goyims courberont humblement leurs têtes sous notre joug, et nous demanderont eux-mêmes de régner sur eux? ”37»
Nous ne nous arrêterons pas aux techniques de cette purge — il existe d’excellents ouvrages à ce sujet, tel celui de Christian Jelen cité plus haut — sinon en l’illustrant par une féroce anecdote qui circulait à l’époque parmi les dissidents de Varsovie:
«Deux Juifs récemment purgés se rencontrent: l’un est loqueteux, l’autre resplendissant. “Que fais-tu? demande l’un à l’autre. — Je suis balayeur de rues. Et toi? — Je vis en rentier. Du temps des nazis, j’ai été caché et sauvé par un voisin chrétien qui a maintenant accédé à de hautes fonctions politiques, dans le Parti. Alors, je le fais chanter.”»
En Occident, la purge de mars 1968 souleva une indignation unanime, exception faite pour le parti communiste français. Puis vint, en août, l’invasion militaire de la Tchécoslovaquie, que même ce parti désapprouva. À Varsovie, cependant, on continuait à dénoncer les sionistes:
«On peut désormais affirmer que le processus qui s’est engagé depuis janvier en Tchécoslovaquie prouve de façon irréfutable l’existence de forces antisocialistes, révisionnistes. On peut même trouver certaines ressemblances entre les agissements des forces réactionnaires en Tchécoslovaquie et les inspirateurs des événements dans notre pays. L’une de ces ressemblances est l’expansion du révisionnisme et du sionisme.» (Tribuna Ludu, 25-8-1968).
PLACE NETTE! (Kazakhstanskaïa Pravda, 21 juin 1967)
Au Kremlin, on couvrait alors d’injures les «sionistes tchèques» Dubcek, Hajek, Kriegel, Goldstücker… Depuis la fin de 1967, la violence de la propagande anti-israélienne s’était accrue et le ton des émissions de Radio-Moscou à l’intention des pays arabes avait changé; cette fois, les sionistes menaient le bal: «Les faits montrent que les membres des organisations sionistes contrôlent 75 % des agences de presse américaines et mondiales, la moitié des journaux nationaux et des magazines des États-Unis. Ils figurent dans les conseils d’administration de près de 40 % des principales firmes et dans ceux d’un grand nombre de banques. Ces chiffres démontrent que le sionisme contrôle les instruments les plus efficaces que l’on trouve dans les affaires publiques des États-Unis38…» Mais dans la propagande à usage interne, il faut attendre la fin de 1969 pour voir se déclencher des campagnes d’un nouveau genre. Leur forme première consista en manifestes collectifs dont les signataires condamnaient les crimes d’Israël. D’illustres noms juifs — le vieux général David Dragounski, la fameuse ballerine Plissets-kaïa — alternaient avec ceux de rabbins inconnus. Puis, en 1970, surgit le phénomène insolite du roman pornographique antisémite.
LA MAIN DANS LA MAIN (Pravda, 4 juillet 1967)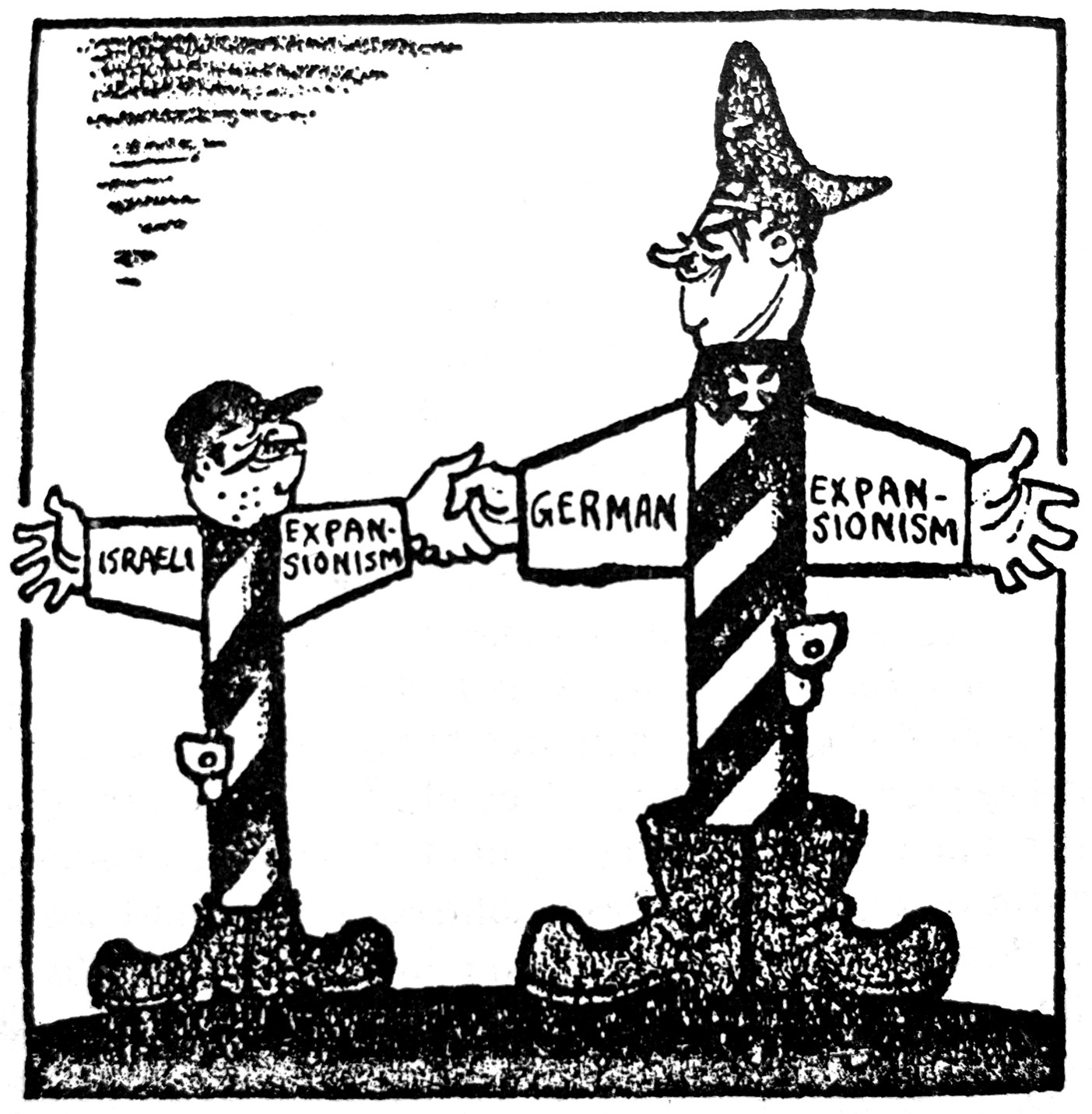
Ce genre de littérature semble se rattacher à une tendance née en Russie dans les années 1960 et reflétée par un samizdat39 à vrai dire très minoritaire, de nature franchement raciste. Tel «manifeste des patriotes russes» plaide pour une «alliance des nations indo-européennes», et réclame des mesures contre «l’hybridation chaotique» qui sévit en Russie40. La possibilité de faire officiellement éditer des professions de foi de ce genre est assez exceptionnelle. Mais elle existe, puisque l’ancien officier de marine Ivan Chevtsov a pu successivement publier ses romans Au nom du père et du fils et Amour et Haine aux éditions du ministère de la Guerre de l’U.R.S.S., respectivement en 1969 et 1970. Dans le premier livre, il était surtout question du noyautage du Comité central de Lénine par les sionistes (le complot aurait été déjoué par Staline); dans le second, des Juifs camouflés ou non convoitent, séduisent et tuent des femmes russes.
C’est ainsi que le trafiquant de drogue Nahum Goltzer, un demi-Juif (attention à l’hybridation!), tue successivement sa mère russe et Sonia Sourovtseva, après avoir abusé de cette «femme nordique»:
«Nahum était ivre de désir. La bête sauvage et l’animal de ferme cohabitaient en son sein. Assis sur le lit, et reniflant comme un taureau, il toucha les épaules tremblantes de Sonia. Parcourue par une sorte de courant électrique, elle se réfugia près du mur en criant hystériquement: N’ose pas me toucher! N’ose pas me toucher!»
Mais dûment droguée par Goltzer, Sonia finit par succomber; après quoi, il la tue et dissèque méthodiquement son corps. Plus saine, Irina Prichvina échappe à Assaf, dit Arkady Doubavine, après avoir accepté de passer la nuit avec lui, lors d’une expédition géologique dans le Grand Nord. Mais son instinct racial la protège, et au dernier moment, elle fuit, en courant jusqu’aux bords de l’océan Arctique; ce qui lui permet de découvrir que le traître Assaf lance des signaux à un sous-marin américain. On apprend en outre, dans Amour et Haine, qu’Albert Einstein avait subtilisé le manuscrit de la théorie de la relativité à un Russe, et beaucoup d’autres choses fort intéressantes. Il s’agit là d’un type d’écrit qui, abstraction faite de la théorie de la relativité, était fort répandu dans le IIIe Reich et, abstraction faite de l’antisémitisme, reste fort répandu de nos jours en Occident, sous forme de bandes dessinées. Ajoutons que Amour et Haine fut tiré à 200 000 exemplaires.
Imitation, d’une édition des Protocoles des Sages de Sion (1934) par Sovietskaya Moldavia, 4 juin 1968

En 1970, également, T. Kitchko publiait un troisième livre, Judaïsme et sionisme, tandis que de nouveaux spécialistes faisaient leur apparition. Selon Iouri Ivanov (Attention, sionisme, 1969) Ben Gourion aurait dit aux étudiants israéliens: «La carte (d’Israël) n’est pas la carte de notre pays. Nous avons une autre carte que vous autres, les étudiants, devez réaliser. La nation israélienne doit s’étendre du Nil à l’Euphrate.» Menahem Begin aurait demandé aux généraux israéliens d’être impitoyables: «Vous devez l’être, jusqu’à ce que nous ayons détruit la prétendue civilisation arabe, sur les ruines de laquelle nous construirons notre propre civilisation.»
En 1971, Evguéni Evseev publiait deux brochures: Sionisme, idéologie et politique et Le Fascisme sous l’étoile bleue, dans lesquelles il serrait de plus près la trame des Protocoles des Sages de Sion, puisqu’il y décrivait surtout l’emprise de la finance juive sur le monde (capitaliste). Une vaste place était accordée à la Banque Rothschild, étudiée pays par pays:
«En France, les possessions des Rothschild sont disséminées à travers tout le pays. Il est très difficile de les décrire… Dans la plupart des cas, les membres de la famille Rothschild ne paraissent pas eux-mêmes en public, car ils préfèrent agir par le biais de prête-noms dévoués. Certains de ces derniers sont connus, tels les défunts Raoul Dautry et Petsche, ou bien René Mayer, Raymond Aron et Ernest Mercier, ainsi que d’autres, dont on ne peut que deviner les noms» (allusion au président Georges Pompidou?).
Imitation d’une caricature du Stürmer nazi (1941) par Agitator, février 1970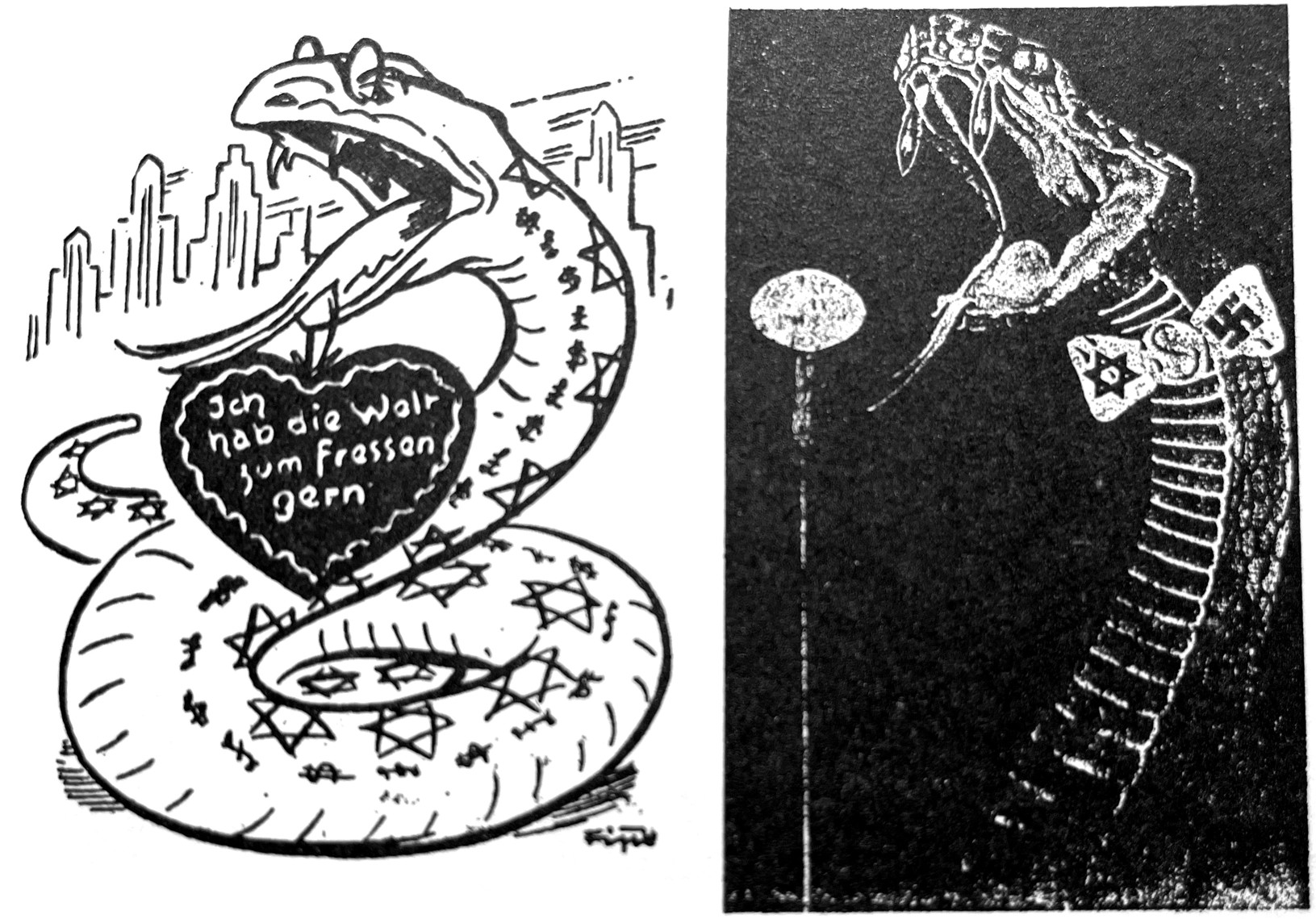
L’AGRESSEUR ET SES ACOLYTES (un rabbin et un Américain) (Novoïe Vremia, 19 février 1970)
Je ne voudrais pas remuer plus longtemps cette boue. On peut provisoirement conclure sur un épilogue qui eut pour théâtre la XVIIe chambre correctionnelle de la Cour de Paris, en mars-avril 1973.
L’agence Novosti avait envoyé à plusieurs ambassades soviétiques en Europe et en Amérique du Sud, aux fins de publication dans les pays respectifs, l’article d’un certain Zandenberg, intitulé «L’école de l’obscurantisme». Mais on ignorait apparemment à Moscou les nouvelles lois françaises sur les responsabilités de la presse, et le directeur du bulletin U.R.S.S., M. Robert Legagneux, député-maire de Nanterre, omit, selon ses dires, de lire le texte avant de le signer. Par la suite il le qualifia lui-même d’«exécrable». En effet, il justifiait amplement des poursuites pour «incitation à la haine raciale». Voici un passage de l’écrit de Zandenberg:
«…À peine les écoliers israéliens ont-ils appris à lire et à écrire, qu’à la question sur la manière dont il faut traiter les Arabes, ils répondent: “Il faut les tuer!” La barbarie commence sur les bancs de l’école…
«La plus grande partie du temps scolaire, c’est-à-dire vingt-quatre heures par semaine, est consacrée à l’étude de l’Écriture sainte, qui “inculque la conscience nationale”. De quoi traitent ces livres, quelles valeurs morales les écoles de l’État sioniste inculquent-elles à la génération montante?
«Conformément à la conception fondamentale de ces “manuels”, notamment du livre “Choulkhan Aroukh”41, le monde doit appartenir aux fidèles du tout-puissant dieu Yahveh. Les biens des non-Juifs ne leur appartiennent que provisoirement, en attendant de passer entre les mains du “peuple élu”. Lorsque ce peuple deviendra plus nombreux que les autres peuples, “Dieu les vouera tous au massacre”.
«Voici les règles concrètes des relations des Judéens avec les autres hommes, dédaigneusement qualifiés de Goyas, Akoums ou Nazarites. “Les Akoums ne doivent pas être considérés comme des êtres humains” (Orah-Haïm, 14, 32, 33, 39, 55, 139). “Il est rigoureusement interdit à un Juif de sauver la vie d’un Akoum avec lequel il vit en paix. Il est interdit de soigner un Akoum, même pour de l’argent, mais il est permis d’expérimenter sur lui l’action d’un médicament” (Yoréh-Déah 158)…»
LES TALENTS ET LES ADMIRATEURS (Vetchernaïa Moskva, 11 mars 1970)
Suivaient d’autres affabulations dûment étiquetées et numérotées. En conclusion, L’École de l’obscurantisme précisait encore que «ces lois du judaïsme sont inscrites dans le règlement de l’armée israélienne et leur violation entraîne des peines disciplinaires. Elles constituent la véritable essence de la politique de l’État sioniste».
On retiendra aussi de ce procès le témoignage du Père Michel Riquet, un ancien déporté:
«Ma déportation m’a laissé des souvenirs émouvants et fraternels des Russes qui partageaient nos souffrances, et qui me faisaient penser aux Russes de Dostoïevski et de Tolstoï; ils n’avaient pas changé. Mais je dois dire aussi que j’ai été très impressionné par une conversation que j’ai eue il y a à peine quelques mois avec un vétéran de la révolution d’Octobre et de la bataille de Stalingrad. Nous étions d’accord sur beaucoup de questions. Il était un homme sincère et loyal, mais lorsque je lui parlai d’Israël, il me sortit presque tous les arguments qu’on trouve dans l’écrit incriminé. Tels sont les résultats de cette propagande, même dans le cas d’hommes que nous avons toutes les raisons d’aimer et d’admirer, qui ont un idéal humanitaire élevé, mais qui ne connaissent pas la vérité, et qui considèrent certains hommes qui avaient combattu à leurs côtés comme des ennemis du genre humain. C’est contre cela que nous devons lutter!»
LE DRAPEAU DE LA BANDE SIONISTE (Pravda Vostoka, 15 décembre 1971)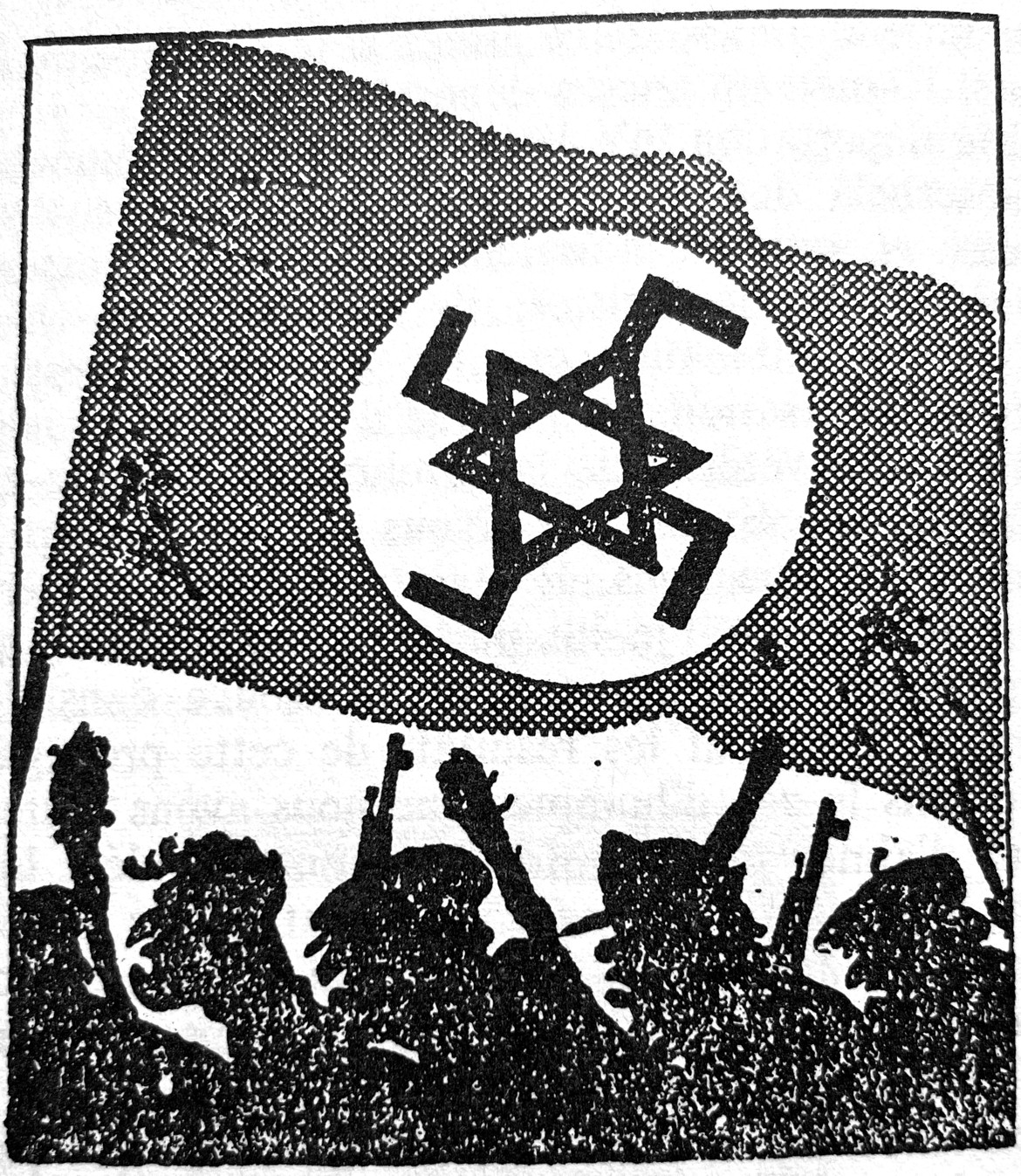
L’ensemble de la presse française ne manqua pas de parler de cette affaire singulière, à l’exception, bien entendu, des publications du parti communiste, cette fois-ci doublement concerné, puisque l’honneur du député-maire de Nanterre était en jeu en même temps que celui de l’Union soviétique. Citons le début de l’article que Le Monde consacra au procès (28.3.1973):
«Les antisémites manquent d’imagination. L’itinéraire des libelles contre les Juifs laisse en effet songeur. Les Protocoles des Sages de Sion — ouvrage apocryphe inventé de toutes pièces par un faussaire russe — fut publié par l’Okhrana, la police politique des tsars, en 1898. C’est ce texte qui était, dit-on, le livre de chevet de Hitler et qui “justifia” la politique antisémite nazie. C’est ce texte qui fut repris dans son esprit en 1906, par la même Okhrana, juste avant les pogromes de 1906 et 1907 en Russie.»
«Quels ne furent pas le mépris, l’étonnement et la honte de ceux qui lurent, en septembre 1972, dans le bulletin U.R.S.S., “émanation de l’ambassade soviétique” selon le procureur de la République, qui reprend les dépêches des agences et les articles des journaux soviétiques, un texte qui, sous prétexte de dénoncer la politique israélienne, reprenait mot pour mot — y compris les fautes d’orthographe — la propagande tsariste de 1906! À ces citations de textes saints tronqués on avait seulement substitué “sioniste” à “juif”…»
Le verdict correctionnel, rendu le 24 avril, fut pénible pour M. Robert Legagneux, condamné pour «délit de provocation à la haine et à la provocation raciale» à la peine de mille cinq cents francs d’amende.
Il restait que les véritables fauteurs de la haine se trouvaient hors d’atteinte de la justice française et qu’ils persévéraient de toutes les manières: par exemple, lors de l’occupation de l’Afghanistan, en attribuant la résistance populaire aux menées des sionistes et des impérialistes42; ou lorsque après avoir intronisé en Pologne le général Jaruzelski, ils tentèrent de contrebalancer la haine antirusse par l’antisémitisme. D’après la radio polonaise, placée sous contrôle militaire, le syndicat «Solidarité» était dominé par les Juifs et cherchait à s’emparer du pouvoir en Pologne, etc.43.
FINANSIONISME (Sotzialistitcheskaïa Industria, 16 janvier 1972)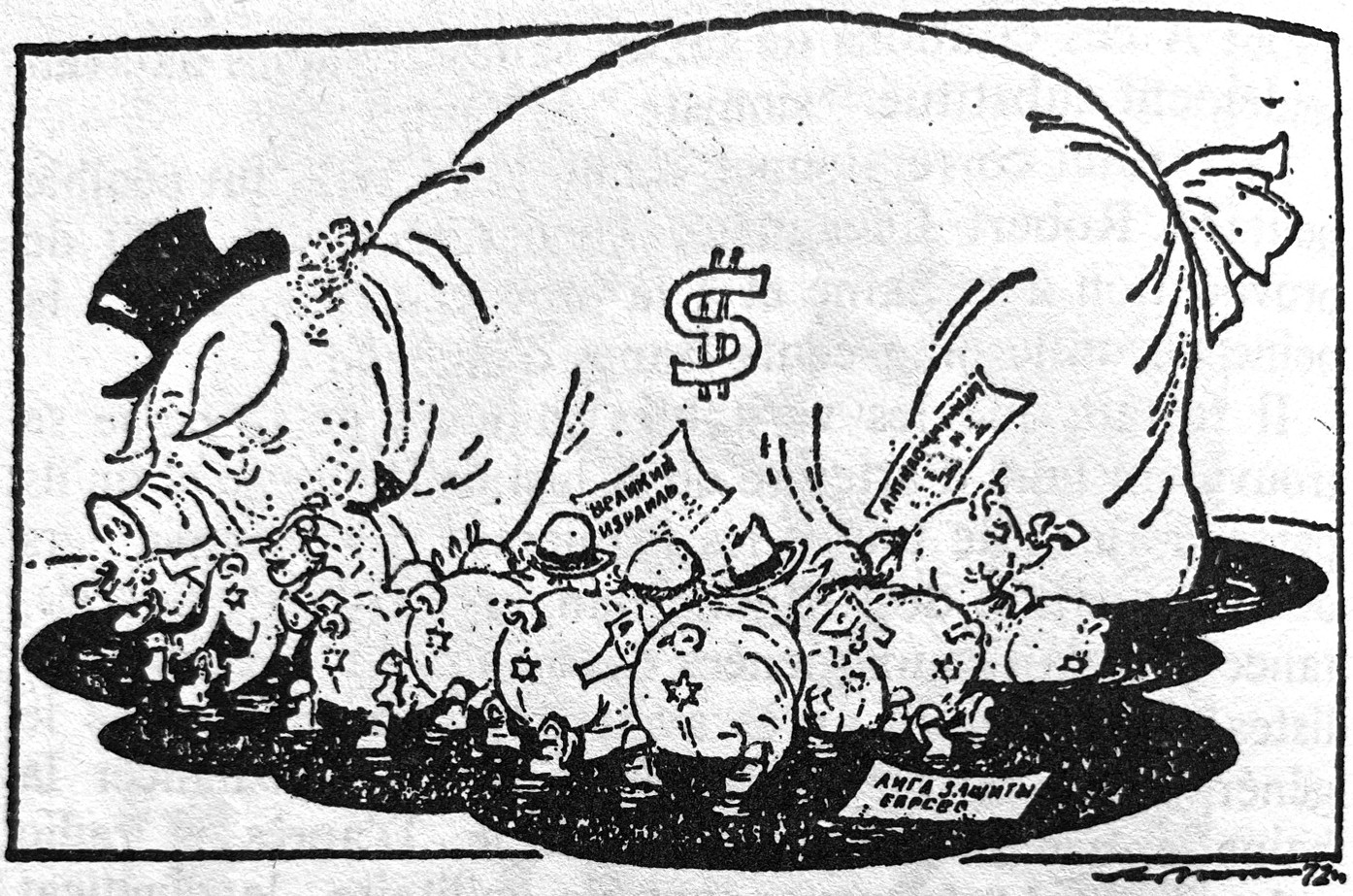
En Union soviétique même, l’antisionisme a été promu, de nos jours, au rang de doctrine scientifique, ce qui ne signifie pas qu’il soit devenu plus subtil: au contraire, il n’est peut-être pas de domaine dans lequel les auteurs usent plus de l’impérissable jargon stalinien appelé «langue de bois». J’en veux pour preuve le compte rendu de la thèse du Dr Semeniouk (Le Sionisme dans la stratégie de l’impérialisme, Minsk, 1981), paru dans Les Sciences sociales en U.R.S.S.:
«Ces temps derniers, le sionisme apparaît inévitablement à l’avant-garde des forces impérialistes réactionnaires qui s’opposent à la détente et à la normalisation des relations soviéto-américaines […] Le point de départ et l’axe de l’idéologie et de la politique sionistes consistent en conceptions bourgeoises nationalistes porteuses de racisme, de chauvinisme et de discrimination raciale. «Un mouvement fondé ouvertement sur des principes réactionnaires racistes et anti-humanistes, sur des tendances impérialistes dans leur forme extrême, réactionnaire, agressive et expansionniste, voit dans le socialisme son implacable ennemi», note l’auteur […] La principale fonction sociale de l’expansion sioniste dans les pays asiatiques, africains et latino-américains consiste dans le freinage de leur développement social et économique, et dans la lutte contre l’éveil des tendances progressistes, anti-impérialistes et anti-monopolistes, réservant ainsi pour le compte de sa propre expansion l’une des principales sources de l’enrichissement. Cette politique d’expansion et de brigandage colonialiste menée par les milieux dirigeants sionistes d’Israël soulève la juste colère et l’indignation des peuples.
«La lutte contre le sionisme, souligne l’auteur dans sa conclusion, est une lutte de classes en son principe. La dénonciation du sionisme, de son idéologie réactionnaire et de sa politique criminelle, sert les intérêts de toutes les forces de l’anti-impérialisme, du socialisme et de la paix dans le monde entier44.»
Au lendemain de la guerre du Liban, un chercheur déjà confirmé, Lev Kornéiev, publiait lui aussi ses découvertes. Dans un ouvrage intitulé L’Essence de classe du sionisme, il révélait que les sionistes, qui n’ignoraient rien des intentions meurtrières de Hitler, ne l’en aidèrent pas moins à prendre le pouvoir. Dans un autre ouvrage, paru sous le titre Sur le chemin de l’agression et du racisme, il contestait le chiffre, jusqu’alors communément admis en Union soviétique, de six millions de victimes. En conséquence, une discussion scientifique s’engagea à Moscou sur ces questions, mais on en ignore encore les résultats45.
Point final
Il nous reste à nous interroger sur les fondements réels d’une politique qui, ponctuée par la crise de démence de Staline, est allée en s’aggravant de 1948 à nos jours. En résultat, les Juifs ont définitivement réintégré leur ancien rôle de boucs émissaires. Dans le système social en vigueur, il en fallait bien un, et ils convenaient à cet emploi mieux que quiconque.
LE CHAUDRON DU DIABLE (Peretz, mai 1973)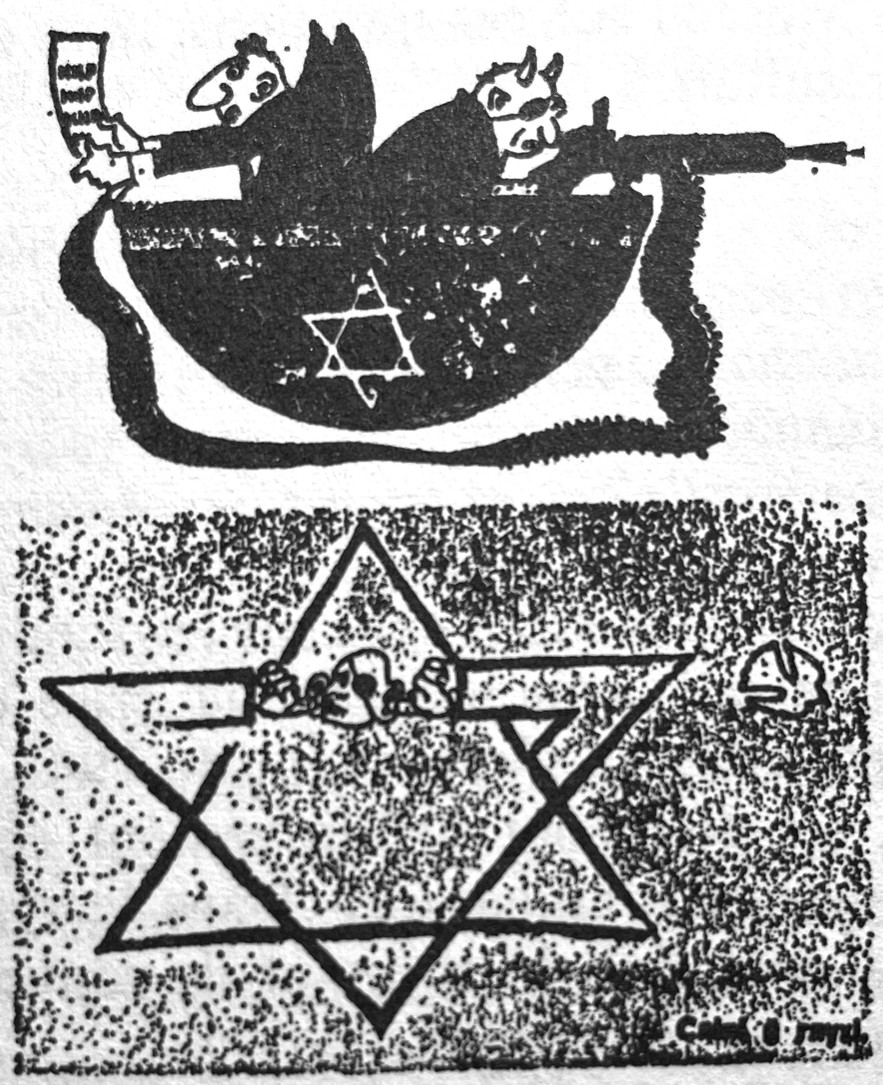
Entretenu par des pénuries de tous ordres et de vertigineuses inégalités sociales, le mécontentement est chronique en Union soviétique; la doctrine officielle, enseignée dans les universités sous le nom de «Diamat46», n’y est pas prise au sérieux (sinon à la veille des examens de sortie). En revanche, le vieux nationalisme moscovite est puissant, cimentant la collectivité russe ou grand-russe face aux ennemis désignés. À l’intérieur, ce sont en premier lieu les dissidents. Or, les Juifs ont joué un rôle notable dans le mouvement dissident; de plus, leur allégeance au judaïsme a resurgi en force, sous des formes diverses, aux temps des persécutions staliniennes. Était-ce le fait de la majorité? Je ne saurais le dire, tant est grand le nombre de ceux qui préfèrent se taire, s’astreignent à une loyauté absolue envers le régime, ou ont gardé entier soit leur amour de la Russie, soit même leur foi léniniste ou communiste.
Il n’en reste pas moins que les autorités soviétiques s’appliquent d’une part à «déjudaïser» les Juifs, et d’autre part, à diffamer le nom juif en général, de toutes les manières possibles. Signalons-en une: tant que les Juifs étaient autorisés à émigrer en Israël47, le K.G.B. se débarrassait du menu fretin des dissidents russes en leur offrant un visa israélien: ainsi donc, dissident = Juif = traître48. De même, la petite manifestation publique qui eut lieu en août 1968 à Moscou, pour protester contre l’invasion de la Tchécoslovaquie, fut dispersée par les miliciens aux cris de «sales youpins». Dans un tel climat, les objectifs paraissent évidents: intimider les Juifs, rassurer les Russes, et ils sont nombreux, qui redoutent «l’influence juive», laquelle d’après la rumeur s’exercerait même au sein du Politburo (M. Iouri Andropov serait Juif ou d’ascendance juive, etc.49.
Ces prédispositions antisémistes sont aggravées par les procédés traditionnels de la politique extérieure soviétique: la dénonciation de l’impérialisme américain, les entreprises de destabilisation, le rôle respectivement dévolu dans tous ces domaines à l’O.L.P. — et à l’État juif. Quant à ce dernier, les affirmations réitérées des dirigeants soviétiques, face à divers interlocuteurs (en 1979, face à une délégation de l’O.L.P.) sur le prix qu’ils attachent à son existence, me paraissent refléter leurs desseins véritables. Il se pourrait même que ces desseins priment sur les objectifs de politique intérieure. En effet, l’État d’Israël, à condition qu’il soit menacé, entretient la tension requise pour justifier la présence soviétique au Proche-Orient; de plus, il alimente en Occident, pays par pays, les discordes intestines qu’illustre le présent ouvrage.
Tel me paraît être l’ensemble des facteurs qui maintiennent la judéophobie officielle, face à laquelle les Juifs bon teint, une fois de plus, ont réagi en Juifs. La spirale reste donc la même.
Chapitre III
La propagande arabe
Un trait généralisé de la propagande arabe ou pro-arabe est de faire appel à des préjugés surannés et à des arguments qu’on croyait hors d’usage. Ce fut le cas d’une thèse simple et forte, naguère soutenue à l’intention de l’étranger par des intellectuels arabes: «Étant nous-mêmes des sémites, nous ne pouvons pas être antisémites.» C’est ce que disait volontiers Nasser aux journalistes occidentaux, et on retrouvait cette idée en juin 1967, dans les colonnes de L’Humanité50. Au mépris de toutes les données scientifiques — et de l’atroce leçon de choses du IIIe Reich — ces auteurs partageaient la prétendue race blanche en Sémites et… Aryens. Cette pirouette verbale me semble être tombée en désuétude, ces temps derniers; il n’en reste pas moins que des polémistes français continuent à y faire écho. C’est ainsi que M. Philippe de Saint Robert, après avoir accusé les partisans français d’Israël d’être des antisémites, concluait:
«Ils ont sans doute aussi allègrement remplacé un antisémitisme par un autre: car s’il y a bien un antisémitisme dans la France d’aujourd’hui, qui ne voit qu’il est bien davantage arabophobe que judéophobe?» (Le Quotidien de Paris, 17-3-1981).
Décidément, les confusions sémantiques de cet ordre sont indéracinables. Mais les polémistes arabes en sont eux-mêmes venus à opter pour une autre forme d’argument racial, en s’attachant à plaider que les Juifs ne sauraient prétendre à aucun lien particulier avec le sol d’Israël, tandis que les Palestiniens y seraient authentiquement enracinés. Cette thèse a été notamment soutenue au printemps 1967 par trois intellectuels arabes de gauche51. Le premier, Khaled Mohieddine, directeur de plusieurs journaux égyptiens, écrivait:
«Je voudrais rappeler que le mot “Hébreux” (Ibris) ne désigne ni une race, ni un groupe éthnique précis. Ceux qui, avec Abraham (Ibrahim), avaient colonisé l’Euphrate depuis Ur jusqu’à la Palestine formaient un mélange de groupements différant par la parenté et la consanguinité. C’est là une réalité historique incontestable.»
Le deuxième, Ahmed Bahaeidine, directeur de la revue Al Moussawa, surenchérissait:
«L’ouvrage de M. Jean-Paul Sartre nous dispense de toute autre citation. Dans son livre sur les Juifs, le célèbre écrivain affirme qu’il n’existe pas de race juive, non plus qu’un patrimoine et une histoire qui uniraient tous les Juifs, car l’histoire de l’ancienne patrie d’Israël a été interrompue depuis deux mille ans.»
COMMENT SE SERVIR DE L’ÉTOILE DE DAVID (Akhbar el-Yom, Le Caire, 3 juin 1967, Al-Manar, Bagdad, 8 juin 1967)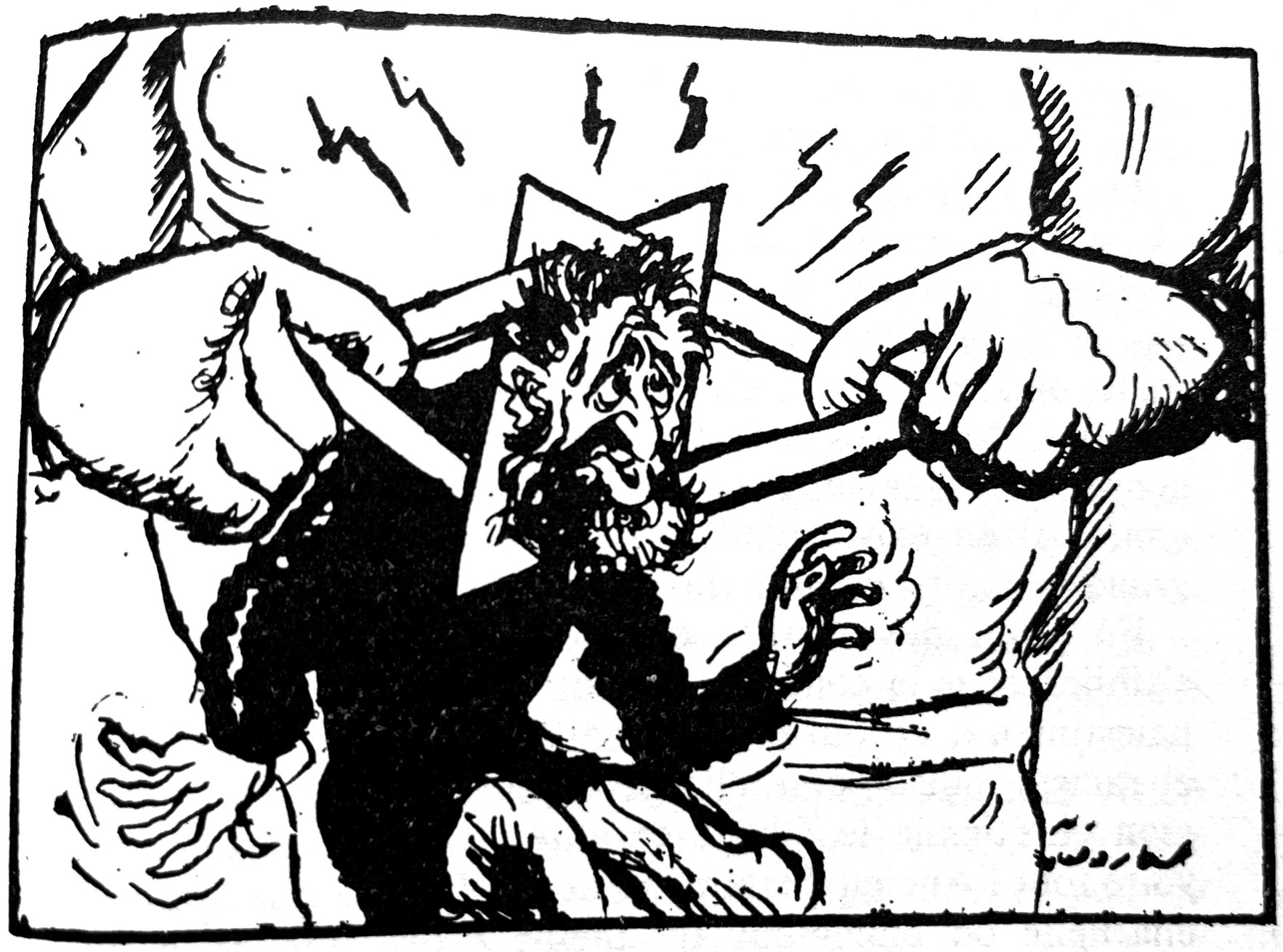
En revanche, selon le troisième auteur arabe, M. Sami Hadawi, directeur de l’Institut d’études palestiniennes de Beyrouth, les Palestiniens, eux, formaient incontestablement une race, et cette race remonterait même au début de l’histoire; il s’en expliquait comme suit:
«La population autochtone de Palestine n’a aucun besoin de prouver son droit à la terre de ses ancêtres, mais à titre documentaire, il convient de noter que les Arabes palestiniens ne sont pas, comme on croit souvent, les descendants des conquérants du désert islamique il y a 1 300 ans… Ils appartiennent, pour la plupart, à la race qui a vécu en Palestine depuis le début de l’histoire, et qui est demeurée attachée à la terre ancestrale, même sous le joug de souverains étrangers. Les philistins (de leur nom vient le mot de Palestine) n’ont pas disparu avant leur conversion au christianisme et même alors, ce ne fut que leur nom, non leur identité, qui disparut…»
On ne saurait exprimer plus clairement qu’une nation est un fait uniquement biologique, qu’une culture se transmet uniquement par les gènes. On ne reprochera pas ici à M. Hadawi d’ignorer la génétique contemporaine, on le renverrait plutôt à un célèbre essai du vieux Renan52. Nous reviendrons aux argumentations de ce genre, qui d’une certaine façon se durcissent d’année en année. Il en existe d’ailleurs une variante, qui eut un grand retentissement à travers l’Occident.
En effet, des Arabes chrétiens prirent le parti de s’affilier, sous la conduite de leurs prêtres, à un «Christ palestinien», ce qui est une hérésie à la fois gnostique et raciste, puisqu’une telle généalogie évacue de la religion chrétienne le Christ enfanté par une mère juive, voire tout l’Ancien Testament, et y substitue une filiation charnelle ou biologique du même ordre que celle du redoutable «Christ aryen» de l’Allemagne nazie53. À Noël 1972, cette théologie, fantasmée à ce qu’il semble dès 1967 à Beyrouth, trouvait un premier et timide écho dans le Monde: le correspondant du journal à Bethléem y évoquait la «colline où le Christ est né il y a à peu près deux mille ans (et où) une Palestinienne vit aujourd’hui avec ses deux filles, dans une grotte semblable à celle où Jésus vit le jour». Depuis, j’ai relevé des idées semblables, sous une forme plus explicite, dans la page «Idées» du Monde, le plus souvent sous la plume de prêtres, soit arabes, soit français.
Un illustre juriste, Raymond de Geouffre de la Pradelle, s’en fit l’interprète exalté en août 1982, c’est-à-dire au plus fort de la surexcitation des mass media parisiens. La violence imprécatoire de M. de la Pradelle est restée sans égale:
«… Il est temps — est-il encore temps — que cessent ce génocide et cette apocalypse qui déshonorent l’humanité. Quand notre Occident façonné, en dépit de ses convulsions, par vingt siècles de christianisme, se souviendra-t-il enfin, pour imposer une paix durable, que le Nazaréen ressuscité, aux blessures ineffaçables, est bel et bien palestinien54?»
Un an après, M. Yasser Arafat proposait une vision diamétralement opposée: «Jésus-Christ était le premier des fedayin, l’épée à la main…55» Mais laissons pour le moment cette théologie aux spécialistes…
La voix des arabes
Les Arabes sont un peuple méditerranéen, et comme tel, porté à l’hyperbole, surtout en matière politique. La langue arabe, qui de tout temps a excellé dans l’art de la rhétorique, se prête encore mieux que la langue hébraïque aux images expressives, dont les appels à la guerre sainte peuvent faire partie. Ces appels invoquent volontiers un glorieux passé, et c’est ainsi que le 15 mai 1948, lorsque la coalition des armées arabes se lança à la conquête d’Israël, les radios arabes annonçaient: «Ce sera une guerre d’extermination mémorable, que l’Histoire relatera au même titre que les massacres des Mongols ou des Croisés» (cité par la B.B.C.).
Mais les Juifs étaient des ennemis d’un autre genre que les Mongols ou les Croisés, puisque ennemis méprisables au premier chef. Un bref rappel de la relation judéo-arabe à travers les siècles s’impose ici.
Cette relation était moins inextricable — et moins paradoxale — que la relation judéo-chrétienne, puisque l’Islam ne se réclamait nullement de l’Ancien Testament des Juifs. Le principe général se trouve posé dans le Coran: les païens doivent être passés au fil de l’épée, mais les «peuples du livre», c’est-à-dire les chrétiens et les Juifs, doivent être épargnés: tolérés à titre de protégés («dhimmi»), ils sont astreints à payer tribut aux vrais croyants, et à témoigner de diverses manières de leur soumission et de leur infériorité. Dans ces conditions, les Juifs, moins nombreux que les chrétiens, n’eurent pas le désastreux privilège d’être les seuls infidèles, les seuls boucs émissaires; ils n’en furent pas moins souvent persécutés, et en règle générale méprisés: «yahoudi» avait en arabe à peu près la même tonalité que «youtre» ou «jid» dans les idiomes européens. D’autant que le Coran n’est pas tendre pour ces infidèles-là, qui ont récusé l’enseignement du Prophète:
«Nous les avons maudits, et nous avons endurci leurs cœurs. Ils ont détourné de leur sens les paroles de leurs Écritures, et ils ont oublié une partie de ce dont ils devaient se souvenir. Ne cherche pas à connaître leur perfidie; il en est peu qui fassent exception56…»
Il y avait de quoi, pour les théologiens musulmans, justifier la destruction de l’État juif, et ils s’y emploieront en temps utile. En attendant, cela suffisait pour que les chefs des États arabes veuillent se venger d’une défaite militaire infligée par des êtres aussi méprisables. D’ailleurs, seul un complot mondial pouvait raisonnablement expliquer pareil renversement des rôles.
Il est d’autant plus remarquable que la Philosophie de la révolution (1952), écrit prétendument «Goebbelsien» de Gamal Abdul Nasser, qui exhortait les Arabes à rétablir leur antique hégémonie, ne manifestait pas d’animosité particulière envers les Israéliens. Toute sa rancune, toute sa haine allaient alors au colonialisme authentique, c’est-à-dire à la Grande-Bretagne, et il ne se cachait pas d’avoir conspiré en 1941-1943 avec les nazis, au nom de la liberté égyptienne. En 1952, les «forces hostiles» restaient pour lui les impérialistes occidentaux. Israël n’était que «le nouveau-né de l’impérialisme», engendré par la perfidie britannique. Comme l’a formulé M. Eric Rouleau, «Nasser a presque toujours placé la Palestine au second plan de ses préoccupations57».
Si l’on regarde les textes de près, ce n’est qu’en 1955, l’année de Bandoeng, que la propagande anti-israélienne s’exaspéra au Caire:
«Notre guerre contre les Juifs est une vieille lutte, qui débuta avec Mahomet… Notre devoir est de nous battre contre les Juifs, pour l’amour de Dieu et de la religion, et il est de notre devoir d’achever la lutte que Mahomet a entreprise…» (Al Ahram, 26-11-1955). «Israël rêve d’établir son régime criminel, de réduire le monde entier en esclavage et de répandre terreur et corruption afin de s’assurer la domination du monde… La Bible d’Israël prêche une barbarie inhumaine, symbolisée par la crucifixion du Christ et la torture de ses disciples…» (Voix des Arabes, 6-8-1956).
Ou encore:
«Dieu a rassemblé les sionistes des quatre coins du monde, de sorte que les Arabes puissent les anéantir d’un seul coup…» (6-9-1956).
À la veille de la guerre de Suez, les Turcs étaient eux aussi mis en cause:
«La raison de la haine des leaders turcs envers les Arabes est à chercher dans leurs origines juives…» (Al Ahram, 29-9-1956).
En même temps, des fedayin formés par le gouvernement égyptien dans la bande de Gaza poursuivaient leurs incursions dans le sud d’Israël, multipliant les massacres et les brigandages; un jeune étudiant apparenté au Mufti de Jérusalem, Yasser Arafat, fit à ces occasions ses premières armes de terroriste. S’imagine-t-on les réactions françaises, si des irrédentistes italiens se mettaient à pratiquer à Nice ou à Cannes un terrorisme aveugle? Les réactions conformes israéliennes se donnèrent libre cours en octobre 1956, lorsque Londres et Paris, ces «frères majeurs», tentèrent, après la nationalisation du canal de Suez, d’abattre le régime révolutionnaire de Nasser. Mais comme on le sait, cette aventure militaire fut stoppée net, sur l’ordre conjoint du président Eisenhower et de Nikita Khrouchtchev. Pourtant, le général Dayan conquit en trois jours le désert du Sinaï, et ne se retira que moyennant des garanties internationales: un rideau de «Casques bleus» de l’O.N.U. mit provisoirement fin à la guérilla arabe. Mais non à l’agitation antisémite. Tirant leurs conclusions des «contradictions impérialistes», l’Égypte et la Syrie décidaient de s’équiper en armes ailleurs, et devenaient les clients attitrés de Moscou; mais en ce qui concerne la propagande anti-israélienne, ils préférèrent s’adresser aux spécialistes chevronnés du IIIe Reich. Accommodés au goût arabe, les ouvrages nazis classiques, Mein Kampf compris, furent désormais publiés au Caire et à Beyrouth: cent millions d’Arabes, sans compter les Pakistanais ou les Indonésiens, ne représentaient-ils pas un marché immense? Les ex-adjoints de Goebbels, Johannes von Leers, Leopold Gleim, Ludwig Heiden, se convertirent à l’Islam et s’établirent sur place. Des traités indigestes commencèrent à faire leur apparition en arabe et en anglais: Talmudic Human Sacrifices (1962), The Danger of World Jewry for Islam (1963), Why I hate Israël (1964), Sexual Crimes of the Jews (1965), et bien d’autres. Mais ce n’est pas à eux qu’il faut accorder la palme.
Disons d’abord quelques mots du coup d’éclat de Léopold Gleim et Ludwig Heiden qui, lors du concile Vatican II, parvinrent à entraver les efforts entrepris par le pape Jean XXIII pour rendre pleinement justice aux Juifs. Le schéma théologique primitif, rédigé par le cardinal allemand Augustin Bea, envisageait de confirmer leur lien spécial avec la terre ancestrale, et de préparer la reconnaissance de leur État par le Saint-Siège. Pour déjouer ce projet, Gleim et Heiden rédigèrent un ouvrage intitulé Le Complot contre l’Église, qui fut diffusé à l’échelle mondiale. Ils avaient tiré de leur sac toutes les vieilles ficelles nazies: le cardinal Bea était juif, ses collègues occidentaux avaient été bernés ou corrompus, l’Église romaine était entachée de l’hérésie judaïque. Du Moyen-Orient à l’Amérique latine, nombre de prélats se laissèrent impressionner, et au Concile, les protestations et les amendements fusèrent. En résultat de quoi, les Arabes eurent gain de cause sur tous les points proprement politiques. Pourtant, cette victoire fut éclipsée par le prodigieux succès des Protocoles des Sages de Sion. La première traduction arabe d’après-guerre était publiée en 1951, et rééditée en 1957; l’année suivante, Nasser en personne offrait un exemplaire anglais au rédacteur du journal indien Blitz; des extraits étaient insérés dans les manuels égyptiens à l’usage des lycéens et des officiers. Le nombre total des éditions arabes connues dépasse la dizaine. Celle de Beyrouth 1967 devint le best-seller des ouvrages documentaires58. L’écrit retrouvait de la sorte sa gloire d’antan. Rappelons que sa raison première avait été de mettre en garde les tsars contre la montée des régimes démocratiques; vingt ans après, il avait servi à justifier la grande peur bourgeoise, préparant le terrain pour le IIIe Reich; voici qu’il venait consoler les Arabes de leurs défaites.
J’ai devant moi un exemplaire de l’édition de Beyrouth 1967, offerte en 1974 par le roi Fayçal d’Arabie aux diplomates et journalistes français, lors du voyage de M. Michel Jobert. Calquée sur une version française de 1925, cette édition en conservait la préface, où les Sages de Sion étaient accusés d’être les fauteurs du bolchevisme. Mais un avant-propos de M. Faëz Ajjaz, qui n’avait cure ni de Marx, ni de Trotski, contenait un message autrement grave:
«L’année 1967 fera date — sans doute — dans l’histoire du Moyen-Orient arabe en particulier, et dans l’histoire de l’humanité en général…
«Car c’est au cours de cette année, et plus précisément le 5 juin 1967, que le peuple de Sion confirma, pour la première fois de son histoire, l’authenticité d’un document publié en 1905 et qui n’a cessé depuis sa parution de faire couler un flot d’encre et de soulever un ouragan de polémiques […].
«Je voudrais simplement rappeler aux lecteurs de cet ouvrage l’attitude pro-juive et anti-arabe adoptée par la majorité des peuples de l’Europe et de la communauté chrétienne dans le monde, au cours des événements de juin 1967, et les mettre à nouveau en présence du danger réel que représente Israël, non point pour les Arabes et les musulmans seuls, mais surtout pour les chrétiens et l’humanité tout entière…
«Puisse la divinité éclairer tous les chrétiens du monde à réaliser le danger, et à unir leurs efforts aux nôtres pour le bien de la race humaine toute entière.»
L’impossible dialogue
Rien ne paraissait annoncer, au début de l’année 1966, que le Proche-Orient allait s’embraser en juin 1967, lorsque Jean-Paul Sartre conçut le projet de faire dialoguer, dans un volume spécial de sa revue Les Temps Modernes, des Israéliens et des Arabes indépendants ou oppositionnels («de gauche»). La réalisation ne fut pas facile, en raison des conditions posées par les auteurs arabes59: ils se voulaient tous du même avis, jetaient l’interdit sur les mal-pensants et tenaient à rester groupés à l’écart des Israéliens, à l’intérieur du fascicule.
Les styles étaient aussi différents que possible. Les Israéliens pesaient longuement le pour et le contre, et parfois se mettaient eux-mêmes en accusation. Suggestifs, à cet égard, sont les titres de certains de leurs articles: «Sortir du cercle vicieux de la haine» (M. Sneh), «Une guerre fratricide entre Sémites» (U. Avnéri), «Le dialogue entre socialistes arabes et israéliens est une nécessité historique» (S. Flapan), ou même «Réflexions bi-nationales» (Y. Amitay). Nahum Goldmann ne craignait pas de convenir que juridiquement, Israël se trouvait en mauvaise posture: «Il n’y a pas de doute que, selon les critères et les principes du droit international, la requête du peuple juif en vue de l’établissement de son État dans un pays où il se trouvait en très faible minorité en 189760 était irrecevable.» Shimon Pérès mettait en garde contre les espoirs inconsidérés:
«Nous n’avons pas le droit de nous masquer la vérité, de nous abandonner à des illusions ou à des croyances faussement optimistes… La paix n’arrivera pas facilement: le jour le plus favorable pour sa venue sera celui où toutes les parties en cause reconnaîtront que la guerre n’apporte aucun espoir.»
Le doyen de la faculté de philosophie de Jérusalem, Zwi Werblowski, n’hésitait pas à mettre en cause l’égocentrisme israélien:
«Est-ce trop demander que d’espérer que la réincarnation concrète de l’ancienne idée historique de l’État d’Israël amène nos voisins arabes à accepter cette idée comme ils ont accepté le reste de la réalité? Mais avant que les Israéliens se permettent d’exprimer un tel espoir, ils devraient peut-être se défaire de leur égocentrisme et comprendre l’énormité de ce qu’ils souhaitent. Que cette demande soit acceptée ne dépend pas d’Israël, mais qu’elle soit rendue acceptable est, en partie tout au moins, sa responsabilité.»
L’impossible aspiration à une justice absolue se trouvait encore mieux reflétée par un philosophe sorti des rangs de l’armée israélienne, le général Harkabi:
«Sans aucun doute, écrivait-il, l’idéal sioniste est en lui-même quelque chose de noble et de grand; il est malheureusement vrai qu’il n’a pu se traduire dans les faits qu’aux dépens d’autrui. C’est pourquoi, les observateurs extérieurs peuvent difficilement y voir la blancheur immaculée de l’innocence. Les crises de conscience et les remords touchant le problème arabe ne sont pas suffisants. La tragédie dans laquelle le sionisme se trouve plongé consiste en ce que, sans ce tort causé aux Arabes, il n’aurait pas pu se réaliser. […] Voir l’ensemble de la situation nous entraîne à donner trop d’importance aux raisons de l’adversaire et à condamner notre propre parti, mais inversement une vision partielle des choses a l’inconvénient d’exalter le sentiment de notre droit avec les dangers que cela comporte.»
Les seize articles arabes étaient plus brefs. Leur tonalité générale trouvait également son reflet dans les titres, volontiers ornés de guillemets; le premier s’intitulait: «Les revendications “bibliques” et “historiques” des sionistes sur la Palestine» (S. Hadawi), le dernier: «Pourquoi le “non” au dialogue?» (A. Elsamman). On pourrait recenser les erreurs ou les mythes (celui d’un Israël visant à s’étendre du Nil jusqu’à l’Euphrate était récurrent), ou relever les franches affabulations, la plus étonnante étant celle de l’Égyptien Khaled Mohieddine, qui évoquait le «fondateur britannique du sionisme», un personnage inventé de toutes pièces:
«Nous nous souvenons de Camille Bitterman, président du Conseil britannique. En 1907, il forma une commission dont les membres étaient d’illustres historiens et de grands sociologues européens. Elle avait pour mission l’étude des moyens susceptibles de perpétuer la domination impérialiste dans le monde entier.» Le pseudo-Premier britannique ayant brossé un tableau tragique de la décrépitude physique et morale des Européens, la commission aurait préconisé, à titre de remède stratégique, l’érection d’une «barrière humaine puissante et étrangère à la région — pont reliant l’Asie à l’Afrique — de façon à créer dans cette partie du monde, à proximité du canal de Suez, une force amie de l’impérialisme et hostile aux habitants de la région».
Et M. Mohieddine de conclure:
«Oubliant tous les autres projets concernant l’établissement d’un foyer national juif en Afrique ou en Amérique du Sud, les dirigeants sionistes répondirent rapidement et favorablement à ces suggestions61.»
On est gêné de produire de telles citations. Du reste, plus pertinent pour la compréhension de l’état d’esprit des militants arabes de gauche me paraît être l’abus des termes en isme — laïcisme, colonialisme, expansionnisme, impérialisme, et surtout socialisme — qui semblent, pour nombre d’entre eux, avoir, en soi, valeur d’explication. D’autres auteurs s’empêtraient dans le jargon léninomarxiste qui dans les milieux de gauche était quasiment de rigueur, il y a une vingtaine d’années.
Certains pratiquaient un tout autre langage, direct et laconique. Écoutons Tahar Benziane: «La Palestine n’aura pas d’autre solution que de rejeter ce corps étranger et agressif, qui ne veut pas s’intégrer aux lois élémentaires de l’humanité.» Ou Abdul Kayyali: «En fait, le corps et le cancer ne peuvent pas coexister; la lutte entre eux est une lutte pour l’existence.» Pour qui sonne le glas? Comme le notait à l’époque Jean Lacouture, «en affirmant son adversaire inexistant, (le monde arabe) croit affirmer sa propre existence62». Le besoin de cette affirmation aboutit logiquement à la paranoïa de M. Ahmed Ben Bella, qui, après avoir agité — en été 1982 — le spectre de l’Apocalypse atomique, concluait:
«Ce que nous voulons, nous autres Arabes, c’est être. Or, nous ne pourrons être que si l’Autre n’est pas63.»
Je ne sais si la pensée, ainsi exprimée, est elle aussi «de gauche». Comment cerner d’une manière précise ce genre d’appartenance? Dans le cas des Arabes, le principal critère me semble être l’absence, dans leurs écrits, de citations du Coran et de références au Prophète. Corrélativement les textes de cet ordre, indéfiniment répétés, paraissent circonscrire le camp des Arabes catalogués «de droite».
En septembre 1968, au lendemain des fameux «trois non» de Khartoum64, les théologiens arabes les plus éminents, au nombre de soixante-dix-sept, furent réunis à l’université Al-Azhar du Caire65. Le vice-président égyptien, Hussein El-Chafiqui, les convia à «la mise en œuvre totale de la guerre sainte et capitale contre nos ennemis et les ennemis de Dieu». Les membres de la conférence se mirent aussitôt à la tâche. Ils avaient, semble-t-il, bien retenu les nouvelles leçons de Johannes von Leers et de ses collègues, puisque le premier orateur, M. Adbul Own, annonçait que «les Juifs modernes ne sont pas de race pure». Jadis, ils avaient été tellement haïs et persécutés que «seuls échappèrent à la destruction les prisonniers juifs et les vagabonds sans but». Ils étaient donc des esclaves nés, et dans le présent encore, «on ne peut s’attendre à rien de bien de leur part, s’ils ne vivent pas sous l’égide de l’Islam en sujets loyaux et obéissants». Cette mise en garde portait loin, en dévoilant une raison capitale de la rancune des Arabes envers l’État souverain juif. M. Own annonçait aussi que la Bible juive reposait sur un mensonge, puisqu’elle niait qu’Abraham était un prophète arabe, installé au Hedjaz, en prévision de l’avènement de l’Islam, qui serait révélé par un prophète plus grand que lui. Et de dénoncer les faussaires juifs qui, du VIIe siècle au xxe, corrompaient la tradition et semaient des hérésies. Les griefs anciens venaient prêter appui aux griefs modernes.
Plus spectaculaire, le modernisme des théologiens arabes de l’an 1968 relevait de l’invocation des lois de la nature. Exactement comme dans la perspective nazie. Les Juifs étaient irrécupérables: ils avaient «les mêmes attributs que leurs ancêtres, bien que leur environnement et leur situation aient été différents. Tout le monde ressent cette nature innée des Juifs, partout et tout le temps». Une nature au surplus contagieuse: «Ceux qui ne sont pas d’origine juive ont acquis ces traits en cœxistant avec eux, c’est-à-dire par le contact avec ceux qui sont d’origine juive» (M. Muhammad Azzah Darwaza).
Il faut convenir que les Arabes de gauche n’allaient pas si loin. D’autre part, ceux de droite, tout en accordant leur propos avec l’âge de la science, savaient aussi prodiguer des paroles d’espoir:
«Le nouvel État d’Israël, en tant que création forcée et artificielle, est totalement inadéquat et incapable de survivre, particulièrement en Palestine. Ce verdict est dicté par la loi fondamentale de la lutte pour la vie […]. Qu’adviendra-t-il quand les Arabes auront acquis de la puissance, grâce aux progrès de la science et de la technologie» (cheikh Nadim Al-Jisr).
Tel ne paraissait pas être l’avis de M. Hassan Khaled, mufti de la république libanaise. Dans sa conférence, il mettait à nu les faiblesses et les compromissions de la société arabe contemporaine:
«Notre société islamique d’aujourd’hui est composée de membres disloqués, d’un corps fracassé et d’un caractère dissolu. […] Si ses membres encore intègres veulent l’arracher à sa chute, cela ne saurait être possible sans orientation, éducation et information. Malheureusement, cela aussi est insuffisant pour une nation devenue une proie facile des chiens de l’humanité, la victime d’un peuple sans terre, à quoi vient s’ajouter sa propre corruption.»
* *
*
Ces dispositions ont-elles changé depuis 1967-1972? Il ne le semble pas. On peut même alléguer, en se fondant sur le cas de l’Égypte, qu’elles ont empiré.
En décembre 1973, au lendemain de la guerre du Kippour, un journaliste tunisien de gauche, F. D. Attar, résumait les obsessions égyptiennes:
«L’opinion accrédite encore les légendes du Juif ennemi de Dieu. Les journaux rapportent l’étymologie du mot “Israël” disant qu’il se décompose en “Isra”, assassin, et “el”, Dieu, d’où un glissement effrayant vers la guerre sainte et une confusion obscurantiste qui aide le pouvoir à dépolitiser les citoyens et à détourner les masses des vraies préoccupations politiques» (Contact, Tunis 25-11/10-12-83)66.
Certes, ces humeurs régnaient à la suite d’un échec militaire. Mais après 1977, l’option pacifique d’Anouar el-Sadate ne fut suivie d’aucun changement, dans la littérature ou dans la presse. Des traités de propagande antisémite sont toujours publiés au Caire. J’ai eu l’occasion d’en voir deux. L’un, plus populaire, est fondé sur la légende selon laquelle des Juifs ont tué le Prophète; il en découle que tous leurs malheurs anciens ou modernes, y compris les persécutions hitlériennes, ne sont que le tribut permanent fixé par Allah pour ce crime. L’autre, à prétentions plus scientifiques, puise dans la production du IIIe Reich, adaptée à la conjoncture, et attribue aux Juifs les crises et conflits dont souffre le monde arabe. Mais en l’occurrence, il existerait un remède:
«Si Israël souhaite véritablement la sécurité, il doit se détourner de la pensée sioniste et suivre rigoureusement la Torah, le livre donné par Moïse dans sa forme non adultérée, conformément aux principes musulmans67.»
Des points de vue de ce genre se retrouvent dans la presse de toutes tendances. On n’est pas étonné d’en relever dans la revue fanatiquement intégriste El-Daoua, qui, à la veille de la signature de la paix israélo-égyptienne, proclamait: «Les Juifs sont des usurpateurs et des agresseurs. On ne peut rien attendre d’eux. Il ne peut y avoir de paix avec eux, mais seulement la guerre sainte. Ils doivent vivre en tant que minorité.» En avril 1980, la même revue dressait la liste des «douze vices juifs», parmi lesquels figuraient, outre l’amour de l’argent et l’égoïsme, le racisme aveugle et le désir de détruire le monde. En octobre, elle allait plus loin: dans son supplément pour les jeunes elle s’employait, dessins à l’appui, à enseigner aux enfants musulmans comment reconnaître les Juifs. Rien n’y manquait, pas même le nez crochu, les ongles dégoulinant de sang, l’étoile de David sur la houppelande… «Ô lionceau musulman, anéantis leur existence, car les Juifs ne t’aiment pas, toi qui révères Dieu! 68»
Les variations sur ces thèmes étaient fréquentes dans les journaux de tous bords. C’est ainsi que le 12 avril 1981, l’hebdomadaire pro-gouvernemental Octobre faisait ouvertement l’apologie de Hitler qui aurait eu pour seul but de mettre fin à la dégradation éternelle à laquelle l’alliance anglo-franco-sioniste avait condamné l’Allemagne en 1918. Le 3 mai 1981, on lisait dans le même organe que la paix entre Israël et les Arabes était impossible, parce que les Juifs ne pouvaient l’accepter. Et pour cause! Ils ne pouvaient qu’y perdre, puisque la haine des nations constituait leur arme la plus puissante: «Si nous les privons de la possibilité de susciter la pitié du monde, ils y perdront matériellement et moralement. Ils ne peuvent subsister qu’en vendant leurs larmes au prix le plus élevé.» Ce raisonnement trouvait son couronnement le 15 juin dans l’officieux al-Ahram, qui complimentait Menahem Begin de ne pas pratiquer les mensonges ni jouer les comédies propres aux Juifs: «Il ne cherche nullement à dissimuler son laid visage de terroriste ni la longue histoire du sang versé par lui.» Nous oserons dire que l’ingéniosité des antisémites égyptiens ne connaissait pas de limites: le 12 juillet 1982, al-Ahram résumait en deux lignes la principale raison de la naissance du sionisme:
«Le désir des nations de l’Ouest et de l’Est de se débarrasser d’un nombre aussi élevé que possible d’échantillons de cette erreur humaine qui porte le nom de Juifs.»
Sans continuer indéfiniment ce florilège, on relèvera l’originalité de l’hebdomadaire oppositionnel al-Cha'ab, de tendance social-nationaliste, qui au printemps 1981, autrement dit du vivant même de Sadate, consacrait une série d’articles à l’histoire de la conspiration des Juifs à travers les âges. D’une manière générale, «ils furent les premiers à pratiquer l’assassinat dans la société humaine», notamment en lapidant leurs propres prophètes. Le complot proprement sioniste, celui des Sages de Sion, aurait été monté au lendemain de la captivité babylonienne, et consigné par écrit dans la Torah juive. C’est dans ce cadre que les sionistes fondaient au cours des siècles des sociétés secrètes de tout genre, en premier lieu l’ordre des Francs-Maçons:
«Les sionistes l’utilisaient pour noyauter les gouvernements et les institutions commerciales et financières. Ils ont ainsi fomenté des guerres et des révolutions en France, Hongrie, Allemagne, Turquie et Russie. Ils jouèrent un rôle décisif en déchaînant la Première Guerre mondiale, qui aboutit au traité de Versailles, négocié dans le plus grand secret à une convention maçonnique. On peut dire sans exagérer que la grande révolution russe fut l’œuvre des Juifs, adeptes de l’école marxiste. Il est donc évident que la maçonnerie possède deux faces: une face destructrice communiste pour la Russie, et une autre, capitaliste-sioniste, pour l’Ouest, afin de semer, conformément aux Protocoles, la zizanie entre l’Est et l’Ouest…»
Quant à la paix israélo-égyptienne qui venait d’être signée, al-Cha'ab la commentait en ces termes:
«Israël est un État raciste, qui cherche à s’étendre du Nil à l’Euphrate, dans la conviction d’être le peuple élu; la preuve en est la hâte et l’ardeur avec lesquelles il cherche, après la paix, à normaliser les relations, pour nous injecter rapidement et immédiatement ses poisons.»
On peut observer à ce propos que si ce genre de littérature n’était connu en Occident que de quelques rares experts, les Israéliens dans leur ensemble n’en ignoraient rien, et en tiraient les conclusions amères qui s’imposaient.
Il reste peut-être à ajouter que ces élucubrations ne se limitaient pas à l’Égypte, et que les spécialistes marocains, par exemple, anticipaient sur les spécialistes soviétiques, puisque dès mai 1982, L’Opinion de Rabat annonçait que le nazisme était l’œuvre du sionisme qui «par Hitler, a créé Israël69».
Les relais de la propagande arabe
La désinformation soviétique, relayée à travers le monde par les partis communistes pour l’essentiel, trouve en Occident un terrain favorable dans des milieux fort divers: non seulement chez les anciens sympathisants ou chez les jeunes pacifistes, mais aussi parmi les extrémistes de droite, notamment les nostalgiques du IIIe Reich. La désinformation arabe emprunte d’autres canaux. Il s’agit, en premier lieu, des milieux islamophiles (à distinguer des «arabophiles»), beaucoup plus vastes qu’on ne le croit. En France, leur noyau est constitué par les 100 000 à 200 000 citoyens convertis à l’Islam, parce que séduits par ses certitudes, par une métaphysique qui préfère le symbole à la réalité70. Ces chercheurs de l’Absolu — ou ces dilettantes parisiens — surgissent surtout dans les milieux où l’on stigmatise le vide intellectuel de notre temps; croit-on qu’il y ait beaucoup de simples mortels parmi eux? En un sens, ils constituent une élite, mais proche de celle qui, au lendemain de la dernière guerre, s’était assujettie à la dogmatique stalinienne, en comparaison de laquelle les dogmes de l’Islam paraissent une oasis de liberté. Or, cette élite comprend des formateurs de l’opinion publique, écrivains ou éditeurs, journalistes ou professeurs. Songeons au cas de M. Roger Garaudy, qui fut dans les années 1960 le penseur attitré du parti communiste français. D’un opium à l’autre…
Dans leur mouvance évoluent des sympathisants très divers allant des islamisants amoureux de leur sujet, en passant par quelques prêtres naïfs, aux animateurs des nombreuses sociétés d’amitié franco-musulmane ou franco-arabe. Je ne pense pas que ceux qui sont motivés par des intérêts terre-à-terre soient forcément des zélateurs de la propagande anti-israélienne. Il devrait en aller autrement pour les idéalistes. Mais voici que nous nous rapprochons d’un domaine très différent.
Pétrole… Partie invisible de l’iceberg? Ces profondeurs ne sont pas faciles à sonder. L’imagination risque de s’en mêler: j’ai suffisamment étudié les mythes des Juifs, maîtres du monde, pour ne pas me méfier des interprétations qui font appel à quelque «main dans l’ombre». Sans parler de la pudeur propre aux Français, dès qu’il s’agit d’affaires d’argent. Aux États-Unis, la brutale franchise américaine soulève mieux certains coins du voile; des commissions d’enquête s’en sont mêlées, du reste, permettant à un spécialiste, Hoag Levins, d’écrire que:
«les flots d’argent qui circulent quotidiennement entre le monde du pétrole islamique et les États-Unis sont vastes au point d’avoir indissociablement entrelacé l’économie nationale et la stabilité fiscale de ces deux régions. Un effondrement du système économique et bancaire américain entraînerait une catastrophe semblable dans la vie de nations moyen-orientales telles que le Koweit, l’Arabie Saoudite, les Émirats arabes unis ou Qatar. De même, une rupture cataclysmique des systèmes financiers et industriels de ces pays musulmans déclencherait une catastrophe financière et industrielle à travers l’Amérique.»
Plus loin, Levins nous apprend que dès 1976, une sous-commission du Congrès dut stopper ses investigations, lorsque l’Arabie Saoudite et le Koweit menacèrent de retirer les sept milliards de dollars déposés par eux à court terme dans les banques américaines71.
Je ne saurais traiter (mais qui le pourrait vraiment?) des incidences que cet état de choses peut avoir sur les prises de position des mass media américains, à propos du conflit du Moyen-Orient, ni en déduire quoi que ce soit pour le cas de la France. À ce propos, Levins résume, en ces termes, un fait divers bien connu:
«Une indication sur les dispositions françaises à l’égard de Pharaon, Ojjeh et d’autres [financiers] moyen-orientaux, au cours de leurs déplacements en province, est fournie par une frasque d’André Bercoff, un journaliste de Bordeaux. En 1980, Bercoff se livra à une mystification qui dans son genre rappelle le célèbre scandale de l’A.B.S.C.A.M.72. Se faisant appeler “Mohammed Zakher” et s’affublant d’une perruque, Bercoff loua une chambre d’hôtel et fit paraître un placard publicitaire dans un journal de Bordeaux, annonçant qu’il représentait Arab Corporated and Company et qu’il s’intéressait à tout projet d’investissement régional. Avant d’être dévoilé — par un autre journaliste qui le reconnut — Bercoff, trois jours durant, tint sa cour, dans un hôtel envahi d’une centaine d’hommes d’affaires bordelais, qui lui offraient des biens tels qu’un “ensemble de deux cents résidences de luxe au bord de la mer, des usines, des hôtels, des châteaux, des grands magasins, des équipements militaires, des firmes d’ingénieurs-conseils, des joailleries, des vignobles, et d’autres propriétés ou institutions d’une valeur de plusieurs millions de dollars”73.»
Mais que trouver à redire à tout cela? L’objectif des hommes d’affaires est de gagner de l’argent. Lorsqu’ils dirigent des journaux, leurs responsabilités se compliquent, mais parmi les clients de Bercoff, il n’y en avait pas.
* *
*
Venons-en à un symptôme autrement important. Au fil des années, la propagande arabe investissait le domaine de l’O.N.U., c’est-à-dire un sommet dont la France et les États-Unis n’étaient que des versants.
La diplomatie arabe se montra rapide et efficace. Au cours de l’hiver 1973-1974, la crise du pétrole lui permit de réduire les résistances résiduelles du tiers monde. Ensuite, elle s’attaqua au maillon le plus important de la chaîne des organisations internationales, c’est-à-dire à l’Unesco. Le moment favorable était proche. En novembre 1974, l’Unesco tenait sa Conférence générale biannuelle; les Arabes et leurs alliés réussirent à y faire condamner Israël d’une façon qui signifiait son exclusion symbolique de l’«Organisation internationale pour l’éducation, la science et la culture74».
En Occident, l’indignation fut immense. Citons un appel international, conçu et rédigé à Paris, dont les signataires cessaient désormais toute collaboration avec l’Unesco, qui:
«a refusé d’inclure Israël dans une région déterminée du monde… Si Israël n’a été situé ni en Asie (comme l’Australie), ni en Europe (comme le Canada), c’est qu’il n’est nulle part: c’est-à-dire qu’il n’existe pas… L’annulation spirituelle d’Israël justifie à l’avance son anéantissement physique. C’est un procédé d’extermination mis au point par les totalitarismes du XXe siècle…».
Page extraite de l’abécédaire Livre de lecture pour les enfants du peuple arabe palestinien, Fondation Samed, Beyrouth 1980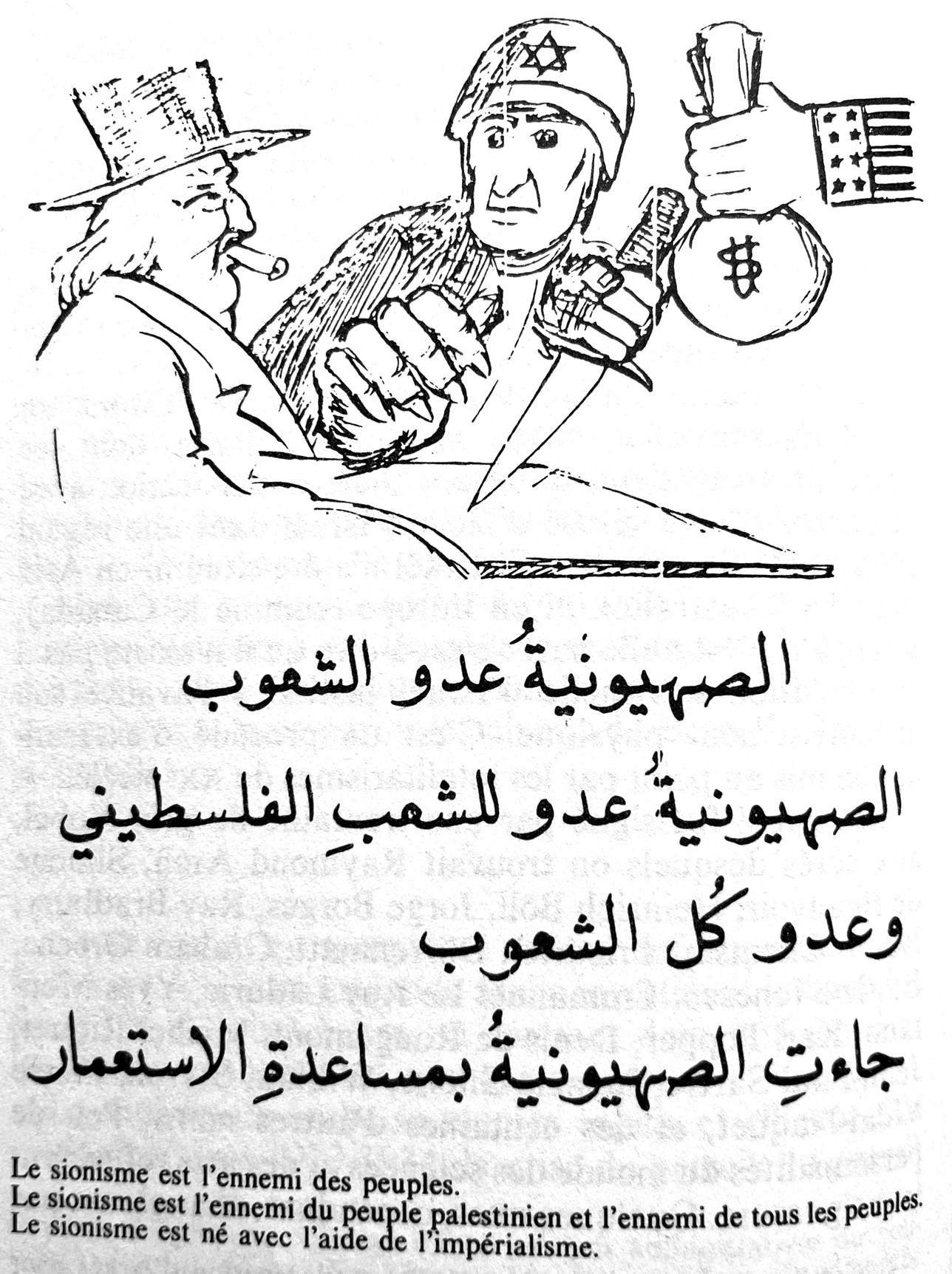
Cet appel fut signé par une trentaine de prix Nobel, aux côtés desquels on trouvait Raymond Aron, Simone de Beauvoir, Heinrich Böll, Jorge Borgès, Ray Bradbury, Noam Chomsky, Friedrich Dürrenmatt, Graham Greene, Eugène Ionesco, Emmanuel Le Roy Ladurie, Yves Montand, Karl Popper, Denis de Rougemont, Michel Riquet, Jean-Paul Sartre, Ignazio Silone, William Styron, Pierre Vidal-Naquet, et des centaines d’autres noms. Peu de personnalités du monde des sciences et des arts refusèrent leur signature. Quelques-unes, cependant, changèrent par la suite de sentiments envers l’État juif, pas seulement en raison de l’invasion du Liban, mais du fait d’une évolution générale des mentalités dont il sera question plus loin.
Le précédent une fois établi, les Arabes, aidés par leur clientèle et par le bloc communiste, reprirent le siège de l’O.N.U., qui, dès novembre 1974, avait accordé un statut spécial à l’O.L.P., et fêté de manière mémorable Yasser Arafat. Se fondant sur diverses résolutions antisionistes qui venaient d’être adoptées dans les pays du tiers monde75, elle déclarait ensuite, le 10 novembre 1975, que le sionisme était une forme du racisme. D’une façon générale, ce message dut être perçu, du Vietnam au Ghana ou au Pérou, comme le souhaitaient ses auteurs et comme ne cessait de le rappeler le roi Fayçal d’Arabie. Il y eut pourtant des voix discordantes. Au Kenya, un journal observait que l’O.N.U. faisait preuve de racisme, en condamnant le judaïsme mondial. Un organe indien réprouvait une résolution qui à son avis rendait impossible toute négociation entre Israël et l’O.L.P. Un quotidien colombien parlait de la sénilité de l’O.N.U., «d’une décadence morale et juridique, qui n’assure en aucune façon sa survie comme gouvernement mondial ou comme forum des nations 76». Les réflexions intempestives de cet ordre se comptèrent dans le tiers monde par dizaines77. Mais passons aux réactions de l’opinion occidentale, en les faisant précéder d’un commentaire israélien qui, sous le titre de L’Insigne de la honte, constatait en conclusion que 72 nations asservies avaient remporté une victoire sur 35 nations libres (Ma'ariv, 7-11-1975).
À Paris, Jean Daniel disait-il autre chose en écrivant dans Le Nouvel Observateur:
«Qu’est-ce qui fait que le président, prosoviétique, de la Finlande, le Premier ministre, anti-américain, de la Suède, le secrétaire général, pro-arabe, du Parti communiste italien en arrivent à se trouver soudain dans le même camp que les conservateurs de l’Europe et les réactionnaires des États-Unis, abandonnant ainsi leur neutralité et s’exposant à compromettre leurs liens avec certains pays du tiers monde arabo-africain? C’est à mon avis le sentiment, une sorte de prescience, que quelque chose d’universel vient d’être atteint…»
Dans Le Figaro, André Frossard s’y prenait d’une autre façon, évoquant «la manière de persécuter les Juifs qui consiste à les tenir tout d’abord à l’écart pour mieux les accuser ensuite de particularisme; ainsi peut-on les accabler deux fois. La première fois comme Juifs, la seconde comme sionistes. La méthode est extrêmement efficace…» Le Canard Enchaîné conseillait à l’O.N.U. d’aller jusqu’au bout, en réhabilitant Hitler78. Mais la voix la plus significative venait de Moscou où Andréi Sakharov pouvait déclarer publiquement, devant des journalistes de toute nationalité, que la résolution ne pouvait qu’encourager les tendances antisémites dans de nombreux pays. Depuis, ce «héros de l’Union soviétique», privé de tout contact avec le monde extérieur, séparé de sa femme et malade, attend sa mort dans une ville de province. À mon sentiment, c’est surtout ce drame-là qui nous fait comprendre où nous sommes aujourd’hui, en 1983.
Chapitre IV
Le tournant de la guerre des Six jours
Le déchaînement du conflit
De nos jours, on discute encore des causes de la Première Guerre mondiale; on s’accorde le plus souvent à constater qu’aucune grande puissance ne la voulait vraiment, mais que les chancelleries, surtout soucieuses de ne pas perdre la face, échouèrent du fait de calculs et raisonnements fallacieux. Il en est, et sans doute en sera-t-il toujours de même pour la guerre des Six Jours, à la différence près qu’Israël, le principal protagoniste, se devait de sauver, en même temps que la face, l’existence de l’État juif. N’oublions pas, par ailleurs, que les radios arabes annonçaient un massacre imminent des populations civiles: Ahmed Choukeiri, le chef de l’O.L.P. ne promettait-il pas de «jeter tous les Juifs à la mer»? Et le ton de Radio Le Caire était à peu près aussi virulent79. Cinq ans plus tard, à une époque où Israël se croyait désormais invicible, une discussion publique s’engagea sur la réalité de cette menace d’extermination. Une minorité de généraux et de politiciens soutint qu’en 1967, elle était inexistante. Mais c’était cinq ans plus tard.
On n’écrit pas l’histoire avec des si. Cependant les historiens sérieux, en dépit de leurs désaccords sur de nombreux points, estiment que trois décisions rendirent, tour à tour, le conflit armé inévitable. Mais avant d’y venir, mentionnons une première intoxication, d’origine très probablement soviétique, puisqu’elle évoquait les visées américaines sur la Méditerranée orientale. Le 21 avril 1967, au lendemain du coup d’État des colonels grecs, le bulletin confidentiel du parti unique égyptien proclamait, en effet:
«Après le régime d’Athènes, ce sera probablement le tour du gouvernement chypriote de Mgr Makarios. Les Américains vont essayer d’y établir un gouvernement à leur dévotion pour consolider leur position en Méditerranée orientale. Ils s’attaqueront ensuite à la Syrie, maillon faible du monde arabe progressiste, en raison de son isolement. Le régime baasiste de Damas n’est pas arrivé, en effet, à consolider ses assises populaires. L’ultime objectif des Américains est le régime nassérien en Égypte80.»
Une autre intoxication, unanimement considérée comme soviéto-syrienne, devait être à l’origine de la première des décisions mentionnées ci-dessus. Le 8 mai, des émissaires syriens venaient annoncer à Nasser qu’Israël concentrait des forces armées à proximité de leurs frontières et lui demandaient de l’aide. Comme on l’apprit par la suite, l’information était fausse. Avant d’entreprendre quoi que ce fût, Nasser demanda confirmation à Moscou qui se fit une joie de la lui donner. Il se sentit alors obligé d’ordonner des mouvements de troupes en direction de la frontière israélienne. L’engrenage de la guerre était enclenché.
Les deux autres décisions, également prises par Nasser, constituèrent la deuxième étape. Le 16 mai, il demandait à U Thant, secrétaire général des Nations-Unies, de retirer le cordon protecteur des «Casques bleus» qui stationnait à la frontière égypto-israélienne depuis la guerre de Suez. U Thant obtempéra avec une hâte qui surprit tout le monde et embarrassa Nasser lui-même, au point qu’il accusa par la suite le secrétariat des Nations-Unies de lui avoir tendu un piège81. U Thant était birman, et son gouvernement s’était rallié an 1963 au camp anti-israélien. Ainsi mis au pied du mur, le dictateur égyptien bloquait le détroit de Tiran, et par conséquent le port d’Eilath; il n’ignorait pas que les Israéliens allaient réagir, puisqu’il s’agissait pour eux non seulement de sauver la face, mais d’éviter un début d’asphyxie économique. Il prononçait le lendemain un discours belliqueux, proclamant que l’Égypte, ayant désormais tous les atouts en main, était suffisamment puissante pour libérer la Palestine. «Qu’Israël commence donc!»
Or, le libre passage par le détroit de Tiran avait été garanti, après la guerre de Suez, par les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France («déclaration tripartite»). L’inertie de ces trois grandes puissances, dont chacune avait ses bonnes raisons, constitua l’ultime étape. Le Président Johnson préféra temporiser: les États-Unis étaient déjà enlisés au Vietnam, et le Président craignait par-dessus tout un affrontement avec l’Union soviétique; le Premier britannique Wilson ne voulait rien entreprendre sans les États-Unis; le général de Gaulle, vers lequel, en cas de crise grave, se tournaient à cette époque tous les regards, le prit de très haut, et laissa «tomber» Israël très gaulliennement. Surtout, ne tirez pas les premiers! Au récit d’Abba Eban (le ministre israélien des Affaires étrangères) sur les démarches désespérées qu’il tenta, je préfère le laconique exposé de l’historien militaire britannique Edgar O'Ballance:
«Abba Eban vola à Paris, où il eut un bref entretien avec le président de Gaulle, qui marqua son désintérêt, car il pensait qu’Israël subissait trop l’influence américaine. Ce fut une grave déception, car pendant et depuis la guerre de 1956, la France demeurait un excellent ami d’Israël, mais les relations s’étaient refroidies depuis que l’Algérie avait recouvré son indépendance82.»
Ainsi Israël apprenait d’un coup deux importantes leçons: la guerre était inévitable; les traités ou déclarations des grandes puissances devenaient facilement, à l’ère atomique, des chiffons de papier.
Pourtant, l’État juif ne manquait pas alors d’amis, en particulier dans le monde occidental, où l’opinion publique fut saisie d’un immense émoi, au point de faire contraste, à première vue, avec la population israélienne, entraînée à affecter collectivement, en de pareilles circonstances, un calme imperturbable. On dispose à ce sujet du récit saisissant de Jean-Françis Held, l’envoyé spécial du Nouvel Observateur:
«Jusqu’à la fin de la guerre, en Israël, le climat est resté très serein. Et j’ai pu constater que nous étions là-bas complètement déphasés par rapport à Paris. Moi qui pouvais avoir des conversations téléphoniques avec mon rédacteur en chef, j’étais stupéfait de m’entendre dire: “Faites attention, vous ne vous rendez pas compte de l’ambiance qui règne ici. Nous recevons des lettres extrêmement violentes, les gens s’opposent passionnément, etc.” En effet, Juifs ou non, les Français étaient partie prenante de façon plus intense qu’on l’était en Israël, avec, en plus, ce qui n’existait pas en Israël, un côté antiarabe très violent. Les Israéliens auraient très bien admis que j’envoie certaines informations qui auraient été prises à Paris pour de la provocation. À Tel-Aviv, on pouvait discuter de tout, sans se faire traiter de provocateur83…»
Il n’en reste pas moins que dans leur for intérieur, beaucoup d’Israéliens croyaient venue leur dernière heure.
«Le 3 juin, écrivait un Israélien d’origine anglaise, j’estimais mes chances de survie à 50 %. J’avais déjà fait mes adieux à ma famille anglaise et écrit mes dernières lettres… Je m’attendais à être bombardé, brûlé, gazé ou fusillé. J’habite près du port; l’école où j’enseigne ne possède pas d’abris adéquats; et le bureau de poste dans lequel je travaille en ce moment comme volontaire est un piège, en cas d’incendie. Aucune cible ne devait paraître plus tentante que Haïfa.» (Cf. The Economist, 31-7-67).
Comme l’a résumé un Israélien francophone, «ce qu’on a appelé la victoire d’Israël n’a pas simplement été le résultat de la détente d’une puissance martiale, mais surtout l’explosion d’une force populaire qui a réussi à discipliner son sursaut de désespérance84».
Rappelons à ce propos qu’au dernier moment, Israël dut faire face à une menace supplémentaire, la plus grave militairement: les stratèges de Tel-Aviv espéraient n’avoir que l’Égypte et la Syrie à combattre; or, dès que les hostilités éclatèrent, le roi de Jordanie vola à l’aide de ces deux nations-sœurs, et ses troupes n’avaient qu’une vingtaine de kilomètres à franchir pour couper l’État juif en deux. Une contre-attaque désespérée sauva la situation, et dans la foulée, on prit Jérusalem — pour ainsi dire à l’improviste…
Tout au long de ces heures et de ces jours cruciaux, les Israéliens affectèrent un calme stoïque. Ce furent alors les Juifs de la dispersion qui, en quelque sorte par procuration, exhibèrent leur détresse. Certains d’entre eux, qui se croyaient intégralement assimilés, se sentirent juifs pour la première fois… À Paris, ils manifestèrent dans les rues, bombardèrent de coups de téléphone les ambassades et les rédactions. Je me souviens, à l’émission d’Europe I «Le téléphone sonne», d’un appel hystérique qui mettait en cause le pape Paul VI: allait-il se taire sur le sort des Juifs, comme l’avait fait Pie XII lors du précédent génocide? L’ombre des camps de la mort planait sur toutes les réactions. Dans une certaine mesure, cette angoisse se communiquait de proche en proche: à la quasi-unanimité, on avait peur pour Israël. En France, par exemple, il n’y eut que la presse communiste et quelques groupuscules gauchistes pour adopter un ton différent. Ainsi à en croire Yves Moreau dans L’Humanité: «La mauvaise cause d’Israël est trop souvent plaidée en France — et jusque dans les émissions de radio et de télé gouvernementales» (24.5.1967). Il va de soi que pour lui, cette cause était en réalité celle de l’impérialisme américain. Des thèmes analogues étaient développés, le 19 mai, à une réunion d’étudiants arabes et de leurs amis, et un des orateurs s’y étonnait de l’indifférence manifestée à l’égard du problème palestinien «dans la patrie de Jean Jaurès et de Régis Debray». En revanche, un appel de la gauche, signé par des personnalités telles que Pablo Picasso, Jean-Paul Sartre, Laurent Schwarz, etc., proclamait que la sécurité et la souveraineté d’Israël, impliquant le droit du libre passage maritime, était la condition et le point de départ nécessaires à l’établissement de la paix. Dans Le Monde, André Fontaine, attaché lui aussi, en premier lieu, à la cause supérieure de la sauvegarde de la paix, trouvait pour plaider la cause d’Israël des accents émouvants:
«On ne comprend que trop bien l’irritation croissante de ceux qui ont échappé aux chambres à gaz et de leurs enfants, installés enfin sur cette terre qui leur a été “promise” de toute éternité, devant la multiplication de sabotages et leur tendance naturelle à demander qu’on réponde par la force à la force. N’est-ce pas grâce à elle qu’ils viennent de connaître des années de tranquillité? Cela dit, s’il est possible qu’en y recourant à nouveau, ils s’assurent un nouveau bail, il leur faut savoir que, quel que soit le résultat, il ne leur ouvrira pas le cœur des Arabes. Or, quelle ressource ont-ils à la longue, les uns et les autres, sinon de cœxister sans arrière-pensée?»
Mais M. Fontaine n’indiquait pas par quel moyen les Israéliens pouvaient s’ouvrir les cœurs arabes. Et il disait son inquiétude pour les Israéliens: «Sont-ils sûrs au demeurant, de ce que leur réserve une guerre?» (25-5-1967).
On se souviendra aussi du cri du cœur de Raymond Aron: «Si les grandes puissances, selon le calcul froid de leurs intérêts, laissent détruire le petit État, qui n’est pas le mien, ce crime, modeste à l’échelle du nombre, m’enlèverait la force de vivre et je crois que des millions et des millions d’hommes auraient honte de l’humanité» (Le Figaro littéraire, 4-12 juin 1967).
Effets de la guerre des six jours: Israël
Dans l’un de ces brillants raccourcis dont ses mémoires abondent, Henry Kissinger évoque, à propos de la collection archéologique réunie par le général Dayan, le «besoin obsessionnel des Israéliens de rétablir le contact avec leur lointain passé, ou, du moins, de retrouver l’ancienne identité de leur pays — comme pour tenir en lisière leur sentiment d’insécurité, par trop criant, en faisant la démonstration de leur continuité historique». Dans un contexte analogue, il parle «d’un peuple [qui] aspirait à la paix comme seuls peuvent le faire ceux qui ne l’ont jamais connue85». Ces réflexions datent de la guerre la plus tragique qu’Israël ait eu à subir, celle du Kippour; elle ne fut cependant pas la plus meurtrière: la première, celle de 1948-1949, coûta la vie à plus de six mille combattants, c’est-à-dire plus de 1 % de la population. Celle de Suez, en 1956, se solda par des pertes proportionnellement près de cent fois inférieures (171 tués); il va de soi que ce n’est pas un tribut de cet ordre, mais les incessants cris de haine et menaces des Arabes, accompagnés des incursions et attentats des fedayin, qui tenaient alors le pays en haleine. Il n’en reste pas moins que la longue période de paix 1956-1967 fit naître un relatif sentiment de sécurité qui, entre autres conséquences, poussait une partie de la jeunesse à vouloir se détourner du passé tragique des ancêtres, accusés notamment de s’être laissé massacrer «comme des moutons», au temps de l’Europe hitlérienne. Un mouvement de contestation teinté de racisme, celui des «Cananéens», en vint même à se constituer, antijuif à sa manière, puisqu’il voulait faire l’impasse et sur la vie en dispersion et sur les temps bibliques. C’est surtout pour lutter contre des tendances de ce genre que les dirigeants israéliens, Ben Gourion en premier lieu, veillèrent à ce que le procès d’Eichmann soit si théâtralement mis en scène, en 1960-1961. Il fit effectivement sensation, mais le résultat pédagogique fut plutôt décevant; la guerre des Six Jours s’avéra être un facteur autrement puissant d’une «rejudaïsation» en profondeur d’Israël.
Ce retour aux origines fut déclenché par le traumatisme collectif: c’est parce que la population s’attendait au pire que ses réactions au lendemain de la victoire atteignirent un tel degré d’exaltation. Que l’on y songe: non seulement elle avait échappé aux massacres, mais Jérusalem «que ma main droite se dessèche, si je l’oublie» était réunifiée, et le Mur des lamentations, reconquis. Ainsi donc, ce fut d’abord une rejudaïsation qui gagna, fût-ce passagèrement, d’innombrables agnostiques.
Une autre conséquence ou leçon fut la déception causée par l’attitude des grandes puissances. À peine les armes s’étaient-elles tues que sur une initiative conjointe soviéto-américaine, l’Assemblée générale de l’O.N.U. adoptait une motion86 aux termes de laquelle Israël devait évacuer les territoires occupés, et les Arabes reconnaître à tous les États de la région le droit à la paix et à la sécurité. Mais l’État concerné n’était pas nommé, comme si magiquement, il n’existait pas. Néanmoins, les Arabes furent les premiers à rejeter cette résolution (19 juin 1967)87.
Il restait que l’armée israélienne avait remporté une victoire fulgurante, et pour le commun des mortels, stupéfiante. D’où un sentiment quasi mystique d’invincibilité, avec pour pendant la dépréciation de l’adversaire, et de faciles ironies: les soldats égyptiens n’abandonnaient-ils pas sur les champs de bataille jusqu’à leurs souliers, pour fuir plus vite?
Mais l’avenir? Les territoires occupés, peuplés à l’époque de près de sept cent mille Arabes et à la démographie galopante? Ben Gourion, parmi tant d’autres, n’avait-il pas dit: «Plutôt la paix sans territoires que les territoires sans la paix!» Mais pour faire la paix, il fallait négocier, et ces territoires étaient d’abord considérés comme un gage. Or, en août 1967, les dirigeants arabes, réunis à Khartoum, entérinaient leur refus et proclamaient leurs trois non: pas de négociations, pas d’arrêt de l’état de belligérance, pas de reconnaissance de l’État d’Israël. Arrêtons-nous d’abord à ce troisième non, à cette négation magique, à laquelle, somme toute, les Israéliens se laissèrent prendre (par fierté, par insécurité, voire par innocence diplomatique?), concédant ainsi aux Arabes un avantage psychologique de première grandeur, un atout que ceux-ci ne cessent de brandir d’année en année. Comme l’observe Henry Kissinger, «les Juifs donnent parfois l’impression que la reconnaissance constitue leur principal objectif, et certains Arabes, percevant peut-être cette opportunité, paraissent s’imaginer qu’ils peuvent imposer leur programme maximum en échange d’une simple reconnaissance» (The Economist, 13-11-1982).
Pour ce qui est des deux premiers «non», les duels d’artillerie par-dessus le canal de Suez reprirent dès juillet 1967; le 21 octobre, les Égyptiens coulaient le destroyer israélien Eilat, et une guerre d’usure s’instituait sur le canal, qui devait durer près de quatre années, et coûter à l’État juif plus de pertes que la guerre des Six Jours elle-même. Les organisations palestiniennes, en Égypte ou en Jordanie, tiraient leurs propres conclusions de la défaite, et perfectionnaient leurs méthodes terroristes, en les étendant à tout le continent européen. Toutes ces sanglantes péripéties n’avaient pas de quoi disposer Israël en faveur de concessions unilatérales, et encore moins le faire céder aux chantages terroristes: au contraire, les tueurs d’enfants masquaient aux yeux de l’opinion les réfugiés et leurs enfants dans les camps jordaniens ou libanais, qui d’ailleurs applaudissaient ces tueurs. La question de sécurité, une question de vie ou de mort pour les Israéliens, ne pouvait que reléguer au second plan, dans la meilleure hypothèse, le drame palestinien. Que dans cette ambiance, le sentiment nouveau d’être seuls au monde suscitât par-ci par-là des rêves mégalomanes, va de soi.
Face à la montée des critiques européennes, la dignité nationale commandait d’affecter l’indifférence, et ce n’étaient pas les condamnations automatiques et de plus en plus incohérentes de l’O.N.U. qui pouvaient faire prendre ces critiques au sérieux. Dans les milieux dirigeants, deux camps s’esquissèrent au sein du parti gouvernemental (travailliste), d’importance à peu près égale. Mais l’indomptable Golda Meir, le chef du gouvernement, épaulée par le général Dayan, le héros national, appartenait au camp «dur». L’autre, animé par Pinhas Sapir, le ministre des Finances, ne manquait cependant pas d’arguments impressionnants, telle la perspective de voir un jour l’État juif «déjudaïsé», par le simple jeu des taux respectifs de natalité. Les oppositions de gauche et de droite n’avaient évidemment pas voix au chapitre. Signalons enfin un phénomène insolite au sein du commandement militaire: des fanfaronnades, dont le général Sharon donnait l’exemple en proclamant, le 20 juillet 1973: «Israël se place aujourd’hui au même niveau de puissance que la France et la Grande-Bretagne.»
Le démenti ne tarda pas, on le sait, et avec quelle cruauté! À la vérité, on peut parler de hybris: les préparatifs de l’attaque étaient apparents depuis plusieurs jours, les renseignements affluaient l’un après l’autre, mais rien ne pouvait ébranler la méprisante certitude du général Dayan: les Arabes tentent de nous faire peur, mais jamais ils n’oseront… Par surcroît, au lever du jour du Kippour, lorsque le doute ne fut plus de mise, c’est Golda Meir qui aggrava le désastre, en interdisant une attaque aérienne préventive pour laisser cette fois-ci à Sadate et à Assad, sans contestation possible, le rôle d’agresseurs. Les ennemis européens d’Israël s’en gaussèrent88. L’effet de surprise ayant été total, on se demandait dans les capitales étrangères si l’État juif n’allait pas être rayé de la carte. Sur place, le quatrième jour de la guerre, Dayan parlait à une conférence secrète «d’un péril pour la survie d’Israël et de sa population», et envisageait un repli général. Golda Meir déclara qu’elle préférait le suicide à une reddition.
Je ferai aussi peu l’historique de la guerre du Kippour que je l’ai fait pour les conflits précédents. Israël eut beau la gagner militairement, elle fut ressentie par le pays comme une catastrophe, et eut des conséquences autrement graves, bien que d’un signe opposé. De plus haut on tombe, et plus dure est la chute, dit un proverbe anglais. On a aussi fait remarquer que tout se fût passé différemment, si Israël avait été un gros producteur de pétrole, ou avait disposé d’une vingtaine de sous-marins nucléaires89. La réalité étant tout autre, voici, dans leur succession, quelles furent, en gros, les conséquences.
Pour commencer, la population mit en cause la classe politique, mais ne sut pas la renouveler. Des héros et des modèles, les généraux, une élite issue à l’origine des kibbutzim, donnèrent le spectacle affligeant d’une querelle publique. Sharon, couvert par Dayan, mit en accusation ses supérieurs et quitta l’armée. Cette «guerre des généraux» transforma certains d’entre eux en politiciens; d’autres entrèrent dans les affaires. Ce phénomène s’insérait dans une évolution générale qui s’esquissait déjà antérieurement, marquée par l’affaiblissement des valeurs anciennes et par la chasse aux biens matériels: une classe de nouveaux riches se constitua; des scandales financiers éclatèrent; bref, Israël devint, à maints égards, un pays comme les autres. Mais un pays progressivement relégué, par les soins de ses puissants ennemis, à l’état de Juif des nations; la rejudaïsation, ce fut aussi cela.
L’antagonisme entre une bourgeoisie de provenance surtout européenne et un prolétariat originaire des pays arabes («achkénazes» et «sépharades») constituait un problème israélien spécifique, aggravé par la nouvelle évolution, tandis que le recours croissant à la main-d’œuvre arabe créait une catégorie de «travailleurs étrangers» sui generis. Ces problèmes ou scandales étaient débattus sur la place publique par une presse dont la liberté n’a d’égale que celle des pays anglo-saxons, alors que les luttes politiques traduisent un acharnement de type méditerranéen ou latin. D’où le franc-parler débridé qui règne dans la démocratie israélienne, avec pour conséquence la propension à transporter à l’étranger les querelles intestines.
En bref, la carte politique israélienne se laisserait sommairement dresser comme suit:
À «droite», une cléricature rabbinique qui s’appuie sur les pratiquants de stricte obédience (20 % de la population). Contrairement à ce qu’on pense, en France et ailleurs90, ces traditionalistes sont réservés dans leur majorité, en ce qui concerne l’annexion de la Cisjordanie, dont les partisans se trouvent surtout au sein des formations politiques (en premier lieu, dans le «Likoud» de Menahem Begin), et invoquent des considérations d’ordre militaire. (Il est à noter que les «implantations sauvages» en Cisjordanie commencèrent avant l’ère Begin).
À «gauche», une «cléricature laïque» qui s’appuie surtout sur les universités et les kibbutzim, ces deux pépinières de militants oppositionnels, qui accordent la priorité à une solution équitable du problème des Palestiniens.
Un vaste centre moins politisé qui, indépendamment de ses préférences politiques, récuse l’O.L.P. en qualité d’interlocuteur valable, convaincu que cet organisme ne saurait dévier de son programme officiel, qui implique la destruction de l’État juif.
Cette carte n’a pas été sensiblement modifiée par l’accession au pouvoir de Begin, en mai 1977, après trente années de gouvernement travailliste. Cette révolution électorale fut une manifestation à retardement de la volonté de changement, renforcée par une aggravation des inégalités sociales. Ce furent donc surtout les voix du prolétariat qui se déplacèrent, pour des raisons de politique intérieure.
Dans l’opposition, Begin et ses partisans professaient des vues franchement annexionnistes, mais une fois arrivés au pouvoir, ils manifestèrent une certaine souplesse. Au point que c’est Begin qui sut entamer les négociations lesquelles, en passant par la visite historique de Sadate à Jérusalem (heure d’euphorie pour Israël tout entier) aboutirent aux accords de Camp David. Et c’est encore Begin qui parvint à imposer l’évacuation complète du Sinaï, au prix de la démolition de la ville de Yamit et d’autres agglomérations pionnières. De l’avis général, lui seul, précisément parce qu’il était coutumier de la surenchère nationaliste, pouvait mener à bien une opération de ce genre. Sadate et Begin reçurent en 1979 le prix Nobel de la paix, mais le choix du lauréat israélien fut contesté en de nombreux points du monde et les protestations allèrent croissant; d’autant qu’en Israël même, le «béginisme», pour d’autres raisons, était critiqué de diverses parts, et que certaines campagnes, parmi les plus vives, se frayaient un chemin à travers toute la dispersion. En France notamment, nombre d’auteurs ou de polémistes de bonne foi juifs ou non, y prêtaient une oreille attentive. En fin de compte, les divers ennemis d’Israël purent disposer de la sorte d’un renfort inespéré. On imagine ce qu’il en fut lors de l’aventureuse entreprise libanaise, qui finit par susciter en Israël même les protestations que l’on sait.
Effets de la guerre des six jours en france
Après la victoire d’Israël, et tandis que la presse communiste et les groupuscules pro-arabes continuaient de tirer à boulets rouges sur les «impérialistes», le ton de la presse ne se modifia d’abord qu’imperceptiblement. Il était naturel que l’opinion publique manifestât quelque sympathie aux vaincus, surtout lorsqu’il s’agissait de milliers de soldats égyptiens abandonnés par leurs officiers et égarés dans le désert du Sinaï, mais la plupart des cœurs restaient fidèles à Tel-Aviv. À l’Assemblée nationale, M. Clostermann, un ancien aviateur, rappelait qu’Israël avait «joué son existence à une demi-heure près». M. Couve de Murville, ministre des Affaires étrangères, promettait que la France resterait «impartiale». Jacques Fauvet, de retour d’une visite en Israël, parlait en termes enthousiastes dans Le Monde de ce jeune pays, sans se faire d’illusions pourtant sur «l’immensité des problèmes» qu’il lui faudrait désormais résoudre. Il en donnait une description et concluait: «Toutes ces questions se posent aux observateurs comme aux Israéliens, mais ceux-ci répondent de l’avenir au nom du passé. Chaque difficulté n’a-t-elle pas été résolue quand et comme il le fallait? Israël, terre des miracles? Le monde est en tout cas témoin de ce que l’intelligence peut réaliser, quand elle s’allie à la volonté dans la paix comme dans la guerre» (24 juillet 1967).
Mais dès le mois d’août, on décèle déjà chez maint commentateur politique une tendance à imputer à l’outrecuidance des vainqueurs les «trois non» arabes, et à esquisser, dans la foulée, une révision de l’histoire, portant essentiellement sur les responsabilités de la guerre des Six Jours. Israël n’en serait-il pas l’unique fauteur91? Ces polémiques s’envenimèrent à la fin de l’année, lorsque le général de Gaulle hissa le problème à des hauteurs quasiment métaphysiques, en tenant les propos que voici:
«On pouvait se demander, et on se demandait même chez beaucoup de Juifs, si l’implantation de cette communauté sur des terres qui avaient été acquises dans des conditions plus ou moins justifiables et au milieu des peuples arabes qui lui étaient foncièrement hostiles n’allait pas entraîner d’innombrables, d’interminables frictions et conflits. Certains même redoutaient que les Juifs, jusqu’alors dispersés, qui étaient restés ce qu’ils avaient été de tous les temps, un peuple d’élite, sûr de lui-même et dominateur, n’en viennent, une fois qu’ils étaient rassemblés, à changer en ambition ardente et conquérante les souhaits très émouvants qu’ils formaient depuis dix-neuf siècles: L’an prochain à Jérusalem!» (conférence de presse du 28 novembre 1967).
On notera la progression de ce morceau d’anthologie: à son terme, tous les Juifs du monde se trouvaient décrits comme une entité homogène et… redoutable. L’antique suspicion? On s’imagine l’émoi. Dans Le Monde, Hubert Beuve-Méry et Pierre Viansson-Ponté s’indignaient le jour même. Citons le second nommé:
«Ce qui vient de se passer risque de laisser des traces profondes et durables. Le grand thème gaullien de l’unité nationale sort assez mal en point, une fois de plus, d’une foucade du général. La politique française au Moyen-Orient, quel que soit le régime, ne pourra plus désormais se développer sans tenir compte de ce qui vient d’être dit, plus encore que de ce qui a ou n’a pas été fait. Des liens anciens se sont rompus, de vieilles amitiés ont pris fin, des dialogues se sont arrêtés, des méfiances et une nouvelle source de division ont reparu, comme si la France ne manquait pas de sujets de querelles.»
Et en effet, les Français juifs les plus éminents, dont certains compagnons de la Résistance, se sentirent ulcérés au point de renvoyer au chef de l’État leurs décorations. D’autres écrivirent aux journaux pour dire qu’ils ne connaissaient pas de peuple juif, qu’ils ne connaissaient qu’un peuple français. Le 27 décembre 1967, M. Raymond Aron résumait la nouvelle conjoncture, en mettant les points sur les i:
«Écrivant librement dans un pays libre, je dirai que le général de Gaulle a, sciemment, volontairement, ouvert une nouvelle période de l’histoire juive et peut-être de l’antisémitisme. Tout redevient possible. Tout recommence. Pas question, certes, de persécution: seulement de “malveillance”. Pas le temps du mépris: le temps du soupçon92.»
À nouveau, deux poids, deux mesures? Un vieil homme, l’ancien dreyfusard Emmanuel Berl, prenait le parti d’en sourire:
«Je voudrais bien que la guerre des Six Jours fût oubliée. Mais comment serait-ce possible, si on ne cesse d’en parler? De répéter aux Arabes: “Votre défaite vous donne des droits sur nous.” Il me serait pénible d’entendre les Israéliens dire à longueur de journée: “Nous autres vainqueurs.” Mais que gagne-t-on à ce qu’ils ne le disent pas, si du matin au soir et du soir au matin, les Arabes et encore plus les amis des Arabes disent toutes les cinq minutes: “Vous autres vaincus”, “Nous autres vaincus”. Ne pourrait-on parler d’autre chose? […] Qu’Israël oublie sa victoire, qu’il la surmonte, moi-même je le désire. Qu’il la condamne, qu’il s’en repente, qu’il y voie une circonstance aggravante de la position d’agresseur qu’on lui attribue, alors qu’il se considérait, sans aucun doute, comme objet d’agression, n’est-ce pas lui demander un peu trop? À quel peuple eut-on tant demandé? […] Faut-il croire que pour les seuls Juifs, la victoire est déshonorante, alors que tous les autres peuples la jugent plutôt honorable qu’avilissante93?»
Tel était aussi l’avis des Israéliens, et les répliques de certains de leurs porte-parole à leurs nouveaux détracteurs français — «Nous préférons les critiques aux condoléances» — «Nous croyions avoir des amis, nous n’avions que des fournisseurs» — jetaient de leur côté de l’huile sur le feu.
Cette polémique, on l’a peut-être oublié — d’autant que peu après, les «événements» de mai 1968 suscitaient des passions autrement violentes — prit des proportions démesurées, à tel point qu’il est licite d’y voir une sorte de répétition générale des outrances de l’été 1982. Voici comment je la décrivais sur le vif: «Le général de Gaulle, écrivais-je, se forge sa propre terminologie. Pour justifier sa nouvelle politique au Moyen-Orient, il parle d’un “peuple d’élite, sûr de lui-même et dominateur». Plus que les épithètes, c’est le sujet de la phrase piégée qui offensait les Juifs, ainsi implicitement retranchés du peuple français (à moins de militer pour cette politique gaulliste, quelle manière de dire: “La France, c’est moi!”). Les protestations se multiplièrent; quelques-unes venaient de gaullistes inconditionnels. En retour, il y eut, paraît-il, une formule plus banale, “les Juifs ne sont pas des Français comme les autres”, et ce que Raymond Aron a appelé le temps du soupçon. Après l’État français de 1940-1944, la Ve République de 1967-1968 paraissait remettre l’assimilation en cause: la dialectique sioniste marquait un point.
«Le général de Gaulle était-il antisémite? Je pense que non, mais la psychologie individuelle importe peu ici. Pour ce qui est de la politique, on se reportera à la collection de La Nation, ou à tel communiqué de gouvernement qui, d’une certaine façon, partageait la France en deux zones d’influence, la française et la sioniste.
«Après Auschwitz, la passion française de la justice poussa le pays à la pointe d’un combat pour la réhabilitation des Juifs auquel prirent part, de ses prix Nobel à ses cardinaux, presque tous ceux qui y avaient un nom; mais voici que Charles de Gaulle, après avoir désigné, en juin 1967, l’État juif comme l’État agresseur, le mettait à l’amende, lors de l’embargo sur les armes de janvier 1969. Comme si cela ne suffisait pas, d’autres passions s’en mêlèrent: des Français rapatriés d’Algérie prenaient leur revanche sur les Arabes, voire sur de Gaulle, par personnes interposées, et une gauche qui s’était naguère engagée pour la libération algérienne épousait la cause d’un autre peuple arabe, ou se divisait contre elle-même.
«C’est, en effet, surtout chez les hommes de gauche que la confusion n’avait d’égale que la violence des sentiments exprimés. L’heure des conflits de conscience et des revirements était aussi celle du courage vrai ou faux. Celui de M. André Philip, qui dénonçait l’emprise juive sur la radio et la presse en des termes que les partisans de la “France intégrale” de Maurras n’eussent sans doute pas désavoués. Celui de M. Maxime Rodinson, qui convenait que les Arabes “ne pouvaient que rêver” de détruire l’État d’Israël. Celui de Jean-Paul Sartre, qui ne pouvait oublier que les Israéliens étaient des Juifs, et qui, peut-être en signe d’estime, croyait pouvoir “demander à Israël plus qu’aux autres”. Celui de François Mauriac, qui citait un confrère gaulliste: “Tel est le risque aujourd’hui de passer pour antisémite, selon cet ami, que les vérités les plus évidentes doivent être tues.” Mais il y avait aussi un camp difficile à classer, s’étendant de M. Eugène Ionesco, qui se déclarait pour les Juifs, “sans lesquels le monde serait dur et triste”, jusqu’au Canard Enchaîné, qui demandait à Israël d’offrir sa médiation dans le conflit russo-chinois; le non-conformisme paraissait voler au secours du camp sioniste.
«Les colonnes du Monde devenaient le rendez-vous des “libres opinions”, communiqués et lettres les plus contradictoires. Des universitaires juifs, dès l’été 1967, y déclaraient la guerre au sionisme des Rothschild; des pasteurs protestants, au lendemain du raid sur Beyrouth, y polémiquaient avec d’autres pasteurs, à propos du chant vengeur de Lamech; et si l’Église de France, prudente, s’abstenait de critiquer le sionisme inconditionnel du rabbinat français, des laïcs tels que M. Pierre Vidal-Naquet, ou M. Olivier Pozzo di Borgo, le faisaient au nom de l’humanisme, ou du patriotisme. D’autre part, les sentiments et les opinions évoluaient au fil des événements, et des non-Juifs paraissaient faire grief à Israël d’avoir, en mai 1967, craint pour lui, et des Israéliens ironisaient sur leurs condoléances anticipées. Ainsi que l’a fait observer M. Raymond Aron, personne ne se résignait au rôle de spectateur pur, tous paraissaient obéir à leurs démons. À peine âgé de vingt ans, l’État juif semblait défier la raison, tout comme le peuple juif depuis deux mille ans. Des chrétiens partageaient les enthousiasmes sionistes; des athées en voulurent aux Juifs de prendre parti pour cet État insensé94.»
Ces polémiques étaient loin de se limiter à la France. Même aux États-Unis, des journalistes engageaient au lendemain de la guerre des Six Jours des campagnes anti-israéliennes. En 1982, un historien américain, le professeur Alexander, évoquait cette tendance sans mâcher ses mots:
«L’idéologie antisémite, obligée de se replier dans les bas-fonds, vingt-deux années durant, après la Deuxième Guerre mondiale, a retrouvé depuis juin 1967 sa vigueur ancienne et son franc-parler, et elle reçut un accueil favorable de la part d’une intelligentsia sous-éduquée.»
Et il en tirait, sans transition, une morale amère:
«Les Arabes fondent toujours leurs arguments sur des “droits”, et jamais (comme le fait Israël, même sous Begin) sur la “sécurité”. Contrairement à tous les pays arabes, Israël est une société ouverte et démocratique, avec une presse libre. Les Juifs, dans leur extravagance, ont convaincu le monde qu’ils doivent être jugés conformément à des critères moraux plus sévères que ceux qui sont appliqués aux autres peuples95.»
En France, le tableau était différent: si l’affaiblissement du tabou qui marque l’antisémitisme y fut plus hésitant, des considérations d’ordre politique contribuaient à alourdir le climat, en suscitant des revirements idéologiques et même théologiques d’ordres divers. On peut citer à ce propos une réflexion du penseur protestant Jacques Ellul:
«Je suis scandalisé par l’hypocrisie qui consiste à condamner d’un côté l’État d’Israël, tout en se donnant bonne conscience en condamnant de l’autre côté l’antisémitisme. On aime bien les Juifs, c’est sûr. Mais les bons Juifs, c’est-à-dire ceux qui se laissent égorger, déporter, massacrer: alors là, la conscience indignée des chrétiens condamnera leurs oppresseurs. Mais il y a des mauvais Juifs: ceux qui se défendent… Voilà exactement où se situe l’amour des Juifs allié à la condamnation de l’État d’Israël.» (Réforme, 30-5-1970).
Comment ne pas évoquer à ce propos l’appui prêté au revirement général par Le Monde, ce pédagogue de la classe intellectuelle française. Caractéristique de ce point de vue est la faveur dont bénéficièrent, à partir de l’automne 1968, les fedayin palestiniens. Terroristes en été 1967, au lendemain de la guerre, ils devinrent, dans les colonnes du journal, des résistants l’année suivante. En octobre, un premier article, signé B. Karlinsky, consacrait une demi-page à «l’organisation de commandos palestiniens El Fath, en pleine mutation». Suivirent, à partir de décembre, les descriptions enthousiastes d’Edouard Saab: «Il n’existe pas d’analphabètes parmi les fedayin, et leurs cadres sont constitués par des diplômés de l’Académie militaire ou des facultés de sciences, de droit et de médecine […] compagnons harassés de fatigue, mais dont se dégage une joie de vivre mêlée à un sentiment de fierté patriotique…» Puis, M. Yasser Arafat ayant été élu le 4 février 1969 président du Comité exécutif de l’O.L.P., Le Monde publie sa biographie le 6, une interview le 21, et multiplie au cours des mois suivants les interviews d’Arafat et de ses compagnons les plus influents, tels Georges Habache ou Nayef Hawatmeh. Il va de soi que parallèlement, les articles traitant d’Israël se faisaient de plus en plus critiques, et que licence pleine et entière était donnée à M. Maxime Rodinson, désormais surpassé, d’ailleurs, par M. Vincent Monteil, dans ses imprécations contre le sionisme. En outre, les lettres ou «libres opinions» de lecteurs arabes, rivalisant de passion, devinrent de plus en plus fréquentes en deuxième page du journal.
Pourtant, M. André Fontaine, le rédacteur en chef, s’employait, le cas échéant, à modérer les passions. C’est ainsi qu’au plus chaud de la querelle, il rappelait que les communistes français étaient libres de réaffirmer leur fidélité à l’Union soviétique, et que pour sa part, Charles de Gaulle n’avait pas hésité à annoncer aux Français du Québec qu’ils étaient libres eux aussi. Mais en l’occurrence, il s’agissait d’un problème autrement grave: «Le gouvernement français ne peut laisser accréditer sans injustice ni péril l’impression que tous ceux qui critiquent sa politique sont juifs, alors que du général Koenig à M. Diomède Catroux, vétéran du gaullisme, on ne compte pas le nombre de non-Juifs, civils et militaires, qui ont pris fait et cause pour Israël.» En outre, certaines exclusives paraissaient à M. Fontaine d’autant plus choquantes que, de notoriété publique, nombre de Juifs étaient antisionistes. Retenons le titre de cet article: À l’ombre de l’affaire Dreyfus (16-3-1970). On voit où en étaient arrivées les choses.
Assurément, il n’y avait pas que Le Monde. À la même époque, l’ardent polémiste pro-israélien Jacques Givet publiait un pamphlet sous le titre suggestif: La gauche contre Israël? Mais que fallait-il entendre exactement par «gauche»? Le champ était vaste, d’autant que les communistes continuaient à en faire traditionnellement partie. C’étaient eux qui assenaient à Israël les coups les plus durs, dans leur presse ou à leurs réunions; je me dispenserai d’en produire des citations, me contentant d’observer que le parti communiste jouait le rôle d’une courroie de transmission entre la propagande soviétique et des milieux variés qui débordaient de loin son auditoire habituel. À vrai dire, l’expression de porteur de germes pourrait être mieux appropriée que celle de courroie de transmission, compte tenu et de la tonalité franchement antisémite des attaques, et d’une réceptivité qui pouvait se manifester indépendamment de convictions ou des affiliations politiques. Il ne fallait pas être nécessairement communiste pour dresser l’oreille en entendant M. Benoît Frachon, le secrétaire général de la C.G.T., proclamer que la tribu cosmopolite des Rothschild conduisait le bal, à Jérusalem. Voici un extrait de son discours (il s’agit d’une cérémonie religieuse, en juin 1967):
«La présence de certains personnages de la haute finance lui conférait un autre sens que celui de ferveur religieuse que pensaient y trouver les vrais croyants qui y participaient. Le spectacle faisait penser que, comme dans Faust, c’est Satan qui conduisait le bal. Il n’y manquait même pas le veau d’or, toujours debout, qui, comme dans l’opéra de Gounod, contemplait à ses pieds, dans le sang et la fange, les résultats de ses machinations diaboliques. En effet, les informations nous indiquaient qu’avaient assisté à ces saturnales deux représentants d’une tribu cosmopolite de banquiers bien connus dans tous les pays du monde: Alain et Edmond de Rothschild. À leurs pieds, des morts encore saignants96…»
Mais tout compte fait, la France dans son ensemble se montrait peu réceptive à cette contagion: tout au plus une proportion croissante d’intellectuels de toute obédience, qui ignoraient tout des artifices ou codages staliniens, se voulait-elle en toute innocence antisioniste.
Je n’ai pas encore évoqué l’influence particulière exercée par les nouveaux correspondants à Tel-Aviv du Monde et du Nouvel Observateur, ces deux grands porte-parole de la gauche modérée ou classique. Le quotidien avait adjoint à André Scemama M. Amnon Kapeliouk; l’hebdomadaire s’était assuré les services de M. Victor Cygielman. L’un comme l’autre appartenaient à la gauche israélienne: c’est dire qu’ils critiquaient leur gouvernement avec une véhémence qui, dans le cas de M. Kapeliouk, atteignit son point culminant pendant la guerre du Liban. On peut croire que, venant de citoyens israéliens, leurs accusations emportaient mieux la conviction des lecteurs que les remontrances parallèles de leurs confrères français; ils pouvaient d’ailleurs se permettre davantage. Au nom d’une moralité supérieure, ils dénonçaient donc à qui mieux mieux l’endurcissement d’Israël; en résultat, la vieille règle d’après laquelle les Juifs doivent toujours faire mieux et plus que les autres recommençait à jouer — à l’échelle étatique.
Restait la gauche nouvelle, ou ces gauchistes authentiquement révolutionnaires auxquels l’appellation de «génération de 1968» reste attachée. Ces derniers, avec leurs exigences éthiques proprement infinies, puisqu’ils aspiraient à une société parfaite, ici et maintenant, allaient longtemps conserver une partie de leurs illusions ou de leurs allégeances; treize ans plus tard, certains d’entre eux feront partie de la relève politique de mai 1981. Dès le début, pour des raisons d’ordres divers, ils seront nombreux à militer en faveur de la cause palestinienne. J’y reviendrai par la suite. Il convient auparavant de décrire comment les gouvernements français successifs, en modulant leur politique pro-arabe, se firent les grands champions européens de M. Yasser Arafat.
* *
*
Souvenons-nous de l’automne 1973, et de la panique pétrolière qui, au lendemain de la guerre du Kippour, s’empara de l’Europe, au point qu’en France, le gouvernement s’empressa, au nom de l’économie planifiée, de limiter la vitesse sur les routes et les autoroutes. En janvier 1974, M. Michel Jobert, ministre des Affaires étrangères, partait faire le tour des capitales arabes en commis-voyageur de la France. Il y fit merveille, du moins à en croire les grands titres des journaux: Koweit: des affaires pour l’industrie française, un aéroport, une aciérie, une usine (France-Soir); l’Arabie saoudite prête à baisser le prix de son pétrole (Sud-Ouest); Michel Jobert a mené à Damas des discussions «à la Kissinger» (Le Figaro). — Rappelons que dans ses Mémoires, Henry Kissinger se montre dur à l’égard de son ancien collègue: «Son objectif premier était le but traditionnel de la diplomatie française pendant la Ve République gaulliste: donner au moins l’impression que la France avait façonné les événements, quels qu’ils fussent.97» Quoi qu’il en soit, M. Jobert rentrait à Paris en triomphateur:
«Plutôt que des accords signés, résumait L’Express, ce sont des espérances qu’il rapporte. Économiquement d’abord: des promesses de pétrole pour les vingt prochaines années et la promesse d’ouverture de marchés. Mais aussi politiques: la diplomatie française, qui piaffe de dépit et d’impatience, ne désespère pas de se glisser en tiers dans le tête-à-tête entre les Américains et les Soviétiques, qui arbitrent le conflit du Proche-Orient, et la crise mondiale.»
À cette fin, ladite diplomatie multipliait les tentatives de séduction et avances en tout genre, convaincue qu’il n’était pas de meilleur moyen pour s’ouvrir les cœurs arabes. Elle en vint même à courtiser les terroristes de l’O.L.P. Du vivant de Charles de Gaulle, le même cours aurait été suivi avec plus de dignité… Rappelons les principales étapes: à la fin de 1973, l’O.L.P. est autorisée à installer ses bureaux à Paris, à la veille même du voyage de M. Jobert; ce n’est pas lui pourtant, mais son successeur Jacques Sauvagnargues qui en octobre 1974 serre la main du «président Arafat», le consacrant aux yeux de l’Europe. La diplomatie française assure alors qu’elle saura le «modérer» ou «l’assagir»: à qui fera-t-on croire que les avances ou faveurs prodiguées à cette fin et couronnées en janvier 1977 par la libération illégale d’Abou Daoud (le chef des tueurs des jeux Olympiques du Munich) furent une réussite? La France, cependant, parvient peu à peu à entraîner dans son sillage toute l’Europe, qui rejoint le groupe soviéto-arabe pour condamner les accords de Camp David, fondements de la première paix israélo-arabe. Le gouvernement français décide aussi, en mai 1980, d’autoriser le boycottage que les pays arabes veulent imposer à certaines entreprises françaises; mais cette décision, incompatible avec la loi «antiraciste» de 1977, sera annulée par M. Mitterrand98, qui par ailleurs se rallie aux accords de Camp David.
Venons-en maintenant au voyage oriental de M. Giscard d’Estaing, au lendemain des signes d’allégeance qu’à Varsovie, il venait de fournir à l’Union soviétique (début 1980). Dans le discours qu’il prononce en Jordanie, il préconise la participation de l’O.L.P. aux négociations israélo-égyptiennes. Il ne visite pourtant pas Israël, se bornant à braquer ses jumelles sur ce pays ostracisé. À cette occasion, M. Jacques Ellul en vient à écrire ceci.
«Eh bien, c’est fait! Nous avons donc vendu notre dignité pour du pétrole. Par ses déclarations, M. le président de la République française, Valéry Giscard d’Estaing, a commis l’ignominie de condamner virtuellement Israël à mort pour assurer notre approvisionnement en carburant. Le pétrole pue, tout le monde le sait — mais ce n’est pas seulement olfactif —, il pue moralement par-dessus tout, et il s’est mis à tout corrompre. L’Islam, dont tout le monde se moquait éperdument (à tort!) il y a vingt ans, devient le centre de nos amitiés, de nos respects, de nos trahisons. Parce qu’il détient le pétrole. Et du coup, l’intérêt des “études islamiques” chez les intellectuels, le souci d’un œcuménisme avec l’Islam chez les religieux grandissent passionnément!» (Le Monde, 8-3-1980).
Trois ans après, le cours des choses avait déjà confirmé qu’en se dissociant d’Israël, l’Europe ne s’était nullement assuré les faveurs des principaux chefs d’État ou dictateurs arabes, dont les véritables dispositions se sont révélées au grand jour, pendant la guerre du Liban. Tout porte à croire que pour la majeure partie, ils ne voyaient pas d’un mauvais œil l’affaiblissement de l’O.L.P., ce dont le gouvernement de M. Mitterrand semble avoir tiré ses conclusions. Mais ce ne sont pas les ambitions du Quai d’Orsay qui suscitèrent à travers l’Occident une unanime levée de boucliers. Elle procède en premier lieu d’une évolution des mentalités, liée à la relève des générations et dont les conséquences s’accumulaient au fil des années. Il en résulta notamment un pacifisme à la fois viscéral et idéologique, propice aux desseins de la désinformation soviétique. Il est donc temps pour nous d’en venir à la grande mutation occidentale, centrée, dans le cas français, sur «la génération de 1968».
Chapitre V
La génération de 1968
Une quinzaine d’années durant, de 1946 à 1962, les guerres de décolonisation constituèrent le problème français majeur, mettant au premier plan des préoccupations de la gauche les problèmes du tiers monde (le terme fut forgé en 1952 par l’économiste Alfred Sauvy). Le parti communiste, au prestige encore intact, axait une partie de sa propagande sur «la libération des peuples asservis», mais point n’était besoin de lire L’Humanité pour s’apercevoir que le fossé entre les riches et les pauvres, partiellement aplani en Occident par la société d’abondance, ne cessait de se creuser entre celui-ci et la population des pays dits «sous-développés». Comme toujours en pareil cas, on mit du temps à tirer les conséquences. Sans doute fallut-il auparavant que le vieux mythe prolétarien s’estompe, et que s’opère un «transfert de culpabilité». Il fallut notamment que les victimes légendaires du racisme nazi, les Juifs, désormais «imaginaires» puisque bien intégrés dans la société française, soient relégués dans l’ombre par les victimes bien réelles des famines périodiques ou des conflits armés qui éclataient aux quatre coins de la planète, et par ces travailleurs arabes qui, dans la métropole même, étaient devenus les principaux souffre-douleur du racisme populaire.
En l’occurrence, la guerre d’Algérie, qui mobilisa de la manière qu’on sait la fine fleur de l’intelligentsia, servit de prélude aux nouvelles orientations. C’est au moment où elle s’achève que Paris devient le principal laboratoire des mythes révolutionnaires du Tiers monde, avec le magistère philosophique de Jean-Paul Sartre, Les Damnés de la terre de Franz Fanon (1962), La Révolution dans la révolution de Régis Debray (1967). Peu à peu, les maîtres à penser s’engagent, comme on disait naguère; au choc algérien succèdent les sollicitudes pour le Vietnam et l’Amérique latine; à peine y a-t-on adjoint les Palestiniens que survient la grande secousse de Mai 1968. Faut-il rappeler que les milliers d’étudiants exaltés qui, pour hâter le Grand Soir, voulurent «aller au peuple», cherchèrent d’abord à éclairer les ouvriers de Flins ou de Renault — où ils furent conspués? L’ardeur révolutionnaire de ces jeunes gens ne baissa pas pour si peu. Elle se reporta sur les utopies tiers-mondistes, qui d’ailleurs autorisaient la rêverie permanente, faute de pouvoir participer, du moins dans le cas du commun des mortels, aux luttes et aux guerres qui se poursuivaient au loin.
Cela dit, la vague palestinophile de 1968, le plus souvent placée sous le signe du marxisme, comptait deux ailes dynamiques et un vaste centre. C’est par l’aile chrétienne, dont les porte-parole renouaient à leur insu avec un passé immémorial, que nous allons commencer.
L’aile chrétienne
Sans remonter aux Croisades («Gesta Dei par francos», constatons qu’au lendemain de la Première Guerre mondiale, la France cherchait déjà à exercer son protectorat sur les Lieux Saints. C’est dire si sa diplomatie était antisioniste autant qu’anti-anglaise. De son côté la presse catholique en profitait pour reprendre ses campagnes antijuives d’antan99. Pourtant, durant la grande épreuve de l’Occupation, l’Église de France en son ensemble s’employa de son mieux à venir en aide aux Juifs persécutés. Le symbole le plus clair de cette attitude demeure les cahiers clandestins de Témoignage chrétien, qui dénonçaient sans relâche les entreprises homicides des Nazis et de leurs complices vichyssois. «France, prends garde de perdre ton âme100!»
Après la Libération, Témoignage chrétien devenu un hebdomadaire, fut placé entre les mains d’un dynamique catholique de gauche, Georges Montaron, qui s’affirmait progressiste et même révolutionnaire. Par la suite, il décrivit ainsi son équipe: «Nous ressemblions beaucoup à ces gauchistes de la cuvée 1968 qui sentent les problèmes, ont le courage de dénoncer les scandales, sont d’une générosité et d’un militantisme à toute épreuve, mais qui ne savent pas démêler, comme il convient, ce qu’il y a d’utile dans l’utopie et de nécessaire dans le réalisme» (Quoi qu’il en coûte, 1975, p. 87). Et il se réclamait de «ces chrétiens qui cherchent des voies nouvelles dans le sillage des communistes». La contamination était donc inévitable, et la position clairement tracée, pour ce qui était de la guerre d’Algérie ou du Vietnam; mais pour Israël, le virage consécutif à la guerre des Six Jours fut particulièrement brutal. Certains catholiques, en effet, ne supportèrent pas, entre autres choses, que Jérusalem fût conquise par des soldats israéliens, c’est-à-dire juifs. D’antiques souvenirs semblaient revenir en mémoire… Témoin, ces photos surmontées de légendes telles que: «Soldats et civils israéliens au Mur des lamentations — des Lieux où le Christ a vécu» (T.C. 23-6-1967) ou «Les soldats israéliens au Mur des lamentations», aux côtés d’un article violemment antisioniste (6-7-1967). Plus caractéristique encore fut la publication de la brochure Jérusalem et le sang des pauvres (Cahiers de «Témoignage chrétien» no 47). Elle avait été rédigée par les «Compagnons de Jésus», P. Paul Gauthier et sœur Marie-Thérèse, qui, à Jérusalem, avaient fait œuvre missionnaire parmi les Arabes pauvres. Dès le début de juillet, le Père Gauthier proposait de transformer Jérusalem, la citée reconquise, en capitale du genre humain tout entier, et accusait les Israéliens de racisme, en citant à l’appui, pêle-mêle, l’Ancien Testament et la philosophie antijuive de Simone Weil:
«Dans cette guerre dite des Six Jours, les généraux israéliens ont été plus humains que leur ancêtres. Ils n’ont pas fait massacrer les populations. Mais au nom d’un prétendu droit sacré sur ces terres, ils en ont fait chasser les habitants pour que seule la race d’Abraham y habite. Plusieurs chrétiens et Juifs qui ont vu cela éprouvent, comme Simone Weil, un malaise devant une nation raciste et matérielle de Dieu trois fois saint. Si cette interprétation était vraie, combien encore auraient le courage de lire certaines pages de l’Ancien Testament, prônant le massacre des vaincus et le mépris des goyim…»
Plus surprenant encore est le journal tenu par sœur Marie-Thérèse, longue liste de brutalités, pillages et «intentions de génocide de la part des Israéliens». Mais quelle foi ajouter à cette litanie entrecoupée d’accès de fureur sacrée? Ainsi, cette notation du 9 juin:
«… Je vois des filles israéliennes le revolver au poing qui éclatent de rire, ivres de triomphe. Une file de “dati” (pratiquants) à papillotes, aussi laids, efféminés et ridicules que d’habitude, se dépêche d’arriver derrière les blindés qui leur ont ouvert les portes du Temple. L’orgueil du Dieu des armées est sur leur visage. Je pense à Simone Weil qui, juive, a si cruellement senti l’opposition d’un Dieu national au Dieu de l’Évangile. Parmi les autres, un Juif s’adresse à Père Paul qui n’arrive pas à le reconnaître tant il a l’air angoissé:
- Mais je suis votre ami B. de Haifa.
- Ah! mais vous avez l’air si fatigué.
- Non, écœuré par ces bandits de Juifs qui ont pillé, saccagé comme des vandales. Dans la région de G…, nos soldats ont tué deux femmes pour voler leurs bijoux. J’aurais tant de choses à vous raconter mais je dois partir avec ceux-là qui me dégoûtent.»
Et ainsi de suite. À Paris même, les rédacteurs de Témoignage chrétien ne tardent pas à se mettre à l’unisson: Paul Audrey, sous le titre «Les Israéliens et les Allemands», affirme que l’occupation israélienne est plus dure que ne le fut l’occupation nazie à ses débuts, que les soldats allemands se montraient plus secourables, plus humains… (23-8-1967). Finalement, Georges Montaron lui-même en vient à reprendre un leitmotiv de cette campagne: celui du Christ palestinien. — Son inventeur n’était-il pas le cabaliste Emmanuel Levyne? — Dès la fin de 1967, il annonçait en effet la bonne nouvelle:
«Le Christ est un réfugié palestinien. Moi qui suis juif, je le comprends, je le vois. Pourquoi tant de chrétiens sont-ils aveugles? Pourquoi ont-ils pris parti pour les plus riches, les plus forts? […] Qui a assassiné le Christ? On va bientôt le savoir, si on ne le sait déjà, par les événements de Palestine101.»
À la veille de Noël 1969, c’est-à-dire deux ans plus tard, Georges Montaron faisait écho à cette idée en l’expurgeant toutefois de ses élans hérétiques:
«… Comment, dans cet océan de l’abondance, pouvons-nous entendre le message de Noël et découvrir Jésus-Christ? — Il est là, pourtant, dans les Pauvres. — Dans ce Proche-Orient que le Christ a foulé de ses pieds. Il est avec les réfugiés qui luttent contre le froid, avec ceux qui veulent être des hommes debout. Il est avec tous ceux qui se battent pour leur dignité. Il est avec les occupés dont les droits sont piétinés et la liberté réduite à la ration congrue. Il est avec les petits Juifs de Haifa et de Jaffa, méprisés et exploités par les riches. Il est avec les Palestiniens, qu’ils soient musulmans, juifs ou chrétiens, dès l’instant où ils sont pauvres. Car Dieu est né au milieu des pauvres […]»
Suivait la diatribe de rigueur:
«Mais les chrétiens d’Occident sont soumis à la diabolique propagande d’une doctrine néfaste, plus encore pour le peuple juif que pour les Arabes: le sionisme.»
L’organe catholique avait d’ailleurs son pendant protestant, Christianisme social, qui en automne 1967 publiait un numéro spécial, intitulé «Jérusalem, Jérusalem…» d’une théologie plus nuancée que son aîné, mais mettant tout comme lui les chrétiens en garde contre Israël au nom des Pauvres de ce monde — et bien entendu, de l’intérêt des Juifs eux-mêmes: «Les chrétiens n’ont rien fait… quand il en coûtait véritablement d’être pro-juif. Maintenant que cela est à la mode, ils sont pro-israéliens, sans comprendre qu’être pro-juif aujourd’hui, c’est être pro-arabe et pro-vietnamien.» La flamme de 1968102…
Il faut convenir que, catholiques ou protestants, les chrétiens de gauche jouèrent un rôle de précurseurs. L’infatigable Montaron fut aussi l’initiateur d’une conférence internationale des chrétiens antisionistes, qui se réunit en mai 1970 à Beyrouth. Plus de trois cents pasteurs ou prêtres européens et américains y prirent part (mais aucune Église n’était officiellement représentée). Comme on pouvait s’y attendre, cette conférence se sépara sur la décision «d’arrêter le phénomène sioniste, qui est un défi à la terre et au ciel» (la formule était due au président du Liban, Charles Hélou). Montaron pour sa part continuait à censurer toute manifestation d’antisémitisme, mais l’on sait que pratiquement, la ligne de démarcation n’est pas aisée à tracer, et si, en Europe comme aux États-Unis, les chrétiens des deux confessions s’efforçaient le plus souvent à la respecter, en Amérique latine et dans d’autres régions éloignées, le message antisioniste, se combinant avec les propagandes révolutionnaires et stimulé par les fastueuses dotations arabes, tournait en général à l’antisémitisme pur et simple. Sous ce rapport au moins, la conférence de Beyrouth eut une audience mondiale.
Mais en Europe aussi, Témoignage chrétien multipliait les déclarations et hardiesses révolutionnaires. C’est ainsi que son principal commentateur théologique, François Biot, non content de critiquer l’Ancien Testament, récusait une partie du Nouveau, et plus particulièrement «les élucubrations personnelles de Paul de Tarse». Cette contestation avait d’ailleurs connu des précédents, dans l’Allemagne luthérienne du passé103.
Contrairement, toutefois, au gros des contestataires de 1968, l’équipe de Témoignage chrétien mettait l’accent sur la cause des pauvres de ce monde, plutôt que sur un bouleversement universel. Mais elle n’en était pas moins fascinée par une «révolution» qui, en matière de théologie comme en toute autre, porte la réaction en germe. Ainsi, pourraient s’expliquer, puisés dans une condamnation remontant à la naissance du christianisme, les emportements d’une sœur Marie-Thérèse et d’un Père Gauthier. Ce dernier s’en prenait aussi, au lendemain de la victoire israélienne et dans un style voisin de celui de L’Humanité, aux Juifs pratiquants «qui envahissent, derrière l’armée, la vieille ville de Jérusalem, dans leur religieux triomphe» et il taxait Israël de «racisme religieux» (Le Monde, 1er août 1967).
Georges Montaron lui-même, attaqué de toutes parts, se laissait peu à peu happer par cet engrenage antisémite qu’il redoutait par-dessus tout. En été 1981, il en venait à brandir contre «Israël l’État terroriste», d’une manière à peine allusive, l’antique accusation de peuple déicide, coupable du plus grand péché de tous les temps, et au surplus fidèle à la cruelle maxime «œil pour œil, dent pour dent». Aussi bien était-il condamné en justice pour provocation à la haine et à la violence, conformément à la législation en vigueur. Citons les motifs:
«Hostile à la politique militaire de l’État d’Israël, Georges Montaron pouvait condamner le bombardement de Beyrouth sans rattacher les opérations menées par les autorités israéliennes à l’idée que les Juifs qui tuent leurs voisins arabes “se croient tout permis parce qu’ils disent être le peuple élu”[…]Selon le deuxième passage incriminé, la volonté des Israéliens de nier l’existence des Palestiniens s’explique dans la mesure où ce peuple est le témoin du “péché d’Israël”. Il s’agit évidemment de la crucifixion de Jésus-Christ […].
«Ce thème ancien du “peuple déicide” fit partie du fond commun populaire de la chrétienté avant d’être combattu et condamné. Son rappel, qui est redoutable dans la mesure où il peut provoquer le réveil possible d’une agressivité séculaire, constitue une incitation à la discrimination et au mépris…» (Tribunal de grande instance de Paris, 25-5-1981).
Les troupes gauchistes
Entre les révolutionnaires chrétiens et les autres, il y eut un décalage dans le temps. Les premiers avaient pris parti, dès l’été 1967, pour les pauvres; les seconds ne s’engouèrent véritablement pour la cause palestinienne que lorsque s’enclencha, en 1970, l’engrenage de la terreur sanglante. C’est alors seulement que les activistes de l’O.L.P. devinrent, aux côtés des guérilleros sud-américains ou des soldats vietnamiens, un pôle d’attraction pour les jeunes Occidentaux assoiffés de justice et séduits, de ce fait, par les bouleversements violents, surtout lorsqu’ils se produisaient au loin, et se laissaient travestir en luttes apocalyptiques entre le Bien et le Mal («Le monde est rempli d’idées chrétiennes devenues folles», soupirait jadis H.-G. Chesterton).
Signalons néanmoins pour mémoire les comités «Israël-Palestine» qui fleurirent pendant deux ou trois ans dans les universités françaises et belges, animés, pour l’essentiel, par des étudiants juifs. Ils réclamaient pour un État israélien dûment désionisé les mêmes droits que pour le futur État palestinien et les autres États arabes, mais faute d’adhésion d’activistes palestiniens, et sans doute aussi faute de moyens, ils disparurent peu à peu sans éclat. Le même sort attendait Israc, la revue des trotskistes israéliens, à programme tout aussi radical. Ses militants avaient beau réclamer le renversement du régime établi, et accuser leur gouvernement de pratiquer depuis 1917 «le génocide à froid» des Palestiniens, le concours des Arabes quels qu’ils soient leur faisait cruellement défaut.
Ces derniers, cependant, accroissaient en 1969-1970 leur audience dans les universités parisiennes, parmi les étudiants qui avaient prêté l’oreille à l’appel de Che Guevara: «Il nous faut de nombreux Vietnam!» Or, la cause de l’O.L.P. se laissait aisément identifier à celles de Cuba ou de la Chine, ces autres «Vietnam». Témoin, un reportage publié le 21 septembre 1970 dans Le Nouvel Observateur, qui continuait à accorder un soutien inconditionnel aux aspirations estudiantines. Son auteur, Jean-Francis Held, y traitait des Palestiniens de Jordanie, tout en se référant à Cuba ou au Vietnam. «À Irbid, écrivait-il par exemple, c’était Hanoï, ou plutôt Santiago de Cuba après l’arrivée des “barbus”: un tourbillon de véhicules armés, un îlot révolutionnaire.» Suivait la citation de Mao: «On parle volontiers de la majorité silencieuse, moi, à Amman et dans le Nord, j’ai plutôt vu des fedayin comme des poissons dans l’eau.» Ce reportage s’intitulait: «Cette fois, le feu!» Hélas, le feu qui éclata fut celui des bédouins du roi Hussein, qui massacrèrent ou expulsèrent des dizaines de milliers de Palestiniens («Septembre noir»).
Un autre reportage, publié à la fin de l’année 1969 dans la revue juive L’Arche, se limitait à la description d’un phénomène parisien: la prise progressive du pouvoir verbal dans les universités par les jeunes activistes pro-arabes ou arabes. On peut penser, toutefois, que ce reportage ne décrivait que la partie visible de l’iceberg; seule une note en bas de page signalait «la difficulté “de citer des noms de journaux” subventionnés, sans risquer des poursuites judiciaires». Déjà les subventions de l’Arabie Saoudite ou du Koweit? À ce propos, comment ne pas constater que «l’emprise sioniste» sur les médias était dénoncée, alors (et continue parfois de l’être), avec beaucoup plus d’ardeur que celle des pétrodollars. Cela dit, ce reportage mérite d’être cité104:
«…Enfin, Mai 68 vint, y lisait-on. Ces événements, que les journaux arabes dénoncèrent alors comme un “complot sioniste”, furent en fait la grande chance de la propagande anti-israélienne. Les étudiants arabes, qui depuis la guerre d’Algérie accomplissaient un patient travail de pénétration dans le mouvement étudiant français, se mêlèrent à l’insurrection. On les trouva dans la cour de la Sorbonne, sous le slogan “El Fath vaincra”. Ainsi débutait la nouvelle phase de la campagne anti-israélienne en France […]. Dans les halls des facultés, des banderoles proclamaient: “Vietnam-Palestine, même combat.” Des affiches expliquaient en termes simples le sens de la lutte du peuple palestinien contre “Israël, État raciste et théocratique créé par l’impérialisme”. Les étudiants passaient, s’arrêtaient, discutaient. L’ambiance était formée.»
Et l’auteur, Meir Waintrater, d’ajouter: «C’était éga-lement un bon placement pour l’avenir, puisqu’on touchait ainsi les futurs cadres de la société française.» On notera que ce jeune observateur voyait loin.
Venons-en maintenant à un troisième son de cloche. Au printemps 1970, la revue gauchiste la plus ancienne, Partisans, consacrait un numéro de deux cents pages au «Peuple palestinien en marche». Comme il n’apprenait à peu près rien sur ce peuple, son contenu aurait été infiniment mieux rendu par le titre «Le règne du sionisme», par exemple. Cependant, deux brèves études, reléguées à la fin du fascicule, méritent notre attention.
La première, due au spécialiste du tiers monde Gérard Chaliand, s’intitulait: «La Palestine n’est pas le Vietnam.» Cet expert remettait les choses bien en place: l’idéologie de l’O.L.P. n’était pas révolutionnaire, mais nationaliste et petite-bourgeoise; Israël n’était pas une agence impérialiste, mais une nation: «Il y a un fait national israélien comme il y a un fait national palestinien.» Encore plus remarquable était l’étude de M. Pierre Vidal-Naquet, devenu depuis 1967 l’un des plus ardents censeurs de gauche de l’État juif. Mais cette fois-ci, considérant les préventions antisionistes autrement dures des lecteurs de Partisans, il recommandait aux «militants de la gauche révolutionnaire […] de prendre conscience d’un certain nombre de réalités gênantes», compte tenu notamment de leurs étranges humeurs (toute référence au génocide nazi «casse les pieds, paraît-il, de certains de nos camarades»). Sa pédagogie en dit long sur les utopies cultivées à l’époque par les groupuscules révolutionnaires:
«Libre à chacun d’imaginer une libération de la Palestine qui s’accomplirait sur les ruines du Caire, d’Alexandrie, de Beyrouth et de Damas, sans parler de Jérusalem ou de Tel-Aviv — et je passe sur ce fait qu’une telle libération s’appuierait fatalement et dans une certaine mesure s’appuie sur les forces les plus rétrogrades de l’antisémitisme, qu’il soit “chrétien” ou “socialiste”; je ne crois pour ma part cette perspective ni satisfaisante ni du reste vraisemblable. Mais il faut bien comprendre que, dans la vision d’une libération totale de la Palestine, il n’y en a pas d’autres, car la guerre de guérilla n’a pas l’ombre d’une chance de vaincre un État moderne s’appuyant sur une nation intégrée.»
Je ne sais à quel point ces avertissements firent leur effet. Leur véritable intérêt est de nous rappeler une ambiance bien oubliée, celle d’une pépinière idéologique dont certains militants, mûris et assagis, occupent de nos jours des positions d’autorité ou d’influence, sans pour autant avoir répudié leurs allégeances d’antan.
Voici, pour conclure, un tableau d’ensemble des jeunes troupes antisionistes, brossé par M. Daniel Lindenberg, sous le titre Naissance d’une passion: les gauchistes français et «La Palestine»105 :
«Il faudrait d’abord distinguer à mon avis entre antisionisme et “palestinophilie”. L’antisionisme a de très anciennes racines dans la gauche, non seulement communiste, mais aussi socialiste (le fait israélien comme fait colonial — la tendance Marceau-Pivert) ou libertaire (par haine de tout État). Néanmoins cet antisionisme est partout marginal entre 1948 et 1967, d’autant plus que son homologue d’extrême-droite reste virulent, lié à des souvenirs de l’Occupation encore très vivaces. Et surtout, il ne s’accompagne d’aucune héroïsation du “peuple palestinien”, terme encore inconnu, on ne parle que “des Arabes”, de “nation arabe”, etc. Enfin, il existe, jusqu’au sein de l’ultra-gauche, des tendances très pro-israéliennes. En 1961 paraît aux éditions Maspero un livre très curieux intitulé Le Conflit judéo-arabe, sous la signature d’Abderrazaq Abdelkader. L’auteur développe en termes marxistes la thèse selon laquelle Israël serait en fait une force révolutionnaire qui défie la réaction arabe et représente pour elle un danger mortel qu’elle tente vainement d’étouffer! Le seul fait que ce livre ait pu paraître chez Maspero montre que dans la gauche anticolonialiste qui soutient le F.L.N. algérien il y a encore un débat sur la question d’Israël. Les positions d’un Pierre Vidal-Naquet, par exemple, ne sont pas du tout ce qu’elles sont aujourd’hui. Celles de Témoignage chrétien (et de la gauche catholique en général, encore marquée par la culpabilité des années noires) non plus.»
«Tout va changer, on le sait, avec la guerre des Six Jours, à la fois sur la droite de l’arc idéologique — avec la “petite phrase” du général de Gaulle sur le peuple sûr de lui-même et dominateur — et sur la gauche, avec la promotion des fedayin en figures centrales d’un tiersmondisme en pleine expansion. En juin 1967, maoïstes, P.S.U. (sous la houlette de Michel Rocard), trotskistes et chrétiens progressistes s’en tiennent encore à un soutien global des “Arabes”, victimes de “l’impérialisme” sioniste, “agent des U.S.A.” Mais en 1968, El Fath trône au beau milieu de la cour de la Sorbonne, tandis que les “sionistes” (en fait des militants proches de l’ultra-gauche israélienne…) manquent s’en faire expulser manu militari. Le temps où Daniel Cohn-Bendit et ses amis, à Nanterre, envisageaient le départ au Kibbutz comme une issue possible à leurs rêves utopiques paraît déjà bien loin.
«1969: aux côtés du combattant vietnamien et du guérillero d’Amérique latine, le fidaï palestinien s’impose dans l’imaginaire gauchiste. Les “Comités Palestine” (ou Vietnam-Palestine) fleurissent dans les facultés. La Cause du peuple, organe de la gauche prolétarienne maoïste, bat tout le monde de quelques longueurs dans le délire, en comparant par exemple son dirigeant Geismar, emprisonné pour quelques mois, à… Yasser Arafat, ou une obscure bagarre contre des permanents communistes à Argenteuil ou à Bezons à la défense de Karamé par les fedayin. D’autres faits alors moins spectaculaires n’en sont pas moins lourds de conséquences pour l’avenir: c’est en effet à la même époque que les vieilles thèses de Rassinier, reprises par les organes du parti communiste-internationaliste (bordiguiste) sur l’inexistence du génocide hitlérien, trouvent des oreilles complaisantes dans l’ultra-gauche, y compris auprès de militants juifs soucieux de retrouver la légitimité “révolutionnaire” du judaïsme… Les éditions Maspero, toujours bon baromètre, publient à présent un flot de littérature palestinienne. Quand le distingué écrivain marocain Tahar ben Jelloun demande à François Maspero de retirer de sa librairie toute littérature sioniste de gauche, cette demande inouïe reçoit aussitôt satisfaction.
«En décembre 1969 un “Congrès Palestine” est organisé à Alger. Des gauchistes français de toutes les sensibilités maoïstes ou spontanéistes s’y retrouvent, en présence de Yasser Arafat lui-même. Eldridge Cleaver, le leader des “Panthères noires” américaines, y prononce un discours antisémite d’une violence telle qu’elle provoque un indiscutable malaise. Mais Abu Hassan, un dirigeant du Fath, provoque l’enthousiasme par un discours dur, de ton très “chinois”. Parmi les participants, Gilbert Mury, qui tente alors l’opération que Garaudy “réussira” plus tard: accomplir la jonction de la radicalité anti-impérialiste pro-palestinienne avec l’intégrisme chrétien.
«Contrairement à ce qui s’est passé dans d’autres pays (Allemagne, Italie, Japon, Turquie), des liens très concrets ne se sont pas noués entre le gauchisme français et le terrorisme palestinien. Les témoignages des ex-dirigeants maoïstes sont unanimes: l’attentat de Munich, le massacre des athlètes israéliens furent parmi les traumatismes qui les retinrent sur la voie terroriste. En somme, le réflexe “dreyfusard” de la gauche avait une fois de plus joué. N’oublions pas par ailleurs que beaucoup de ces garçons venaient d’un foyer juif, est-européen ou égyptien. D’autre part, c’est probablement dans les milieux trotskistes, chez les “pablistes”, qu’on alla le plus loin dans la collaboration, à travers l’extrême-gauche tunisienne ou algérienne, avec certains groupes palestiniens. Mais là également, l’origine juive de beaucoup de militants fut sans doute un frein (inconscient?) à une collaboration trop poussée.
«Mais c’est dans des milieux tout à fait étrangers à la tradition marxiste-révolutionnaire que va en fait se développer pendant toute la décennie 1970-1980 la palestinophilie la plus délétère. Chrétiens progressistes en quête d’un nouveau peuple-Christ, orphelins de l’Action française illuminés par une politique méditerranéenne dirigée contre le “peuple d’élite, sûr de lui-même et dominateur”, et aussi agents plus ou moins stipendiés des gouvernements arabes “révolutionnaires” imposent peu à peu l’idée que les Palestiniens sont les “nouveaux Juifs”, peuple sans terre victime d’un déni de justice intolérable. Ces formules se trouvent en effet très tôt dans les petites publications catholiques, liées à la “théologie de la Révolution” comme la Lettre et Frères du Monde. De même le P.S.U. sème cette nouvelle vulgate à tous vents, sous la signature de journalistes qui se retrouveront après le 10 mai 1981 à la télévision. Comme dans un domaine pour lequel jouent des mécanismes très semblables — le pacifisme — le P.C. trouve là une large réserve d’alliés, sans même qu’il soit besoin de mener un travail de noyautage très actif.
«Ce chapitre serait incomplet si nous n’évoquions pas cette famille de militants d’extrême-gauche qui, en décidant de nier les crimes nazis, et plus spécialement l’existence des chambres à gaz, ont en fait pris la suite des vieux antisémites de droite. En France, ils se sont groupés à la fin des années 1970 autour du professeur de littérature Robert Faurisson, et leur chapelle, dite des “historiens révisionnistes”, peut se prévaloir d’une volumineuse production à prétentions érudites, qui a entraîné, dans certains cas, des condamnations en justice. Celui qui veut en savoir davantage peut consulter, à ce sujet, les excellents travaux d’Alain Finkielkraut, de Nadine Fresco, de Pierre-André Taguieff et de Pierre Vidal-Naquet106. Des “écoles révisionnistes” de ce genre fleurissent d’ailleurs dans tous les grands pays occidentaux. Il s’agit donc d’une désinformation historique poussée à l’extrême: d’après la formule imagée du nestor antisémite Darquier de Pellepoix, ancien commissaire aux questions juives du gouvernement de Vichy, “à Auschwitz, on ne gazait que des poux107.”»
Il faudrait également pour finir s’interroger sur certaines formes «d’irrespect» issues du mouvement de Mai, et qui s’attachent sournoisement à briser les tabous liés au génocide et à l’antisémitisme. «Ohé les Juifs!» lit-on dans Tout en 1971, un «journal de masse» qui peut être considéré comme un ancêtre de Libération. Les Juifs y sont ridiculisés, comme ils le sont à l’occasion dans Charlie-Hebdo. Personne alors n’y prend garde. De même que personne ne prête attention à la palestinophilie d’un certain nombre de distingués intellectuels parisiens délicieusement «nietzschéens», adversaires de la morale judéo-chrétienne (mais non des mœurs islamiques…), et qui ont dans la Lumpenintelligentsia un soutien enthousiaste. Ces gens-là n’ont jamais condamné les falsifications de Faurisson, mais critiquent avec indignation par contre «les mensonges du sionisme». Ils sont à compter parmi les responsables culturels de la crise actuelle, tout comme les idéologues de la «Nouvelle Droite».
L’aile juive
Le conflit entre générations affecte tout particulièrement les Juifs; cela a trait à leurs pérégrinations et acculturations, mais aussi à cette tendance à l’autocritique dont j’ai déjà parlé. Au-delà du rejet de la tradition ancestrale, ce conflit peut conduire au dénigrement de sa propre lignée, c’est-à-dire à la haine de soi-même108. Il devait revêtir une forme nouvelle au XXe siècle. Avant le génocide hitlérien, les grands-parents se ralliaient, dans presque tous les pays de la dispersion, au camp qui leur paraissait politiquement propice, celui de la gauche, celui du progrès et des réformes, celui du pacifisme ou de la révolution. Les parents, à l’issue de la terrible épreuve, devinrent dans leur majorité des partisans fervents de l’État juif, souvent d’autant plus inconditionnels qu’ils continuaient à mener une existence bourgeoisement confortable dans leur «exil» occidental. Faut-il s’étonner si une partie des enfants, surtout après 1967-1968, se voulurent à leur tour des révolutionnaires, militant pour le bonheur universel du genre humain? Ils ne formaient qu’une minorité, mais singulièrement agissante. La sociologue Dominique Schnapper109 qualifie les Juifs anti-israéliens de ce type de «petits-enfants du peuple élu», et après avoir évoqué les luttes libératrices des grands-parents, elle s’en explique ainsi:
«Opposant leur idée de la justice, que définissait déjà Abraham, à une réalité sociale nécessairement décevante pour ceux qui rêvent de l’État d’Israël idéal, sensibles aux inégalités qui séparent en Israël la condition sociale des Juifs et celle des Arabes, celle des achkenazes cultivés (originaires d’Europe de l’Est) et celle des sépharades pauvres, récemment arrivés, ils jugent l’État d’Israël raciste, donc fasciste, donc impérialiste, donc condamnable et condamné par la conscience universelle. Ils retrouvent ainsi, sans le vouloir et sans le savoir, l’attitude d’un de ces défenseurs inconditionnels de la tradition que l’écrivain Albert Memmi décrit avec indignation: “Notre dévot préconisait tout simplement, pour sauver la tradition, d’égorger s’il le fallait tous les Juifs. Je n’invente rien.” […] De la même manière, nos militants déclarent préférer l’anéantissement de l’État d’Israël (encore que certains d’entre eux, nous le verrons, n’arrivent pas à aller jusque-là) à sa persistance sous sa forme actuelle, moralement injustifiable.»
Et Dominique Schnapper tente de cerner les formes juives d’un phénomène universel, fréquent chez les chercheurs de l’absolu: le passage d’une foi à l’autre:
«Aussi profondément juifs que les pratiquants, les militants d’extrême-gauche constituent un monde à part dans le monde juif. […] Ils ont remplacé la lecture et le commentaire du livre des Prophètes et du Talmud par la lecture des Résistants juifs. Comme leurs pères et grands-pères, ils restent essentiellement moraux, d’une moralité politique transfigurée par la croyance.»
Il va de soi que de tout temps, et plus particulièrement dans la confusion idéologique du monde contemporain, les parcours individuels furent variés au possible. J’ai déjà évoqué les militants de l’Israc, dont les alliés israéliens, les activistes du Matzpen, sont assez proches du Dr Israël Shahak, ou l’avocat Félicia Langer (voir, à Paris, La Revue d’études palestiniennes). En Israël, ils bénéficient de sympathies dans de nombreux kibbutzim et auprès de quelques écrivains de renom. Mais passons à des figures mieux connues en France.
Commençons par le militant anarchiste Pierre Goldmann, qui fut frappé à mort en 1978 par une balle fasciste. Dans ses Souvenirs obscurs…, souvenirs d’une vie singulièrement intense, il convenait de ses clivages110:
«Je suis né athée et je suis né Juif. […] Cette guerre (des Six Jours) m’était indifférente bien que j’y fusse, en quelque sorte, profondément impliqué et qu’elle me passionnât aussi. Je ne pouvais envisager sans désespoir la disparition de l’État d’Israël et je ressentais dans une nausée écorchée et haineuse les appels mortifères qui montaient en hurlements hystériques des radios arabes. Mais à Israël comme à toute terre, j’étais étranger. J’étais trop Juif pour être ou me sentir Israélien. […] Ils lavaient le peuple juif de l’infamante accusation de lâcheté. Mais je pensais aux Juifs des Brigades, aux Juifs du groupe Manouchian-Boczov, aux Juifs de l’Orchestre rouge…»
On ne saurait augurer du chemin qu’aurait emprunté cet écrivain de grand talent, abattu dans la fleur de l’âge.
Venons-en maintenant à deux figures de proue de la contestation universitaire. Daniel Cohn-Bendit rapportait en 1969, d’un voyage en Israël, où il s’était rallié aux trotskistes du «Matzpen», les critiques auxquelles on pouvait s’attendre:
«Le voyage a marqué une coupure. À partir du moment où j’ai vu le caractère fascisant de la société israélienne, où j’ai vu les camarades du Matzpen se faire cracher à la figure dans la rue, les Israéliens n’étaient plus pour moi le pauvre peuple. C’était l’Afrique du Sud. Le racisme est patent. Le rapport des Juifs européens aux Juifs d’Afrique du Nord contient en germe le racisme des Juifs à l’égard des Arabes. […] Dans trente ou quarante ans, quand des gens se pencheront sur la question d’Israël, pour les jeunes qui se politiseront, pouvoir s’identifier au Matzpen sera quelque chose d’extrêmement important. Le Matzpen est l’honneur des Juifs. Pas seulement politiquement, mais aussi pour leur conscience111…»
Mais en 1978, Daniel Cohn-Bendit, tout en demeurant fidèle à ses convictions anarchistes, s’exprimait avec une plus grande équanimité112:
«J’ai beaucoup de difficultés avec l’État d’Israël. Longtemps, j’étais sioniste sans me l’avouer. Et puis, j’en étais arrivé à ce sentiment: si nous, Juifs, bâtissons un État, alors il doit être un État exemplaire. Je n’ai aucune affinité pour les États et je ne vois pas pourquoi je défendrais un général juif alors que je hais les généraux. Plus tard, j’ai été confronté à la guerre des Six Jours. Je suis devenu un opposant à l’État d’Israël après avoir eu la certitude qu’il ne serait pas détruit. […] C’est après mon voyage en Israël que mon pacte — conscient ou inconscient — avec Israël a été brisé. J’avais été choqué par les différences de conditions de vie entre tel village juif et tel village arabe. J’étais prêt inconsciemment à faire une exception politique et à me dire: peut-être que, après Auschwitz, il faut un État juif. Mais ce que j’ai vu c’est que la contradiction était insurmontable et que la conséquence logique de tout État est d’opprimer.
«D’un autre côté, je n’ai jamais été un héraut de la cause palestinienne. Ce n’est pas mon rôle de parler pour les Palestiniens. Même s’il va de soi que je défends leur droit à une identité nationale. […] J’ai d’énormes difficultés à discuter avec les mouvements palestiniens, parce qu’ils me considèrent effectivement comme un “Juif opportuniste”.»
On constate une évolution mieux marquée chez le militant maoïste Alain Geismar qui, en 1972, comparait les sionistes aux nazis113. Six ans plus tard, il se livrait à une sorte d’examen de conscience114 au cours duquel il évoquait ses activités en faveur de l’O.L.P. Elles lui valurent d’être célébré par ses camarades comme «un autre Arafat — ça faisait partie des cingleries de l’époque…». Le terrorisme aveugle finit par le dégriser:
«Là où on a vu que ça débloquait, c’est avec l’histoire des jeux Olympiques de Munich. Il est apparu alors en clair, dans la pratique, que tout Israélien, de Golda Meir au dernier des coureurs à pied ou des cireurs de chaussures d’une équipe israélienne, était bon à exécuter. Ça a entraîné une remise en cause profonde et foutu le bordel dans nos rapports avec nos copains arabes… Comme un signal d’alarme: “Jusqu’à quand va-t-on couvrir n’importe quoi? ” Et quand il se passe ce genre de phénomènes, ça oblige à regarder le monde un peu différemment. Donc ce fut important. À Munich, ils auraient liquidé un officier supérieur israélien, ça ne nous aurait certainement pas choqués.»
Alain Geismar n’était pas devenu un partisan de l’État juif pour autant. Ni pro-israélien, ni pro-palestinien, il s’interrogeait. L’O.L.P. représentait-elle authentiquement les Palestiniens? Il en doutait, dès 1978: «J’ai rarement vu un mouvement accumuler autant d’échecs dramatiques et massacres sur le dos de sa propre population en si peu d’années. Et pourtant, “heureusement que ça existe, l’O.L.P., il y a un interlocuteur et tôt ou tard, il faudra en passer par là”.» Il n’en détestait pas moins les pratiques meurtrières de celle-ci, dans lesquelles il voyait la marque éclatante du racisme. .
Conclusion
Dès 1980-1981, des auteurs, qui n’étaient pas tous juifs, sonnaient l’alarme, des deux côtés de l’Atlantique; constatant les effets des condamnations internationales d’Israël, ils parlaient de «délégitimisation» de l’État juif115. En France, Alain Finkielkraut jugeait en moraliste:
«Au lieu d’exister pour son propre compte, le conflit israélo-palestinien est pris dans un mécanisme de résurrection et de déguisement, qui le situe au niveau de la grande tragédie hitlérienne. Qu’importent les caractéristiques de l’occupation israélienne, ses audaces et ses reculs, ses oscillations entre phase répressive et phase libérale, le nom dont on le baptise convertit le présent en passé et l’histoire en mythologie… La cause palestinienne s’arroge les deux prestiges de la Résistance (puisqu’elle combat l’Occupation) et de l’Étoile jaune (puisque les Palestiniens sont les Juifs d’Israël), tandis que l’État hébreu, dans son arrogance et sa férocité, ressuscite le mal absolu qu’était le nazisme116.»
La «Commission du bilan», instituée en mai 1981 par le nouveau gouvernement socialiste, faisait une remarque qui, sans se référer à l’histoire, allait dans le même sens, lorsqu’elle constatait l’apparition «d’un antisémitisme plus moderne qui est la conséquence de l’antisionisme», et qui «risque d’alimenter l’antisémitisme auprès d’une opinion publique portée à confondre Israéliens et Juifs 117». Cette recrudescence ressortait également d’une enquête psychosociologique réalisée par la S.O.F.C.O.118 au cours de l’année 1981. En ce qui concerne Israël, l’enquête soulignait la persistance de l’antique ambivalence: tout en faisant surgir l’image nouvelle du Juif pionnier, défricheur de déserts et combattant, l’État juif suscitait des interrogations nouvelles, compte tenu de la contestation palestinienne, portant en germe des menaces de destruction. Comme le faisaient observer certains interviewés:
«est-ce un hasard si tous les voisins d’Israël lui sont hostiles? N’est-ce pas la continuation de l’histoire des Juifs? N’est-ce pas une preuve de la malédiction qui pèse sur ce peuple?».
Parallèlement, en France même, «on a l’impression qu’après une nette régression depuis la guerre, on assiste depuis deux, trois ans à une certaine recrudescence de l’antisémitisme… Ce sujet tabou que tout le monde cherchait à éviter refait surface. En cela, l’impression de nos interviewés rejoint la constatation faite par ailleurs quant à la levée des censures chez les jeunes qui reprennent à leur compte les stéréotypes de leurs aînés avec, en moins, la culpabilité de ces derniers».
En conclusion, «la plupart des interviewés s’accordent à considérer que le climat en France évolue dans le sens défavorable et qu’il convient d’être très prudent, de ne pas provoquer, de ne pas réveiller et raviver les passions latentes. Le rôle des médias leur semble tout à fait capital: moins on parle des Juifs, et mieux cela vaut pour tout le monde.»
Or, il se trouva qu’en été 1982, la guerre du Liban fit passer Israël et plus généralement les Juifs au premier plan de l’actualité. C’est dans ces conditions que l’invasion israélienne fournit aux médias la possibilité de déchaîner des passions jusque-là tenues en laisse, ou simplement inexistantes. Ils s’y employèrent de la manière qu’on sait. C’est dans ces conditions qu’un climat s’établit en premier lieu dans les sphères gouvernementales, auquel le président Mitterrand paraissait pour sa part échapper, mais qui poussait M. Pierre Mauroy à déclarer, dès le 18 juin 1982: «Ce n’est pas en détruisant le peuple palestinien qu’on réduira le terrorisme.119»
Le principal responsable de cette désinformation fut la télévision française, par laquelle il faut bien commencer120. Quand les passions se calmèrent, M. Jacques Amalric émit l’idée que sa partialité et son pouvoir mobilisateur étaient dus à des causes essentiellement techniques: «Les guerres et les répressions “en direct” font recette; les crimes à huis clos restent ignorés», et c’est pourquoi personne ne se souvenait de ceux du président Assad à Hama, où 10 000 à 20 000 personnes avaient été assassinées; «il n’existe pas une seule photographie de ces atrocités» (Le Monde, 5-1-83). Sur le vif, Pierre Mendès France avait porté un jugement plus sévère qui touchait au fond du problème. Après avoir dûment critiqué l’entreprise israélienne, il observait:
«Le spectateur qui voit les images projetées est naturellement enclin à penser que c’est toute une nation qui est écrasée sous les bombes… On parle de Juifs tueurs d’enfants, de génocide, d’holocauste. Et là, la presse s’est laissé entraîner, peut-être par goût du sensationnel; de là, des mots et des images-chocs, comme si c’était l’objectif même du gouvernement israélien de massacrer délibérément des civils et des enfants…» (Nouvel Observateur, 14/20-8-82).
La partialité de la presse parisienne ressort d’un bilan établi par la Revue d’études palestiniennes (no 5, automne 1982), où il apparaît que sur 107 personnalités interviewées, 26 représentaient l’O.L.P., et 6 seulement Israël; les autres, quelles que soient leur nationalité ou leurs allégeances, plaidaient dans leur majorité, elles aussi, la cause de l’O.L.P. Mais la presse de toutes tendances (à l’exception des organes communistes) faisait état de phénomènes que la TV laissait dans l’ombre, pour spectaculaires qu’ils fussent; ainsi, l’enthousiasme des populations libanaises lors de l’avance des troupes israéliennes fut mentionné par Le Monde (16-6-82 et 20/ 21-6-82). La télévision réalisait même des «anti-scoops», en n’empruntant pas aux chaînes étrangères des informations sensationnelles121: ainsi la remarquable interview donnée le 26 juin par un membre du Congrès des États-Unis, le démocrate Charles Wilson, à la radio israélienne. Après avoir parlé de la joie de la population libanaise, qu’il avait pu constater de visu, il ajoutait: «Curieux; il est certain que l’invasion fut une bonne chose pour le Liban. Mais c’est l’histoire qui décidera si elle est bonne ou non pour Israël.» Les Français n’eurent pas l’occasion de prendre connaissance de ce pronostic, qui trouva une large audience aux États-Unis. Mieux encore: le 27 juin, Bechir Gemayel fut interviewé par une chaîne de télé-vision américaine. Il parla de ses espoirs pour le Liban, où chrétiens et musulmans pourraient désormais vivre en paix, et il relata un entretien téléphonique qu’il venait d’avoir avec M. Yasser Arafat:
«Je lui dis qu’il en avait déjà trop fait… Et qu’il n’arriverait pas à faire aux Israéliens ce qu’il avait fait à l’armée libanaise et à l’armée syrienne. Il devait le comprendre, et mettre fin à son cirque à Beyrouth-Ouest, pour sauver des dizaines de milliers de Libanais qui pourraient être tués s’il continuait ses singeries, si avec ses amis il allait tenter de transformer Beyrouth en Stalingrad. Qu’il fasse un Stalingrad dans son propre village, dans son propre pays. Mais pas à Beyrouth. Il me répondit que le moment n’était pas propice pour parler de ces choses au téléphone.»
Pourquoi cet entretien entre les deux ennemis jurés n’intéressait-il pas la télévision française? Parce qu’il était relaté par un chrétien?
Le véritable procès de cette politique fut fait par quelques journaux de province. Citons Le Méridional de Marseille (18-8-82): «Depuis deux mois, la télévision française n’a pas cessé de nous montrer des images de désolation, de bombardement, de victimes dues aux seuls Israéliens avec des commentaires, où les mots d’Oradour, de génocide, de liquidation finale étaient couramment employés… Sans que jamais ne nous soient données, en parallèle, quelques images émanant d’une autre origine, faisant voir ce qu’il en était du côté israélien par exemple.» Et s’étant procuré ces images, Le Méridional pouvait décrire la joie des Libanais libérés, ainsi que les ruines laissées par les Palestiniens, ou les gigantesques amoncellements d’armes de toute provenance. Mais surtout, ses rédacteurs purent «entendre les explications de ces terroristes de toutes les nationalités qui combattaient sous le sigle de l’O.L.P. et dont les mobiles sont bien moins respectables que voudraient nous le laisser entendre nos bourreurs de crâne patentés.»
En ce qui concerne la presse écrite, si les journaux indépendants de Paris ou de province faisaient de louables efforts pour présenter les deux sons de cloche, la majeure partie de la presse pro-gouvernementale menait une campagne anti-israélienne à l’unisson de la télévision, contribuant à créer l’impression que l’armée juive avait pour mission l’extermination du peuple palestinien. Il s’agissait notamment d’une question de vocabulaire, d’une technique déjà éprouvée qui consistait à comparer, sur divers plans, les Israéliens aux Nazis: Begin et Sharon prenaient la suite de Hitler et Goebbels, les soldats juifs étaient accusés d’enterrer leurs victimes au bulldozer, à l’exemple des SS, et Beyrouth-Ouest était comparé à Oradour, à Stalingrad, ou, mieux encore, au ghetto de Varsovie.
Il va de soi que les Juifs français se trouvaient concernés au premier chef par les passions ainsi déchaînées, d’autant qu’ils se trouvaient eux aussi mis en cause, au point que le 25 juin, un journaliste de la télévision, chargé d’interviewer le Grand Rabbin de France, lui reprochait d’approuver le massacre des femmes et des enfants palestiniens (25-6-1982). En réalité, les réactions juives étaient variées au possible. En effet, tandis que les organisations juives constituées, tel le Consistoire qui ne groupait qu’une minorité de Juifs, se solidarisaient avec Israël, une autre minorité, appartenant aux milieux universitaires ou littéraires, publiait des manifestes en sens contraire, pour se dissocier publiquement, en des termes plus ou moins mesurés, de l’initiative du gouvernement israélien. Mais les initiateurs de ces déclarations jetaient souvent de l’huile sur le feu, en publiant, sous leur signature personnelle, des attaques d’une extrême virulence. L’acharnement de certains de ces auteurs n’avait souvent d’égal que leur ignorance. C’est ainsi qu’un écrivain autrichien de souche juive, Günther Anders, allait jusqu’à écrire: «Ce qu’a fait Begin et, à vous fendre le cœur, le peuple israélien (qui lui obéit aussi aveuglément que le faisait le peuple allemand lorsqu’il extermina six millions d’entre nous) — ce qu’a fait Begin… m’a conduit, moi qui hais la haine de soi-même, à rougir d’être juif»» (Die Zeit, 3-8-1982). On allait voir encore mieux en France, notamment dans la page «Idées» du Monde, à laquelle faisait pendant le passionné «Courrier des lecteurs» de Libération. Mais je ne m’arrêterai pas sur ces professions de foi dont le principal intérêt était peut-être d’être signées par des Juifs, et de laisser entendre de ce fait que les campagnes anti-israéliennes, aussi frénétiques qu’elles puissent être, n’avaient rien de commun avec l’antisémitisme.
Telle était pourtant la conclusion à laquelle aboutissait la majorité des Juifs, ceux qui ne militaient dans aucune organisation ni ne signaient aucun manifeste, mais qui, viscéralement attachés à l’État juif depuis sa naissance, étaient atterrés par la violence des campagnes de dénigrement dont il faisait l’objet. En effet, ni l’invasion de la Tchécoslovaquie, ni la guerre du Vietnam, ni les innombrables massacres entre Arabes dont le Proche-Orient était le théâtre depuis des années, ne suscitaient en France pareille levée de boucliers. Il est vrai que ni l’anti-américanisme ni l’antisoviétisme (sans parler de l’antiarabisme) n’y bénéficiaient d’une aussi puissante coalition d’intérêts ou de passions. Mais le Juif moyen ne s’arrêtait pas à ces «détails»: il constatait simplement qu’à nouveau, dans une affaire où Israël se trouvait impliqué, la vieille règle des deux poids, deux mesures se voyait remise en vigueur, et l’antisémitisme, pour lui, c’était d’abord cela.
Cependant, au fil des semaines, l’émotion générale évoluait en fonction d’événements de tout ordre. C’est ainsi que le 9 août, l’attentat antisémite de la rue des Rosiers, qui fit une demi-douzaine de victimes, vint modérer pour quelques jours la violence des campagnes anti-israéliennes. Cela ne signifiait pas qu’Israël devenait moins coupable parce que des innocents, juifs ou non, avaient été massacrés à Paris, mais pour une fois, les sanglantes images et descriptions quotidiennes plaidaient en sa faveur et non contre lui. En revanche, le 16 septembre, les massacres de Sabra et Chatila décuplèrent l’indignation.
Une vague d’inquiétude se répandit alors à Paris. Dans L’Express, Raymond Aron lançait un cri d’alarme: «J’éprouve le sentiment que l’indignation justifiée est emportée par une vague de haine et de ressentiment qui va frapper, pêle-mêle, Israéliens et Juifs, bourreaux et victimes.» Dans Le Matin de Paris, Guy Claisse faisait le point dans un long article intitulé «Qui en veut aux Juifs». Il y décrivait le courrier et les coups de téléphone que son journal recevait de ses lecteurs juifs depuis le début de la guerre: protestations indignées, accusations «de mener une campagne anti-israélienne, de faire du sensationnel avec des gros titres». Les uns croyaient percevoir l’odeur du pétrole, les autres exhalaient leur ressentiment, face à l’universelle injustice. «Ils exprimaient au minimum de l’amertume, souvent de la colère, de la rage parfois.» Mais depuis les massacres, continuait Guy Claisse, tout cela a changé:
«Ce ne sont plus des récriminations ou des insultes qui nous parviennent. Ce sont des appels au secours. S., magistrat à Créteil, nous implore de peser nos mots et d’y aller doucement sur les manchettes: “Je n’approuve pas Begin, confie-t-il, mais je sens monter autour de moi un climat d’hostilité.” L., membre de la LICRA à Marseille, vieux militant des droits de l’homme, cherche à prendre contact avec notre correspondant. Il redoute des incidents. S., ancienne déportée, a la voix qui tremble: “Si ça continue, dit-elle, on va remettre les Juifs dans les camps.” Impossible de la raisonner […] Tous insistent sur les mots, le choc des mots qui font resurgir les affreux fantômes: bourreaux, nazis, pogromes….
Que leur dire? Ils ne défendent pas Begin, ils craignent de payer pour les erreurs qu’on lui attribue. Ils se sentent tellement destinés à être victimes…».
Et en effet. Ne la tenait-on pas enfin, la preuve du grand crime de sang juif? Dans un lycée parisien, des professeurs communistes organisèrent aussitôt un cours d’antisionisme; les élèves qui tentèrent de protester furent traités de «sales nazis», et un député socialiste dut intervenir pour mettre fin à cette perversion pédagogique122. Dans le genre, les gauchistes de Libération n’en faisaient pas moins: dans son éditorial, Gérard Dupuy comparait successivement les Israéliens aux Nazis, aux racistes sud-africains, aux généraux polonais et, pour finir, il s’en prenait au gouvernement français: «On fait les gros yeux à Jaruzelski et risette à Begin; pourtant, le premier est jusqu’à présent un enfant de chœur comparé au second» (Libération, 20-9-82). Même Le Monde, d’ordinaire si respectueux des choses de l’esprit, publiait le surlendemain un encadré pour le moins ambigu à propos des psaumes récités dans les synagogues pour implorer la protection divine (titre: Prière du soir dans une synagogue parisienne — «Contre Ton peuple ils ourdissent des complots» — 22-9-82).
Quant aux indignations de la télévision… S’acheminait-on effectivement vers un pogrome, à Paris? C’est d’Israël que vint alors le remède: les médias locaux eurent vite fait d’établir que le général Sharon avait chargé ses alliés libanais de nettoyer les camps de Chatila et Sabra des terroristes qui s’y cachaient encore, et que cette opération dégénéra en massacre, qui n’épargna ni les femmes ni les enfants. Un flot d’horreur se répandit alors à travers le pays tout entier, au point de contraindre Begin à instituer une commission d’enquête («la commission Kahane»); ses conclusions, rendues publiques en février 1983, n’étaient tendres ni pour les généraux responsables ni pour Menahem Begin lui-même. Le Monde fut alors le premier à rendre les armes à l’État juif, parlant d’«un exemple de vie démocratique qui n’a pas de précédent» (L’honneur d’Israël, 11-2-83); Le Nouvel Observateur, lui, écrivait que de l’avis des Arabes eux-mêmes, «le peuple qui a eu, ainsi, le courage de se juger lui-même est digne d’avoir un État, de le garder, de le défendre» (11/17-2-83).
Malheureusement, l’affaire n’était pas réglée pour autant. Le journaliste Kapeliouk, qui avait publié, dès novembre 1982, sa propre enquête, s’employa à critiquer le rapport officiel; en juin 1983, il publiait, en première page du Monde Diplomatique, un article sur les «insuffisances de l’enquête israélienne sur les massacres de Sabra et Chatila». D’autres journalistes lui firent écho, et la campagne rebondit, compliquée par la publication, le même mois, d’une enquête du gouvernement libanais, qui faisait état d’une bataille dans le camp de Chatila entre Libanais et Palestiniens, et assurait que les pertes civiles s’élevaient à vingt enfants et dix-neuf femmes123. Sans doute la vérité pleine et entière sur cette tragique affaire ne sera-t-elle jamais connue. Mais comme on le voit, un an après les événements, elle continue à ternir l’image d’Israël.
Plus caractéristique encore, en raison de ses lointains soubassements historiques, est l’affaire des «empoisonnements de Cisjordanie». Elle éclata en avril 1983, c’est-à-dire, et conformément aux précédents médiévaux, aux alentours de la fête de Pâques: des centaines de jeunes femmes arabes furent alors prises de nausées et se firent hospitaliser. Yasser Arafat s’empressa de déclarer qu’elles avaient été stérilisées, et une fois de plus, les télévisions du monde entier eurent l’occasion d’entretenir leurs publics des férocités de l’occupation juive. Des enquêtes médicales s’ensuivirent, celle du gouvernement israélien, celle de la Croix-Rouge internationale, celle de l’Organisation mondiale de la Santé; toutes conclurent à l’absurdité de la thèse de l’empoisonnement. S’agissait-il d’une panique collective, de phénomènes psycho-somatiques, ou d’une mystification pure et simple, nul ne saurait le dire, ni faire la part des choses, mais il est évident que le phénomène était unique en son genre; car c’est en vain qu’on en chercherait le pendant sous quelque autre occupation étrangère, qu’elle fût hitlérienne, soviétique, ou plus simplement «colonialiste». Sans doute n’y verra-t-on jamais clair, et pour cause: le thème de l’empoisonnement criminel fut discuté en France et à travers le monde pendant une dizaine de jours; mais lorsque son inanité fut définitivement établie, il ne se trouva plus personne pour y attacher le moindre intérêt. Même la littérature anti-israélienne qui depuis l’automne 1982 a commencé à faire florès évite de mentionner ce sujet: elle préfère évoquer des menaces plus sérieuses, du moins dans la perspective du XXe siècle finissant: on peut citer Bernard Granotier, Israël, cause de la Troisième Guerre mondiale?, et encore mieux Roger Garaudy, L’affaire Israël: le sionisme politique. Ce dernier auteur insiste tout particulièrement sur l’identité entre le sionisme et le nazisme, qui ne diffèrent que dans la mesure où le sionisme, au-delà du mythe de la race, se prévaut du «mythe pseudo-biblique de la promesse, interprété dans un sens purement tribal non plus spirituel (le Royaume messianique de Dieu), mais matérialiste et territorial (la Terre)» (p. 155). À part quoi, M. Garaudy critiquait le mythe du peuple élu conformément aux canons de la propagande soviétique, et rejoignait par là les grands thèmes antijuifs des Lumières, ceux d’un Voltaire ou d’un Holbach. Sur les ondes, on pouvait parfois entendre mieux, et c’est ainsi qu’un imam chi'ite, interrogé le 1er juin 1983 par un journaliste de «France-Culture», révélait que les Israéliens avaient tué le Christ, et mettait en garde aussi bien les chrétiens que les druzes contre leurs penchants homicides124. Et c’est ainsi qu’à Paris comme en Cisjordanie, la propagande anti-israélienne finissait par renouer avec les thèmes millénaires de l’antisémitisme chrétien.
* *
*
Dès l’avant-propos de ce livre, j’insistais sur le fait que les passions déchaînées en été 1982 par la guerre du Liban ne pouvaient en aucun cas être réduites à une explosion d’antisémitisme. Par la suite, j’ai décrit les formes nouvelles que celui-ci a revêtu depuis 1948 dans les pays socialistes et dans les pays musulmans, et traité d’autre part l’évolution des mentalités, au fil des générations, en Occident même, sans prétendre pour autant qu’il y ait eu une relation étroite entre ces deux séries de phénomènes. Peut-être serait-il bon d’ajouter que le terme d’antisémitisme ne peut s’appliquer qu’au prix d’un abus de langage au climat occidental de 1982, qui fait plutôt songer à la tradition du Moyen Age, lorsque le Juif n’était persécuté qu’en raison de ses croyances ou de ses idées, et qu’il était accepté à bras ouverts par la société dominante, à condition d’en changer. Il en alla de même en été 1982, lors des campagnes anti-israéliennes, et nous avons vu le rôle que jouèrent certains Juifs éminents qu’il serait absurde de qualifier d’antisémites dans les polémiques.
Cela dit, essayons de comprendre ce qui est réellement arrivé en été 1982. Rappelons-nous d’abord comment, en conséquence des obsessions homicides du IIIe Reich, les représentations de «Nazi» et «Juif» se trouvèrent associées par contraste, comme le sont à l’ordinaire des notions radicalement opposées, telles que «bourreau» et «victime». Dans le cas des Juifs, une association identique s’était produite dès les premiers siècles chrétiens, à ceci près que, conformément au récit de la Passion, ils figuraient les bourreaux de l’homme-dieu des chrétiens. Plutôt qu’une association inédite, il y eut donc, après l’atroce entreprise hitlérienne, une inversion du signe de valeur. Ajoutons qu’en cherchant à sonder plus profondément la relation entre les Juifs et les nations, en examinant notamment ce qu’elle fut avant l’ère chrétienne, dans l’antiquité classique, on est tenté de conclure qu’une certaine fascination exercée par la singularité du judaïsme fut le phénomène primaire, et le signe de valeur, négatif ou positif, le phénomène secondaire… Mais laissons là cette spéculation, et revenons à l’ère post-hitlérienne.
La nouvelle signification positive du Juif se précisa au lendemain de la débâcle nazie; j’ai décrit au début de ce livre comment au cours d’une première période, qui dura approximativement de 1945 à 1967, les Juifs symbolisèrent en Occident, et plus particulièrement en France, les victimes, l’innocence outragée, et les Nazis, les bourreaux, tandis que l’ensemble des populations européennes (les ex-«Aryens») faisaient facilement — et bien injustement — figure de complices. Il n’était que trop naturel que ce partage, soutenu par une sévère censure sociale, suscitât les oppositions et les rébellions qui sont l’inévitable revers des tabous. Une première explosion s’ensuivit en 1967-1968, et elle prit pour principale cible, à la faveur d’une certaine conjoncture politico-économique, l’État juif, qui de son côté s’était constitué en successeur du judaïsme exterminé, et manifestait la tendance d’attribuer à l’antisémitisme toutes les critiques dont il pouvait faire l’objet. Nous avons vu comment ces critiques, les propagandes soviétique et arabe aidant, aboutirent à un torrent de calomnies et de haine, à l’échelle mondiale, au point de reléguer au cours des années 1970 cet État à l’amère condition de «Juif des nations». Vue dans cette perspective, l’explosion anti-israélienne de l’été 1982 ne constituait-elle pas une nouvelle explosion «libératrice», poussée à l’extrême? Et cette protestation ne serait-elle pas à l’origine des outrances verbales des médias, du recours à des termes provocants tels que «nazisme», «génocide» ou «solution finale»?
Dès juin 1982, Jean-Paul Franceschini, dans Le Monde, faisait valoir que ces accusations insensées ne pouvaient que justifier les «extravagances pseudo-bibliques» de M. Begin. «Puisque Israël existe, écrivait-il, et qu’il a droit à des “frontières sûres et reconnues”, pourquoi l’ancrer par la démesure du réquisitoire dans la position redoutable d’un État hors la loi et d’un interlocuteur hors du langage?» C’était aussi faire le jeu des extrémistes du camp opposé, qui prétendaient à une position symétrique: «Les Palestiniens se voient renvoyer par certains de leurs amis trop zélés l’image de survivants de l’Holocauste et de damnés du jugement.» À ce propos, M. Franceschini mettait aussi en cause la «langue de bois» soviétique, avec ses monstrueux superlatifs, mais il ne se demandait pas comment elle en était venue à faire tache d’huile, dans les médias occidentaux125.
En janvier 1983, Alain Finkielkraut abordait ces questions par un autre biais:
«Dans l’emploi systématique de termes comme “holocauste” ou “génocide”, écrivait-il, on a pu déceler comme une jubilation de l’Europe à l’idée d’en finir une fois pour toutes avec sa mauvaise conscience. Destitués à jamais de leurs anciens privilèges moraux, les Juifs rentrèrent dans le rang… ils rejoignirent la catégorie nombreuse et sans prestige de l’homme tel qu’il est: Abel devenait Caïn, Caïn pouvait à nouveau dormir sur ses deux oreilles; l’Europe découvrait avec bonheur qu’elle n’était plus en dette. Les bombes de Beyrouth annulaient son remords. Elle renouait avec la saveur de l’innocence, maintenant que les Juifs étaient aussi coupables126.»
On retrouvait une interprétation analogue chez des auteurs américains, confrontés eux aussi au problème des passions démesurées investies dans la critique d’Israël. Un commentateur juif, Jérôme Benveniste, rappelait qu’aux yeux de l’Occident, la création de l’État juif représentait une réparation due aux victimes du génocide, et qu’en conséquence, le respect dû à leur mémoire imposait un frein, qui d’ailleurs allait s’affaiblissant, aux attaques anti-israéliennes. La guerre de 1982 aurait suscité une coupure définitive: «Pendant cette guerre, tous ceux qui avaient des griefs à l’encontre d’Israël purent se dire qu’il était temps de s’affranchir des censures imposées par l’holocauste; or, cela ne se laissait faire qu’en rendant Israël coupable d’un crime aussi vaste que celui auquel il devait sa naissance.» Plus intéressant encore était le commentaire de Théodore Oison, directeur d’un journal canadien, qui ne se référait pas aux polémiques des médias, mais au courrier qu’il recevait de ses lecteurs, soulagés de pouvoir enfin critiquer Israël en toute liberté. Mais pourquoi ce faisant tendaient-ils eux aussi à comparer Begin à Hitler, le «Tsahal» à la «Wehrmacht»? Précisément en raison du vieux tabou:
«Puisque les péchés des Nazis continuaient à servir de justification à tous les expédients de la politique israélienne (et cela a été fait trop souvent par des apologètes mal avisés), nous ne devons pas nous étonner si certains s’emploient à retourner l’argument, lorsque la conduite israélienne entre en résonance, même lointaine, avec les justifications dont se servait Hitler. Les prétentions moralisatrices du gouvernement Begin ont fourni une telle occasion, aussi bien à des antisémites de mauvaise foi qu’à des gens simplement fatigués d’avoir été trop souvent contraints de défendre Israël. La réaction de ces derniers n’est nullement un symptôme de la partialité ou de la décadence de l’Occident, elle est simplement la réaction de gens qui tiennent à être moralement égaux (mais non inférieurs) aux Israéliens127.»
On relevait des accents analogues dans les réponses à une enquête internationale proposée en octobre 1982 par l’Institute of Jewish Affairs de Londres sur l’antisémitisme contemporain. Je citerai d’abord des extraits de la réponse de Sir Immanuel Jakobovits, le «Chief Rabbi» de Grande-Bretagne, qui tenait à déclarer: «Pour ma part, j’accepte qu’on exige davantage des Juifs. Si cela veut dire qu’on attend de nous une moralité plus haute que celle des autres, j’y perçois un compliment reflétant, à travers l’héritage biblique, le respect pour le rôle pionnier d’Israël en matière d’éthique.» Sur le fond du problème, il s’exprimait notamment comme suit:
«Les causes de l’antagonisme envers Israël sont nombreuses et complexes. Parmi ses facteurs, il faut tenir compte des intérêts investis dans les relations avec les pays arabes; des hésitations résiduelles chrétiennes à accepter la restauration de la souveraineté juive sur Sion; des authentiques sympathies pour les souffrances des réfugiés arabes, et des attitudes intraitables qui ne sont pas rares chez certains dirigeants et porte-parole d’Israël128.»
Ainsi donc, il refusait d’expliquer par le seul antisémitisme les campagnes anti-israéliennes, et la majorité des autres participants, dont certains n’hésitaient pas à critiquer Israël, s’exprimaient de façon très proche. Citons le célèbre commentateur irlandais Conor Cruise O'Brien, qui répondait qu’en Occident, l’antisémitisme ne lui semblait pas menaçant, et que le phénomène caractéristique n’était pas sa recrudescence, mais un affaiblissement des tabous qui l’entouraient depuis l’ère hitlérienne129. Pour ma part, je penchais évidemment dans le même sens130 (tout en décochant au passage une flèche à la «Realpolitik» de Begin et Sharon). Si les multiples interprétations de cet ordre sont les bonnes, il n’est pas démontré qu’il s’agisse d’un phénomène uniquement négatif. En cet été 1983, il est difficile d’en dire davantage, sinon que la prudence recommande de suspendre tout jugement, puisque cette question elle aussi se rattache au fond du problème, c’est-à-dire à un règlement juste et durable du conflit du Proche-Orient. La manière dont il évolue sous nos yeux ne semble guère promettre une solution rapide…
Entre-temps, ces thèmes ont cessé, sauf éruptions occasionnelles, de figurer au premier plan de l’actualité et de passionner le public occidental. Rien de plus édifiant à cet égard que le contraste entre les hommages éclatants dont Yasser Arafat fut l’objet, après avoir quitté le Liban sous la pression israélienne, et la relative indifférence avec laquelle le monde assista à son expulsion, lorsqu’elle fut décidée plusieurs mois plus tard par le gouvernement syrien.
Ce contraste suggère une dernière morale, ou «leçon de l’histoire»; de tout temps, les Juifs ont servi de thème privilégié aux imaginations. Aucun autre groupe humain ne fut entouré, tout au long de son histoire, d’un tel tissu de légendes et superstitions: crimes de sang — à commencer par le déicide —, meurtres rituels, empoisonnement de puits, propagation d’épidémies, d’une part; malformations physiques, maladies mystérieuses, odeur pestilentielle, d’autre part; nombre de ces fantasmes médiévaux se sont intégrés, au XIXe siècle, au corpus de la science, sans attendre les campagnes antisémites131. Ces dernières, à leur tour, furent centrées sur les propriétés particulières du sang juif. Or, à y regarder de plus près, les croyances de cet ordre n’ont pas entièrement disparu. Il en subsiste notamment une tendance à attribuer une ascendance juive à des hommes illustres, erreur qui n’est pas nécessairement malveillante; c’est ainsi qu’on a prêté cette origine non seulement à Adolf Hitler, à Iouri Andropov ou à la mère de Lénine, mais aussi à Max Weber et aux frères Mann, ainsi qu’à Kant, Mozart et même à l’empereur Napoléon. Cette erreur est toujours à sens unique, et la règle ne souffre qu’une seule exception: le commun des chrétiens a obstinément ignoré, et certains continuent de le faire, que Jésus, sa famille et ses apôtres furent eux-mêmes des Juifs, des «fils de l’Alliance». On croit pouvoir affirmer qu’il s’agit en l’occurrence de la désinformation la plus grandiose de l’histoire occidentale et qu’elle contenait en germe toutes celles que nous avons ici passées en revue. .
Annexe
Le cas allemand
par le pasteur Rudolf PFISTERER
Dr h.c. de la Faculté de théologie protestante de Paris
«Victoire — nous le pouvons à nouveau!» «Nous pouvons à nouveau injurier les Juifs. Du moins ceux que nous avons laissés en vie. Aujourd’hui, on les appelle Israéliens. Désormais, nous ne sommes plus coupables, puisque, conformément à l’antique usage, les Juifs le sont. Nous aurions commis un holocauste? Exterminé 6, 5, 4 millions de Juifs? Oubliez-le. Voyez ce que les Juifs font à l’O.L.P.; ça, c’est un holocauste. La destruction du ghetto de Varsovie fut une atrocité? Soit. Ce que les Israéliens font aujourd’hui à Beyrouth-Ouest est exactement la même chose132.»
Ces propos sarcastiques ont été tenus par le président de l’association des écrivains allemands, Bernt Engelmann; mais c’est très sérieusement qu’il réclamait le boycottage d’Israël.
Faut-il s’étonner si dans un tel climat on entendit à nouveau les cris: Sortez les Juifs! À bas les Juifs! Mais cette fois-ci l’attaque ne vint pas des néo-nazis. C’étaient des étudiants de gauche qui manifestaient et collaient des affiches où ils protestaient contre «la solution finale de la question palestinienne». La censure ne fonctionnait plus, les langues s’étaient déliées, et à nouveau on pouvait clamer: C’est la faute aux Juifs! Comme l’écrivait un journal allemand, ils étaient «l’ennemi mondial».
À ce propos, deux aspects sont à prendre en considération. D’abord, l’impudence générale: dans tous les milieux, le monde politique et même les Églises, on entendait des propos de ce genre. Ensuite, leur spontanéité. Dans le IIIe Reich, la haine contre les Juifs était excitée par une propagande incessante et omniprésente. Aujourd’hui, cette hostilité se manifeste en l’absence de toute pression extérieure.
On peut s’interroger sur les origines de ce phénomène. L’explication la plus courante est donnée par un journal de Stuttgart: «Il faut prendre acte de ce que le gouvernement Begin suscite l’antisémitisme à travers le monde entier.133»Voici donc revenus les temps où les Juifs étaient accusés de susciter eux-mêmes l’antisémitisme. Cette explication, historiquement fausse, est particulièrement inepte dans le cas du conflit du Liban. Car ce sont les mass media qui, par un éclairage tendancieux, voire de fausses nouvelles, accusent depuis des années Israël d’être le grand fauteur de troubles, au Proche-Orient. Cette désinformation est présentée comme une critique constructive et prétend se mettre au service de la solidarité humaine et de la défense des droits de l’homme.
Mais il ne s’agit plus de critique, lorsque les thèses ainsi développées reposent sur des mensonges purs et simples. Cela se manifeste notamment par des attaques contre l’Ancien Testament qui, d’après une superstition séculaire, serait caractérisé par sa cruauté et son inspiration vengeresse. Dans une lettre publiée par le journal Die Zeit, cette croyance est exprimée comme suit:
«Ce qui est fatal dans l’évolution actuelle, c’est que la prétention vétéro-testamentaire à l’élection divine est reflétée par une politique concrète: l’Ancien Testament devient le livre de bord d’un expansionnisme militaire constitué en théocratie, de sorte que la comparaison avec “la providence” et “la race supérieure” nazies s’impose d’elle-même134.»
Il importe donc de rétablir la vérité. Je m’arrêterai à cette fin sur quatre points:
L’incroyable partialité
Dès le 20 juin 1981, les résolutions de L’Alliance judéo-chrétienne de Hambourg signalaient les symptômes d’un nouvel antisémitisme, caractérisé par une condamnation unilatérale. On pouvait y lire:
«Il s’agit d’antisémitisme, lorsque la politique israélienne est jugée sans tenir compte de la situation particulière de l’État d’Israël: un petit État, depuis trente ans en guerre, entouré d’ennemis qui lui refusent la reconnaissance et la paix; un État dont la population ne survivrait pas à une défaite militaire. Il s’agit d’antisémitisme, lorsque les erreurs commises par le gouvernement israélien sont condamnées unilatéralement, sans tenir compte des agissements des ennemis d’Israël, et qu’elles le sont d’une façon plus sévère que les erreurs commises par d’autres gouvernements135.»
Les journalistes occidentaux n’ont pas toujours le courage de rendre impartialement compte des événements libanais, parce qu’ils sont soumis à des menaces. Certains ont déclaré à un journaliste de Jérusalem:
«Il vous est facile de parler. Vous vivez en Israël dans une sécurité relative. Par contre, nous sommes exposés à la pression des cellules terroristes de l’O.L.P. Comme vous le savez, rien qu’en 1981, neuf journalistes hostiles à l’O.L.P. ont été assassinés; croyez-vous que nous devons mettre en jeu nos vies au nom d’une information impartiale136?»
Au surplus, il n’est pas facile de rompre le cercle de la désinformation, étant donné le climat mental qui règne actuellement en Allemagne. Un journaliste de la radio allemande a dit au journaliste allemand susmentionné:
«Ce que vous nous dites ne nous est pas inconnu. Mais nous ne pouvons pas le publier en République fédérale allemande, car l’opinion, notamment celle de gauche, n’en veut pas. Nous avons les mains liées137.»
On a trouvé, à Saïda, un document de l’O.L.P. dont voici la teneur:
«Toutes les bases doivent être installées dans le centre de la ville ou dans des camps de réfugiés, car la population civile constitue une protection idéale contre l’ennemi sioniste138.»
Pourquoi cette cause majeure de dévastations et de pertes dans la population civile n’a-t-elle presque jamais été mentionnée dans la presse? Pourquoi ces procédés de l’O.L.P., consistant à faire protéger les combattants par des femmes et des enfants, n’ont-ils pas été dénoncés?
Arrêtons-nous, par exemple, sur le cas de la ville chrétienne de Damour, devenue un champ de ruines. «Damour a dû être un enfer», écrit un journal de Stuttgart139. Pourquoi ne dit-on pas que cet «enfer» remonte à 1976, lorsque l’O.L.P. a expulsé ou massacré la population de Damour140?
L’avalanche de fausses nouvelles
L’une des raisons des innombrables déformations et erreurs des mass media est le mensonge capital qui assimile l’O.L.P. aux Palestiniens, une organisation qui, pour parvenir à ses fins, utilise la violence et la terreur, à un peuple qui veut retrouver ses droits et aspire à être reconnu. En conséquence:
Le nombre de victimes de cette guerre a été prodigieusement exagéré, et donc faussé. Le plus souvent, les données provenaient des milieux de l’O.L.P., ce qui était une première raison pour les accepter sans critique. Des extrémistes de gauche publièrent dans le Tageszeitung un manifeste suivant lequel les Israéliens auraient tué au Liban 50 000 êtres humains et en auraient blessé au moins 100 000, dont 70 % étaient des femmes et des enfants. La liste «alternative-verte», qui dispose de 8 sièges au parlement de la ville de Hambourg, diffusait des tracts qui attribuaient à Begin la déclaration selon laquelle chaque Israélien tué serait vengé par l’exécution de 5 Libanais et 10 Palestiniens141. Ces données datent de la fin du mois de juin. Le chancelier autrichien Bruno Kreisky parlait lui aussi de 10 000 morts, 40 000 blessés et 600 000 réfugiés142. Il eût été à l’honneur des hommes politiques de ne pas se fier à des estimations arbitraires, et de tenir compte du résultat des recensements. Mais cela donne un autre tableau, dépourvu de force mobilisatrice. Un seul exemple: l’évêque de Tyr, à l’époque, parlait d’une cinquantaine d’inhumations, dans sa ville, ce qui correspond aux données officielles, qui indiquent 56 à 63 tués à Tyr. À Saïda, il fut d’abord question de 1 500 tués; on apprit par la suite qu’il ne s’agissait que de 100. Les médias internationaux avaient parlé de 15 000 tués, surtout à Tyr et à Saïda143.
Des exagérations semblables ont suivi les bombardements de Beyrouth. Au cours de celui du 12 août, qui dura onze heures, 44 000 bombes auraient été lancées sur la ville144. À ce propos, un officier américain, le lieutenant Dupuy, fait remarquer:
«Supposons que je ne sois pas un bon observateur, et qu’au lieu des 150 bombes que j’ai comptées pendant les cinq heures au cours desquelles j’étais sur place, 2 000 aient été lancées. Cela veut dire: 42 000 bombes pendant les six heures restantes; 7 000 par heure ou plus de 100 par minute. Mais aucune aviation au monde ne peut lancer en six heures 42 000 vraies bombes sur un objectif de la taille de Beyrouth. Quant à l’aviation israélienne, elle ne dispose que d’environ 600 avions. À la rigueur, 300 auraient pu être affectés à un tel bombardement, effectuant 3 vols chacun. Cela correspond à 900 missions en tout. En admettant que chaque avion lance 4 bombes par mission, on en arrive à un maximum de 3 600 bombes, autrement dit, à moins d’un dixième de ce qui a été indiqué145.»
II ne s’agit évidemment pas de nier l’horreur du bombardement d’une ville. Mais il faut dénoncer le mensonge d’un bombardement inouï qui aurait transformé Beyrouth en un océan de feu. Ces chiffres fantastiques servent d’armes pour attaquer Israël, et les journaux qui les ont publiés se sont dispensés de toute rectification.
Il en est de même pour le bombardement du Flora, ce navire affrété par la Croix-Rouge allemande. Il fut touché par une fusée, et un jeune marin allemand fut tué. Un frisson d’indignation parcourut la presse allemande; il va de soi que l’attaque fut attribuée à Israël. Le président de la Croix-Rouge allemande parla d’infraction au droit international et à la convention de Genève. Lorsqu’il apparut que le navire avait été touché, à une quinzaine de kilomètres au nord de Beyrouth, par une fusée de l’O.L.P., il n’y eut de rectification ni dans la presse ni à la télévision.
Le grand quotidien Die Zeit contestait purement et simplement qu’Israël fût menacé par ses voisins arabes et par l’O.L.P. «L’O.L.P. ne représente pas un danger réel. Israël devenait une puissance militaire de premier ordre: «Il est insensé de comparer Israël à un David; l’État juif est devenu depuis longtemps un Goliath; il est une grande puissance qui a définitivement renoncé à l’éthique de ses premières années […]. Begin viole les principes de l’humanité et du droit international; il se moque des intérêts de son protecteur, les États-Unis, et n’a d’égards pour personne. En comparaison, le général Galtieri est un agneau innocent. Le Premier ministre d’Israël menace la paix mondiale.» On croit rêver. Israël, avec ses moins de quatre millions d’habitants, serait une grande puissance, face à la centaine de millions d’Arabes qui l’entourent? Israël ne serait pas encerclé et assiégé? Israël est accusé d’inhumanité, parce qu’il prend le risque de rompre le lacet qu’on tente de passer à son cou, avant qu’il soit trop tard. Comment peut-on comparer avec Galtieri, et même donner en exemple cet aventurier argentin?
Mais Die Zeit affirme ne nourrir aucune animosité envers les Juifs, et l’article ci-dessus s’achève sur la phrase hypocrite: «Constater tout cela n’a rien à voir avec l’antisémitisme.146»
Des comparaisons choquantes
Le comble du scandale est atteint lorsque l’entreprise israélienne au Liban est comparée à la «solution finale» nazie. Ces comparaisons sont blessantes non seulement parce qu’elles sont injustifiables, mais aussi parce qu’elles rouvrent des plaies qui ne sont pas encore complètement cicatrisées.
Or, les organes allemands les plus influents s’y livrèrent. Rudolf Augstein, le directeur du Spiegel, était laconique: «Tout comme les Juifs furent jadis les victimes des Nazis allemands, les Arabes sont maintenant les victimes des Juifs.147» Dans le Stern, Heinrich Jaenecke s’y prenait d’une autre manière: «Ce n’était pas une guerre, mais une campagne d’extermination, dans le style des expéditions punitives des puissances coloniales du XIXe siècle.» Suivaient les chiffres truqués habituels; mais surtout, Israël menaçait la paix mondiale, et il incombait à l’Europe occidentale d’agir, pour faire comprendre qu’elle ne tolérerait pas que «sa sécurité et la paix mondiale soient compromises par une poignée de chauvins aveugles et de religieux extravagants». Et H. Jaenecke comparait lui aussi Israël à… l’Argentine148.
Il est de fait qu’on entendait beaucoup parler en Allemagne de «solution finale de la question palestinienne» et de «génocide». L’intention était évidente: tirer un trait sur l’holocauste, puisque «les Juifs n’ont plus le droit de parler de l’holocauste.149» Un groupe qui s’intitule Aktion souhaitait même l’anéantissement d’Israël par une bombe atomique qui serait «le fléau de Dieu» ou «le châtiment de Dieu150». Une variante consistait à comparer les défenseurs palestiniens de Beyrouth, fêtés par toutes les télévisions, et qui purent librement évacuer le Liban, aux combattants du ghetto de Varsovie, voués aux chambres à gaz, et qui se battirent pour ainsi dire les mains nues, parce qu’ils voulaient mourir debout. Il y eut plus: Möllemann, un député du Bundestag, a publiquement réclamé que Menahem Begin soit déféré devant un tribunal international, pour être jugé en qualité de criminel de guerre. «Criminel de guerre», «tribunal international»: l’allusion au tribunal de Nuremberg, devant lequel on fit comparaître les grands criminels de guerre nazis, est évidente. Le peuple juif serait-il donc le seul peuple auquel il soit interdit de se défendre? Reprocher aux Juifs des actes qu’on laisse en toute quiétude commettre à des non-Juifs; deux poids et deux mesures, l’antisémitisme, c’est d’abord cela. Pourquoi une exigence de ce genre n’a-t-elle pas été formulée par Möllemann à l’adresse de Brejnev, lors de l’invasion de l’Afghanistan? Parce qu’il n’est pas Juif?
La haine des Juifs qui s’est manifestée pendant les campagnes de diffamation de l’été 1982 s’exprimait de diverses façons. C’est ainsi qu’une Juive reçut par la poste un jeu de l’oie dans lequel le joueur, pour parvenir au but, devait franchir six camps d’extermination figurés par des étoiles de David: le but, la case finale, portait l’inscription: «chambre à gaz». À propos de toutes ces comparaisons et insinuations, Daniel Cohn-Bendit a dit: «Si on ne sait pas faire en Allemagne la différence entre la guerre du Liban et la guerre hitlérienne, c’est donc que les écluses de l’antisémitisme sont grandes ouvertes.151»
Les Églises
On constate avec étonnement que presque toutes les prises de position des Églises et de nombreux chrétiens à propos de la guerre du Liban témoignent d’une grande incompréhension. Cela n’est pas nouveau. Si, lors des guerres de 1967 et de 1973, lorsque Israël était menacé dans son existence même, les Églises se sont tues, ou se sont contentées de déclarations sans grande signification, on a pu noter, cette fois, une franche agressivité. C’est ainsi que le Conseil œcuménique des Églises de Genève a formulé la condamnation suivante: «Nous condamnons l’invasion par Israël du territoire libanais; nous réprouvons l’appel à la puissance militaire pour la résolution des conflits politiques; nous invitons les Nations-Unies à se consacrer d’urgence à la solution de la question palestinienne.» Cette déclaration parle du «droit à la création d’un État palestinien souverain», ce qui implique, conformément à la terminologie palestinienne, la destruction de l’État d’Israël. Le président du Conseil des Églises évangéliques allemandes, l’évêque Lohse, s’est exprimé de manière semblable. Il ne faut donc pas s’étonner si l’écrivain chrétien Johann Hampe s’est exprimé comme suit, à un débat radiodiffusé:
«Israël est toujours la pupille de l’œil de Dieu, vivant depuis un demi-siècle le dos au mur, ne parvenant pas à oublier l’holocauste et oubliant toute mesure humaine. Il prépare à ses voisins de même souche, Édom, Ammon et la Syrie, un holocauste, il songe à égorger les Palestiniens, héritiers de la Judée et de la Samarie. C’est Israël qui est coupable; qu’il soit accusé devant Dieu152.»
Plus agressif encore est un professeur allemand qui vit à Beyrouth, Ulrich Schoen:
«Des considérations théologiques se présentent à l’esprit, accouplées à une colère à laquelle j’aimerais inclure un peu de colère divine: cette “paix” n’a rien à voir avec la paix des trois religions sœurs islam, christianisme et judaïsme. Toutes trois devraient intenter un procès à l’État d’Israël, pour “vol”, “rapt et viol de mineur”. Car cet État a volé le nom du peuple de Dieu, et il a violé quelque chose de jeune et de tendre: la paix. Et je souhaite que survienne un sous-produit inattendu de cette guerre: la mort pour tout “pro-sionisme” théologique chrétien153.»
Nous voyons ici l’antique antijudaïsme relever la tête, sans la moindre gêne. N’est-ce pas à cette lumière qu’il convient de voir l’audience accordée à Yasser Arafat par le pape Jean-Paul II? N’était-ce pas un affront pour Israël, dont le chef de l’O.L.P. a juré la perte? Et n’était-ce pas, tout autant, un affront pour la population chrétienne du Liban, persécutée depuis des années par l’O.L.P.? Le dialogue judéo-chrétien n’a-t-il pas été compromis, de son côté? Il va de soi qu’il est encore trop tôt pour répondre à toutes ces questions.
Résumé
Quelles conclusions peut-on tirer de la documentation très incomplète réunie ci-dessus?
1o L’antisémitisme n’a pas disparu en République fédérale allemande, il peut se manifester avec une grande intensité, suivant la conjoncture. «La campagne du Liban est une borne milliaire. Une borne de l’antisémitisme allemand. On peut à nouveau être antisémite et on le fait154.» Ce n’est pas seulement le fait de la droite, c’est aussi celui de la gauche. Des hommes politiques comme Bruno Kreisky font preuve de démesure eux aussi:
«Israël s’est mis moralement à nu. Ses dirigeants ont montré leur vrai visage. La guerre du Liban a fait perdre à Israël les sympathies qu’il a recueillies au cours de ces dernières décennies. Le monde redoute la folie de ses dirigeants, qui ne se reposent que sur la force des armes. Je ne veux rien avoir de commun avec cet Israël-là155.»
Un article du grand quotidien Die Zeit adopte le même ton; il est intitulé «La semence sanglante de la vengeance», et on y lit, à propos de l’offensive d’Israël:
«En premier lieu, ce sont des stations sur une voie impériale: l’aiguille du compas de Begin indique le chemin du conflit et de la vengeance, et d’une “paix” arrachée par la force156.» Compte tenu des relations étroites entre l’O.L.P. et les autorités de la République démocratique allemande, il va de soi que cette dernière ajoute sa voix au chœur de la calomnie. Le ministre-président Stoph a déclaré: «Comme le montre la meurtrière campagne d’Israël au Liban, campagne approuvée et directement appuyée par Washington, l’impérialisme suscite des tensions sur tous les continents157.»
Malheureusement, les jeunes jouent un rôle dans ces campagnes. Les Informations évangéliques pour la jeunesse ont écrit à propos des massacres dans les camps de Sabra et Chatila: «À la fin des fins, Israël a réussi à mobiliser le monde entier contre lui… Ces jours-ci, Israël fêtait sa nouvelle année, et il est interdit aux Juifs, sauf menace d’un danger imminent, d’interrompre leur repos pendant cette fête. L’assassinat d’un millier de Palestiniens ne justifiait pas l’interruption.» Remarquons que comme toujours, les chiffres ont été exagérés, puisque le nombre des victimes ne dépassait pas 300 à 400.
2o Un signe particulier du nouvel antisémitisme est le ton pédagogique avec lequel on cherche à ramener le peuple juif prétendument égaré dans le droit chemin. C’est ainsi que le 18 juin 1982 des intellectuels allemands ont publié un manifeste dans le Frankfurter Allgemeine Zeitung et dans le Jerusalem Post, exigeant l’évacuation immédiate du Liban, car «cette action d’Israël a détruit tout espoir de paix dans cette région.158» Le professeur André Néher m’a écrit de Jérusalem, à propos de ce manifeste: «C’est un véritable appel au suicide, lancé avec cynisme par des Allemands!» De son côté, Die Zeit s’est empressé de faire entendre son propre son de cloche: «Il est grandement temps pour la démocratie israélienne de se manifester, et mettre fin rapidement aux égarements de son chef de gouvernement.159»
3o Toutefois, il importe de dire qu’il y eut, par-ci par-là, de courageuses interventions en faveur d’Israël. Parmi ces manifestations de bonne volonté — hélas, elles restèrent minoritaires — je citerai un article d’Axel Springer dans Die Welt (5-9-1983). Il porte le titre évocateur de J’accuse (en français), et on y lit notamment:
«Que l’unique leçon de l’histoire est que l’on ne retient pas ses leçons n’est malheureusement pas le savoir des moqueurs seulement […]. Que diraient par exemple les Allemands si l’O.L.P. était installée non pas au Liban, “la Suisse du Proche-Orient”, mais chez nos bons voisins, dans la véritable Suisse, d’où elle lancerait des fusées sur nos villes et nos villages allemands…»
Axel Springer cite ensuite un article du professeur bordelais Jacques Ellul:
«L’argument qui pour moi reste décisif pour Israël est le suivant: Tous les États arabes peuvent survivre à leurs défaites. Si Israël est vaincu, il disparaît totalement. Les Palestiniens peuvent sans mal être reçus dans les nombreux pays arabes, les Juifs nulle part. Israël est parfaitement encerclé par des puissances ennemies dont aucune n’est vitalement menacée: Israël est vitalement menacé. Israël est le seul État du monde qui se batte vraiment le «dos au mur». Il est le seul […] qui soit en présence d’une question de vie ou de mort totale. Et malgré sa puissance militaire il est le véritable pauvre en face des États arabes160.»
Telle est, à mon sentiment, la pierre de touche, lors de toute prise de position à propos de l’État d’Israël: savoir si on tient compte ou non de sa vulnérabilité et des menaces auxquelles il est exposé. L’ennemi a modifié sa tactique et attaque cette fois en partant de positions de gauche plutôt que de droite. Ce que le grand penseur juif Elie Wiesel écrivait dès 1977 à la jeunesse allemande de gauche est devenu plus actuel que jamais:
«Dans votre emportement puéril, vous vous permettez de vous en prendre au peuple d’Israël. Et là, c’est trop. Nous ne vous avons rien fait, que je sache: nous ne vous avons ni trahis, ni volés, ni maltraités, ni empoisonnés, ni persécutés, ni humiliés. Nous ne vous avons même pas fait de la morale. Pourquoi cette haine à notre endroit? Pourquoi cette passion en vous de nous nuire, de nous blesser? Vous nous traitez d’impérialistes, de colonialistes, de racistes; nous figurons sur toutes vos listes noires. Vos attaques sont dirigées contre nous en premier lieu; dans vos blâmes et dénonciations, nous sommes votre cible préférée. Eh bien, beaucoup d’eau coulera dans le Rhin et dans le Jourdain avant que le peuple d’Israël ait des leçons à recevoir de vous […].
En prenant position contre le peuple juif aujourd’hui vous vous rendez coupables de ce que vos pères lui ont fait subir hier. En combattant les survivants des massacres d’hier vous devenez maintenant complices de vos aînés…
Que vous l’admettiez ou non, dorénavant vous vous définissez comme leurs héritiers, comme leurs disciples et successeurs. Et secrètement, ils doivent bien vous aimer, vous admirer. Ils sont fiers de vous parce que vous l’êtes de vous-mêmes, donc d’eux aussi: voilà leur victoire. Et votre défaite161.»
Propos liminaire
À Moscou, le terme désinformation apparaît dans les outils de travail au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. La Grande encyclopédie soviétique en proposait la définition suivante:
DÉSINFORMATION: Diffusion (par la presse, la radio, etc.) de renseignements mensongers, dans le but d’égarer l’opinion publique. La presse et la radio capitalistes utilisent largement la désinformation, pour tromper les peuples et les accabler de mensonges, en présentant la nouvelle guerre préparée par le bloc impérialiste anglo-américain comme une guerre défensive, et en faisant croire que la politique pacifique de l’U.R.S.S., des pays de démocratie et d’autres pays pacifiques est une politique agressive. (Grande Encyclopédie soviétique, 2e éd., t. XIII, Moscou, 1952).
À Londres, le mot fait son apparition en 1972:
DESINFORMATION: Deliberate leakage of misleading information (Chambers Twentieth Century Dictionary, London, 1972).
À Paris, il fait son apparition en 1974:
DÉSINFORMATION: Ignorance où le public est tenu d’un problème d’extrême gravité (cf. la folie nucléaire). Cela signifie également ne pas éclairer suffisamment l’opinion sur les questions importantes. (GRAND, PAMARD, RIVERAIN, Les Nouveaux Mots dans le vent, Larousse, 1974).
La prochaine réédition du Grand Robert contiendra la définition suivante:
DÉSINFORMATION: Utilisation des techniques de l’information, notamment de l’information de masse, pour induire en erreur, cacher ou travestir les faits. — REM. le mot est mal formé, dans la mesure où dès- (dé-) n’implique que la diminution ou l’annulation (d’une information).
Remerciements
Nombreux sont les collègues et amis dont j’ai sollicité les avis en rédigeant le présent essai. Si nombreux que je ne saurais les énumérer tous. Une aide particulièrement efficace m’a été notamment apportée par M. et Mme David Ayalon, par M. Scott Atran, par M. Jean Baumgarten, par M. Laurent Bensaïd, par M. Gérard Chaliand, par Mme Anne Coldefy-Faucard, par Mme Arlette Goldberg, par M. et Mme Michel Gordey, par Mme Colette Guillaumin, par Mme Nelly Gutmann, par Jacob Ioffé, par M. Daniel Lindenberg, par M. Jonathan Mandelbaum, par M. Joseph Mélèze-Modrzejewski, par M. Isaac Moadab, par M. Maurice Olender et par M. Pierre Nora. De manières diverses, ils n’ont ménagé ni leur temps ni leur peine. Je les remercie de tout mon cœur.
Et surtout, j’ai une fois de plus contracté une dette de reconnaissance auprès de mon érudit traducteur allemand, le Dr Rudolf Pfisterer, dont on lira en annexe l’importante contribution.
Notes de l’avant propos
1. Cf. mon Histoire de l’antisémitisme, en quatre volumes, Calmann-Lévy, Paris 1956-1977.
Notes du chapitre I (De l’antisémitisme)
2. Telle était la conception dominante: je viens de citer Thomas d’Aquin.
3. «Judaeum esse est delictum, non tamen punibile per christianum…» (Summa Angelica…).
4. Il suffira de confronter les tonalités de «un bon chrétien et «un bon juif».
5. Rien de plus suggestif à cet égard que la pièce Les Juifs du grand humaniste allemand Lessing (1750, la traduction française fut publiée en 1781).
6. Ou «La loi du royaume est la loi», en traduction littérale.
7. Cf. Histoire de l’antisémitisme, vol. III «De Voltaire à Wagner», Paris 1968, pp. 297-303 et passim.
8. C’est ainsi que Renan, traitant des progrès de la science au XIXe siècle, notait: «Le processus de la civilisation est reconnu dans ses lois générales. L’inégalité des races est constatée. Les titres de chaque famille humaine à des mentions plus ou moins honorables dans l’histoire du progrès sont à peu près déterminés» (préface de 1890 à L’Avenir de la Science; cf. «Œuvres complètes», éd. Calmann-Lévy, Paris, 1947-1961, t. IV, p. 724).
9. Faut-il préciser que dans le deuxième quart du XIXe siècle, l’âge des masses ne faisait que s’annoncer — en Allemagne plus timidement qu’en France — et que les discussions en question, capitales pour les développements ultérieurs, se limitaient aux milieux bourgeois et lettrés? Il convient d’ajouter que dans ces milieux également, la tendance antisémite était encore minoritaire, la majorité étant acquise à la «tolérance» des Juifs. Une tolérance que l’incorrigible Heine dénonçait — prophétiquement? — dans son fragment dédié à «Édom»:
Voici bien un millénaire
Que nous tolérons fraternellement
Toi, tu tolères que je respire,
Moi, je tolère tes fureurs.
Parfois, en des temps obscurs,
D’étranges humeurs te prenaient:
Tes pattes pieuses et affectueuses,
Tu les baignais de mon sang.
Ces temps-ci, notre amitié croît,
Elle se consolide chaque jour
Car j’entre aussi en rage,
Et je deviens presque pareil à toi!
10. Juifs de Cour: aux XVIIe-XVIIIe siècles, lorsque l’Allemagne morcelée comptait près de 300 principautés, l’usage s’était établi, chez les princes, de confier leurs problèmes financiers à un Juif (ce fut par exemple le cas, chez le prince de Hanau, de l’ancêtre des Rothschild). C’est de cet usage que procède le rôle exceptionnel des Juifs dans la montée de la banque allemande moderne, rôle qui eut des ramifications internationales (voir encore le cas des Rothschild).
11. Auteurs, respectivement, de Mont-Oriol (1887), de L’Argent (1891) et de Cosmopolis (1893). Le best-seller de l’antisémitisme français, La France juive d’Édouard Drumont, avait été publié en 1886.
12. Depuis la Révolution, à l’idéal universaliste français s’opposait, par réaction, un idéal particulariste germanique (Jules Michelet, déjà, écrivait: «La France est une nation, l’Allemagne est une race.») Dans cette perspective, les antidreyfusards étaient xénophobes plutôt que racistes. Or, parmi les divers facteurs qui alimentaient l’antisémitisme en France, les antécédents culturels germaniques de la majorité des Juifs, à commencer par leurs noms, renforçaient le rejet, et plus particulièrement le soupçon de trahison. On retrouvera ce genre d’hostilité en 1936-1937 sous le gouvernement de Léon Blum dont le nom fut d’ailleurs durablement estropié en «Karfunkenstein» (cf. l’édition de 1955 du «Petit Larousse»).
Il reste que l’antisémitisme français reculait devant les conséquences dernières. Il est caractéristique que les officiers français ne refusaient jamais, même lors de l’affaire Dreyfus, de se battre en duel avec des Juifs, tandis que pour les officiers germaniques, les sémites n’avaient pas «satisfaktionsfähig». Mieux encore, La Libre Parole de Drumont avait pour gérant un Juif converti, Gaston Wiallard, ce qui, dans la perspective des antisémites d’outre-Rhin, aurait constitué un «péché contre la race».
13. Dissoute à la fin de 1882, «La Sainte Légion» présenta au ministre de l’Intérieur un rapport d’activités confidentiel, qui fut publié en 1927 par une revue historique soviétique. Cf. à ce propos le tome II de mon ouvrage La Causalité diabolique (à paraître aux éditions Calmann-Lévy).
14. En 1864, Maurice JOLY avait publié à Bruxelles un pamphlet intitulé Dialogue aux Enfers entre Montesquieu et Machiavel, dans lequel Machiavel, qui figurait Napoléon III, exposait la manière de parvenir à la domination mondiale en mystifiant et abrutissant le peuple. Cf. la réédition, Calmann-Lévy, 1957, ainsi que Norman COHN, Histoire d’un mythe. La «Conspiration» juive et les Protocoles des Sages de Sion, Gallimard, 1967.
15. Au lendemain de Munich, Georges Bonnet, le ministre des Affaires étrangères, assurait à Von Ribbentrop que la France portait un vif intérêt à la «solution de la question juive». À la même époque, Jean Giraudoux, commissaire à la propagande, préconisait la création d’un «ministère de la race» en France. Il justifiait cette idée en insistant sur «la mauvaise qualité» des Juifs étrangers, «horde qui s’arrange pour être déchue de ses droits nationaux et braver ainsi toutes les expulsions, et que sa constitution physique, précaire et anormale, amène par milliers dans les hôpitaux qu’elle encombre…» (Cf. Pleins pouvoirs, Paris, 1939, p. 76).
16. Pratiquement inconnu, le cas du Japon illustre la confusion internationale qui entourait «le problème juif». Tout en se ralliant intégralement aux thèses antisémites du IIIe Reich, le Gouvernement japonais s’avisa, en 1937-1938, que les réfugiés juifs chassés d’Europe pourraient devenir d’excellents éléments de peuplement pour la Mandchourie conquise. Si le «plan Fugu» élaboré à cette fin échoua en grande partie, ce fut surtout du fait de l’opposition des Juifs américains; mais plusieurs milliers de Juifs lituaniens et polonais, acheminés en 1939-1940 à travers l’U.R.S.S., purent ainsi garder la vie sauve (cf. TOKAYER et SCHARTZ, Histoire inconnue… le plan Fugu, Paris, 1979).
17. Citons le plus illustre théologien protestant de ce temps, Karl Barth (1886-1968). Il écrivait (en 1941?): «Comme on le reconnaît généralement, l’existence des Juifs est une preuve adéquate de l’existence de Dieu. C’est une démonstration adéquate de la profondeur de la culpabilité humaine, et donc de l’inconcevable grandeur de l’amour de Dieu, signifié par l’événement dans lequel Dieu en Christ réconciliait le monde avec lui. Les Juifs des ghettos fournissent cette démonstration, sans le vouloir, sans joie et sans gloire, mais ils la fournissent. Ils n’ont rien à attester au monde sinon l’ombre de la croix de Jésus-Christ qui tombe sur eux.» La carmélite d’origine juive Édith Stein (1891-1942), une théologienne de grand renom qui ne savait pas qu’elle allait être gazée à Auschwitz, soutenait en 1938-1939 un point de vue analogue.
18. Il en fut autrement pour les «Aryens». En effet, ces mêmes prélats n’hésitèrent pas à protester publiquement contre le gazage, en 1940-1942, des malades mentaux allemands. L’émotion soulevée fut telle que Hitler se sentit obligé de stopper, à la fin de 1942, ce «programme d’euthanasie», qui coûta la vie à une centaine de milliers d’êtres sans défense.
19. Cf. Les Orientations pastorales sur l’attitude des chrétiens face au judaïsme de la Conférence épiscopale française (16 avril 1973).
20. «Pays habité» ou «population»; nom donné par les premiers colons à l’ensemble de la population juive de Palestine.
21. Au cours de la Première Guerre israélo-arabe, près de 600 000 Arabes palestiniens fuirent leur pays, encouragés par la propagande arabe, et terrorisés par le massacre de Deir-Yassin. En sens inverse, plus d’un million de Juifs fuirent les pays arabes, encouragés par la propagande israélienne, et terrorisés par des massacres semblables. En ce qui concerne la fuite des Arabes, l’un d’eux, Abou Yiad, devenu par la suite un dirigeant de l’O.L.P., la décrit comme suit dans son autobiographie:
«Abandonnés à leur sort, redoutant des massacres semblables à celui de Deir-Yassin, des centaines de milliers de Palestiniens décidèrent donc de quitter leur patrie pour se mettre à l’abri. D’autant plus que certains “comités nationaux” constitués de militants nationalistes, notamment à Jaffa, assuraient à ceux qui voulaient partir que leur exil serait de courte durée, quelques semaines ou quelques mois, le temps qu’il fallait à la coalition d’armées arabes pour vaincre les forces sionistes. La décision proclamée des pays arabes de résister par les armes à la création de l’État d’Israël avait suscité une grande espérance chez les Palestiniens. Rétrospectivement, je pense que mes compatriotes ont eu tort de faire confiance aux régimes arabes…» (Abou Yiad, responsable des services spéciaux palestiniens, Palestinien sans patrie [Entretiens avec Éric Rouleau], Fayolle, Paris, 1978, pp. 55-56).
22. Cf. L’article «conflit israélo-arabe», Encyclopaedia Universalis, t. IX, p. 229 (1972).
Notes du chapitre II (La propagande soviétique)
23. Cf. Henri SLOVÈS, L’État juif de l’Union soviétique, Les Presses d’aujourd’hui, Paris, 1982.
24. Cf. Les Juifs en Union soviétique depuis 1917, coll. «Diaspora», Calmann-Lévy 1971, pp. 168, 358, 383.
25. De la littérature consacrée aux projets ou intentions de Staline, en 1951-1953, on détachera Karel KAPLAN, Dans les archives du Comité central…, Albin Michel, Paris 1978, et HELLER et NEKRICH, L’Utopie au pouvoir, Histoire de l’U.R.S.S. de 1917 à nos jours, Calmann-Lévy, Paris 1982, pp. 415-422.
26. Cf. le procès-verbal officiel dans Rude Pravo, 26-11-1952.
27. «Joint» — American Jewish Joint Distribution Committee, association philanthropique créée en novembre 1914 pour venir en aide aux victimes juives de la Première Guerre mondiale.
28. HELLER et NEKRICH, L’Utopie au pouvoir…, op. cit., pp. 419-420. Pour d’autres détails sur ces préparatifs, voir L. POLIAKOV, De l’antisionisme à l’antisémitisme. Calmann-Lévy, Paris 1969, pp. 87-90.
29. Cf. 1984 de George Orwell.
30. Voir à ce propos De l’antisionisme à l’antisémitisme, op. cit., pp. 90-92.
31. N’oublions pas que dès l’été 1948, la Yougoslavie avait été exclue du «Kominform» et excommuniée en conséquence; en 1948-1953, «titiste» était une injure internationale, au même titre que «trotskiste». Une réconciliation n’intervint qu’en 1955, après une visite en Yougoslavie de Nikita Khrouchtchev.
32. M. Rodinson, qui depuis longtemps a quitté le parti communiste, n’a pas manqué de se rétracter; voir notamment Peuple juif, problème juif, Maspero, Paris 1981.
33. Arabie Saoudite, Égypte, Jordanie, Liban, Libye, Soudan, Syrie, Yémen. Cf. A. COMTE. Ce jour-là, Bandoeng, tournant de l’histoire, Paris 1960, et O. GUTARD, Bandoeng et le réveil des anciens peuples colonisés, Paris 1961.
34. Cf. L. Poliakov, Le Bréviaire de la haine. Calmann-Lévy, Paris 1979, pp. 287 et 295, ainsi que «Centre de Documentation juive», doc. DXXIII — 1309, 1310, 1313.
35. Cf. Le tract clandestin Qu’est-ce que le socialisme? dans lequel Kolakowki exposait ce que le socialisme n’était pas: «Une société dans laquelle quelqu’un est malheureux, parce qu’il dit ce qu’il pense… Une société où quelqu’un est heureux parce qu’il ne pense pas du tout…»» Cité par Christian JELEN, La Purge…, Paris 1972, pp. 213-216).
36. Le 11 mars 1968, dans son journal Slowo Powszechne, cf. La purge…, pp. 55 et suiv.
37. W. KMITOWZKI, Le Sionisme, sa genèse, son caractère politique et sa physionomie antipolonaise, avril 1968.
38. Émission diffusée le 24.12.1967, sous le titre «Pourquoi les États-Unis appuient-ils Israël?»
39. «Auto-édition», c’est-à-dire manuscrit polycopié, circulant en Union soviétique sous le manteau.
40. Cf. D.V. POSPIELOVSKI, Russian Nationalist Thought and the Jewish Question, «Soviet Jewish Affairs» vol. I/VI, London 1976, pp. 3-17.
41. Un compendium ou résumé de la partie juridique («Halakha») du Talmud, rédigé en Italie au XVIe siècle.
42. Cf. la Pravda, 5 août 1981.
43. Cf. Le Matin de Paris, 17 décembre 1981.
44. Cf. Les Sciences sociales en U.R.S.S., Série 5, Histoire, no 2/ 1982, pp. 28-30.
45. Cf. Le Monde, 15.6.1983 et Bulletin Agence télégraphique juive, 21.6.1983.
46. C’est-à-dire matérialisme dialectique.
47. Depuis la fin de 1982, cette émigration est pratiquement stoppée.
48. Un prêtre russe de Leningrad m’a raconté son odyssée de dissident: en 1973, à la suite d’un sermon qui choqua en haut lieu, il fut privé de sa paroisse et de son appartement de fonction. Il commença à fréquenter le milieu dissident, ce qui lui valut l’internement dans une «Psykhouchka» (l’hôpital psychiatrique spécialisé). Libéré après quarante jours de détention, il ne craignit pas de récidiver, fréquentant des milieux proches d’André Sakharov. Un beau jour, il reçut un coup de téléphone de l’O.V.I.R. (section du K.G.B. spécialisée dans la délivrance des visas pour Israël): «Votre visa pour Israël est arrivé.» Or, il n’avait jamais déposé de demande de visa pour l’étranger! Il comprit aussitôt qu’on lui offrait le choix entre le départ et un internement d’une durée indéfinie. Il choisit la première solution: de Vienne, il se dirigea directement à Paris.
49. Il semble que cette rumeur ait été, sinon lancée, du moins fortement exploitée, au lendemain de la mort de Brejnev, par les partisans du concurrent de M. Andropov: M. Tchernienko.
Notes du chapitre III (La propagande arabe)
50. «Si l’on veut essayer, chez nous, de “dépassionner” le conflit du Moyen-Orient, il faudra bien, cependant, que l’on essaie de voir clair dans ce problème. Notons tout d’abord qu’Arabes et Juifs — à l’origine, bien entendu — appartiennent à une seule et même ethnie. Ils sont sémites les uns et les autres. Parler d’antisémitisme à propos des Arabes est donc une absurdité étymologique.» (Pierre DURANT, Arabes, Européens et antisémitisme).
51. Cf. «Le conflit israélo-arabe», no spécial 253 bis des Temps Modernes, juin 1967, pp. 224 et suiv., 256 et suiv., 176 et suiv.
52. Cf. Qu’est-ce qu’une nation? (1882) et notamment à la conclusion de Renan: «L’homme n’est esclave ni de sa race, ni de sa langue, ni de la direction des chaînes de montagne. Une grande agrégation d’hommes, saine d’esprit et chaude de cœur, crée une conscience morale qui s’appelle une nation…» Pourtant Renan, en homme de son temps, croyait à «l’inégalité» des races humaines.
53. Sur le «Christ aryen», une conception qui remontait à la fin du XIXe siècle, voir le Mythe aryen, Calmann-Lévy, Paris, 1971, pp. 371-372.
54. Cf. Le Monde, page «Idées», 10 août 1982.
55. Cf. Ibid., 9 septembre 1983 (compte rendu de la conférence sur la Palestine tenue à Genève).
56. Sur la condition des Juifs sous la domination arabe, voir Histoire de l’antisémitisme, t. II («De Mahomet aux marranes»), Paris, 1955-1980.
57. Cf. E. ROULEAU, J.-F. HELD, J. et S. LACOUTURE, Israël et les Arabes, le troisième combat, Paris, 1967.
58. Cf. Y. HARKABI, Arab attitudes to Israel, Jérusalem, 1972, p. 518, citant le journal libanais al-Anwar du 8 mars 1970.
59. Voir la «présentation» de Claude LANZMANN («Le conflit israélo-arabe», dossier, Les Temps Modernes, no 253 bis, juin 1967).
60. Date du Premier congrès sioniste, réuni en 1897 à Bâle.
61. Voir le dossier précité des Temps Modernes, pp. 225-226. M. Mohieddine était un ancien officier qui avait dirigé les journaux al-Massa, al-Ahbar et Yom. De nos jours les directeurs des journaux égyptiens bénéficient d’une meilleure formation professionnelle.
62. Cf. Israël et les Arabes, le troisième combat, op. cit., p. 22.
63. Cf. l’interview donnée par M. Ben Bella à la Revue de politique internationale, no 16 (été 1982), dans laquelle il avait mentionné l’armement nucléaire israélien. Questions et réponses s’enchaînaient ainsi:
Q. — «C’est la menace de la guerre nucléaire?
R. — Eh bien, je vais vous dire le fond de ma pensée. S’il n’y a pas d’autre solution, que cette guerre nucléaire ait lieu, et qu’on en finisse une fois pour toutes.
Q. — Plutôt l’Apocalypse nucléaire que le fait israélien?
R. — Sans aucun doute. Toutefois, je ne crois pas à la guerre nucléaire. Ce que nous voulons, nous autres Arabes, c’est être. Or, nous ne pourrons être que si l’Autre n’est pas.»
64. Cf. plus loin, p. 116.
65. Les actes de cette conférence furent traduits en anglais, et publiés sous le titre The Fourth Conference of The Academy of Islamic Research, Cairo, 1970. Ci-dessus, je me réfère aux extraits traduits en français, sous le titre Les Juifs et Israël vus par les théologiens arabes, Éd. de l’Avenir, Genève, 1972.
66. Cité par Jacques GIVET, Israël et le génocide inachevé, Plon, Paris, 1979, p. 111.
67. Cf. Dr al-Sayied Rizq al-Tawil, Les fils d’Israël dans le Coran, Le Caire, 1980, et Dr Kamil Sa'afan, Les Juifs, histoire et doctrine, Le Caire, 1981. Ces données, ainsi que (sauf contraire) celles qui suivent m’ont été communiquées par Mme R. Yadlin, du Truman Institute de l’université de Jérusalem, que je remercie pour son extrême obligeance.
68. Cité par J.-P. PÉRONCEL-HUGOZ, Le Radeau de Mahomet, éd. Lieu Commun, Paris, 1983. p. 73.
69. Cf. Le Monde, 2.6.82.
70. Cf. PÉRONCEL-HUGOZ, op. cit., p. 49 et passim; et F. SCHUON, Pour comprendre l’Islam, Le Seuil, Paris, 1976, p. 39.
71. Cf. H. LEVINS, Arab Reach… Doubleday, New York, 1983, p. 270 et p. 273.
72. Ce scandale remonte à 1979, lorsque des agents du F.B.I. déguisés en Arabes offrirent à des hommes politiques américains des sommes d’argent en échange d’interventions administatives ou politiques d’ordre divers. Un sénateur et six membres du Congrès tombèrent dans ce piège; en conséquence, ils furent condamnés à de lourdes peines de prison. (Cf. le rapport intitulé: «Abscam Scandal Clouded Congress’ Image» dans l’annuaire Congress and Government, Washington, 1980, pp. 513-520 et International Herald Tribune, 1.6.1983).
73. Cf. Arab Reach…, pp. 155-156.
74. Cette mesure fut précédée par la condamnation d’Israël pour atteinte au patrimoine culturel palestinien, en raison des fouilles poursuivies par les archéologues israéliens à Jérusalem. Suivit le partage des pays membres de l’Unesco en groupes régionaux. Le groupe asiatique refusa l’admission d’Israël. Il fut alors question de l’inclure, à l’exemple du Canada, dans le groupe européen, mais cette solution exceptionnelle ne rallia pas le nombre requis de voix.
75. Conférence de «L’année internationale de la femme «(Mexico, 19-6/2-7-1975); conférence de l’«Organisation de l’Unité africaine» (Kampala, 28-7/1-8-1975); conférence des ministres des pays «non alignés» (Lima, 25/30-8-1975).
76. Daily Nation, Nairobi, 14-11-1975; The Statesman, New Delhi, 13-11-1975; Et Espectador, Bogota, 21-10-1975.
77. Cf. la plaquette Réactions dans le monde à la résolution de l’O.N.U. sur le sionisme, publiée par le «Centre d’information et de documentation sur le Proche-Orient» de Genève.
78. Cf. Le Nouvel Observateur, 17-11-1975, Le Figaro, le 20-10-1975, et Le Canard Enchaîné, 12-11-1975.
Notes du chapitre IV (Le tournant de la guerre des Six jours)
79. Ainsi le 30 mai 1967, à 20 h: «À la suite de la fermeture du golfe d’Akaba, deux possibilités se présentent à Israël, et chacune d’elles trempe dans son sang: ou bien il mourra d’étouffement en raison du blocus militaire et économique arabe, ou bien il mourra sous le feu des forces arabes qui l’entourent au sud, au nord et à l’est» (cf. Israël et les Arabes… op. cit., p. 41).
80. Cité dans Israël et les Arabes…, p. 54.
81. Interviewé au début de 1970 par Éric Rouleau, Nasser expliquait comme suit sa décision de bloquer le détroit de Tiran: «Le secrétaire général de l’O.N.U., sur les conseils d’un haut fonctionnaire de l’Organisation, décida de rappeler l’ensemble des Casques bleus, nous mettant ainsi dans l’obligation d’envoyer des troupes égyptiennes à Charm-El-Cheikh et d’instaurer le blocus. Nous sommes tombés dans le piège qu’on nous avait tendu.» (Cf. Le Monde, 19-2-1970).
82. O'BALANCE, The ThirdArab-Israeli War, London, 1972, p. 30.
83. Cf. Israël et les Arabes…, op.cit., p. 29.
84. Claude RANEL, Moi, Juif palestinien, Laffont, Paris 1970, p. 112.
85. Cf. KISSINGER, Les Années orageuses, Fayard 1982, t. II, p. 1003, et t. I, p. 649.
86. Cf. «résolution 242» de novembre 1967.
87. Cf. Walter LAQUEUR, La vraie guerre du Kippour, Calmann-Lévy, 1974, p. 39.
88. Cf. la «petite phrase» de M. Michel Jobert, à l’époque ministre des Affaires étrangères: «Est-ce que de tenter de remettre les pieds chez soi constitue forcément une agression imprévue?»
89. La remarque est de M. Walter Laqueur, qui ajoute, avec beaucoup de justesse: «Israël aurait été un membre respecté de la Communauté des Nations […] Tels sont les faits, mais ils ne modifieront probablement pas les sentiments des moralistes, de même que les jusqu’au-boutistes israéliens continueront sans aucun doute à proclamer que leur pays n’a essuyé ce revers que faute d’une politique assez agressive. La folie, comme Protée, a de multiples visages…» (W. LAQUEUR, La vraie guerre du Kippour, p. 271).
90. Sur ce point, la désinformation règne en maître. «État théocratique»? Il faut savoir que la tradition talmudique est formellement anti-annexionniste, pour des raisons tant éthiques qu’historiques. On lira avec profit, à ce propos, l’étude du professeur Henri Atlan, «Un peuple qu’on dit élu…», dans la revue Le genre humain, nos 3-4, été 1982. On trouvera de plus amples précisions dans l'Encyclopaedia Judaica (Jérusalem 1970); voir les articles Geography et Israël (Land of, Boundaries). Je remercie le professeur F.M. Rausky (université de Paris-XII) des indications qu’il m’a fournies à ce sujet.
91. Il va de soi que les gens avertis ne s’y trompèrent pas. Voir, par exemple, Simone de BEAUVOIR, Tout compte fait, Gallimard, Paris, 1972, pp. 444-446.
92. Cf. R. ARON, De Gaulle, Israël et les Juifs, Plon, Paris, 1968, p. 18.
93. Cf. E. BERL, Nasser tel qu’on le loue, Gallimard coll. «Idées», Paris, 1968, pp. 59-68.
94. Cf. De l’antisionisme à l’antisémitisme, op. cit., pp. 157-160.
95. Prof. Edward ALEXANDER, «The Journalists’ War against Israel…» Encounter, Londres, septembre-octobre 1982, p. 87.
96. Cf. L’Humanité, 17 juin 1967.
97. Cf. Les Années orageuses, Fayard 1982, t. I, p. 210. Dans ces volumes, KISSINGER parle beaucoup de M. Jobert, et il n’en dit pas que du mal: «Et puis, je l’aimais personnellement» (ibid., t. II, p. 1112).
98. Cf. Journal officiel, 10-5-1980 («circulaire Barre») et 18-7-1981 («circulaire Mauroy»).
Notes du chapitre V (La génération de 1968)
99. Cf. Histoire de l’antisémitisme, t. IV, Paris, 1977, pp. 309-312.
100. Cf. Le Bréviaire de la haine, Calmann-Lévy, Paris, 1978, p. 351.
101. Cf. L’Orient, Beyrouth, 31-12-1967.
102. Jean BAUBÉROT, «Les chrétiens et Israël», Christianisme social, nos 9-10, 1967, p. 483.
103. François Biot avait en vue les chapitres IX à XI de L’Épître aux Romains de saint Paul, dans lesquels l’apôtre comparait les Juifs, bien qu’infidèles, à la racine d’un olivier, et les Gentils convertis à des «branches entées». Selon ces chapitres, les Juifs, «aimés à cause de leurs pères», gardaient le bénéfice de l’élection, malgré leur désobéissance. Pour les théologiens luthériens des «Lumières» allemandes, voir Histoire de l’antisémitisme, vol. III, Calmann-Lévy, 1968, pp. 192-207.
104. Cf. L’Arche, novembre-décembre 1969, «La propagande arabe en France», pp. 35-39, et la note de la p. 37.
105. Ce texte a été rédigé par l’auteur du Marxisme introuvable à l’intention du présent ouvrage. Il est donc inédit.
106. Nadine FRESCO, «Les redresseurs de morts », Les Temps Modernes, juin 1980; Pierre VIDAL-NAQUET, «Un Eichmann de papier», Esprit, septembre 1980; P.-A. TAGUIEFF, «L’héritage nazi», Les Nouveaux Cahiers, no 64, printemps 1981; Alain FINKIELKRAUT, L’avenir d’une négation, Le Seuil, Paris, 1981.
107. Cf. l’interview de Darquier de Pellepoix, publiée sous ce titre par L’Express, en automne 1978.
108. Cf. Histoire de l’antisémitisme, notamment vol. III («De Voltaire à Wagner»), pp. 271-317; et vol. IV («L’Europe suicidaire»), pp. 15-83.
109. Voir D. SCHNAPPER, Juifs et Israélites, coll. «Idées», Gallimard, Paris, 1980. Je fais ci-dessus des emprunts à la section «Les anti-Israéliens», pp. 172-186.
110. P. GOLDMANN, Souvenirs obscurs d’un Juif polonais né en France, Le Seuil, Paris, 1975, pp. 183-184. Ce livre avait été écrit en prison, où Pierre Goldmann purgeait une peine pour cambriolage.
111. Cf. COHN-BENDIT, Le Grand Bazar, Paris, 1975, p. 19.
112. Cf. l’interview de Cohn-Bendit dans L’Arche. juin 1978.
113. Voici le contexte de la comparaison: «De l’enlèvement des vedettes de Cherbourg au meurtre d’Hamschari, on a assisté en France à la création d’une nouvelle O.A.S. Une majorité de Français ne devrait avoir aucun mal à se dégager contre ces nouveaux nazis que sont les sionistes.» (Le Monde, 16-12-1972).
114. Voir l’interview de Geismar dans L. ROSENZWEIG, La Jeune France juive, Paris, 1978, pp. 36-61.
Notes de la conclusion
115. Cf. en dernier lieu Jeane KIRKPATRICK, «Les Nations-Unies et Israël, la néfaste politique des blocs», Les Nouveaux Cahiers, no 73, été 1983, pp. 5-8.
116. Cf. L’Avenir d’une négation, Le Seuil, Paris, 1981, pp. 140-141.
117. La France en mai 1981. Cf.: «La Documentation Française», décembre 1981, t. V, p. 96.
118. Étude psychologique réalisée pour le C.R.I.F. par S.O.F.C.O. sous la direction de M. Emeric Deutsch, mars à décembre 1981.
119. Cf. Le Monde, 20/21-6-82.
120. Évitons toutefois les condamnations collectives. Certains présentateurs (par exemple MM. Poivre d’Arvor et D. Bilalian) s’efforçaient de demeurer neutres, dans le cadre des informations et images qui leur parvenaient de Beyrouth-Ouest et d’ailleurs.
121. Cf. PLO in Lebanon, op. cit., p. 280 et p. 256.
122. Cf. Martine GOZLAN, «Comment, au lycée Voltaire, les professeurs ont provoqué un climat d’antisémitisme», Le Droit de vivre, octobre 1982, p. 17.
123. Cf. Le Monde, 26-6-1982.
124. «Nous, nous disons que ce sont les Israéliens qui ont tué le Christ. Comment les chrétiens peuvent-ils accepter cela? Il faut que les chrétiens sachent que les Israéliens peuvent tuer le chrétien comme ils ont tué le druze» (Cf. l’émission Panorama Culturel, «France-Culture» 1-6-83).
125. P.-J. FRANCESCHINI, «Une guerre à outrances», Le Monde, 30-6-1982.
126. P.J. FINKIELKRAUT, La Réprobation d’Israël, coll. «Médiations», Paris, 1983, pp. 178-179.
127. Cf. Commentary, New York, décembre 1982, p. 15 et p. 70.
128. Cf. Patterns of Prejudice, London, octobre 1982, p. 32.
129. Ibid., p. 43.
130. Ibid., p. 44.
131. Pour le détail, je renvoie aux vol. III et IV de Histoire de l’antisémitisme.
Notes de l’Annexe (le cas allemand par le Dr R. Pfisterer)
132. Allgemeine Jüdische Wochenzeitung, 30-7-1982.
133. W. BIRKENMEIER, «Israel und der Antisemitismus», Stuttgarter Zeitung, 17-8-1982.
134. Die Zeit, 3-9-1982. On retrouve la même idée dans une lettre de lecteur publiée par Der Spiegel, 17-7-1982, dans laquelle il est question d’une «campagne de vengeance vétéro-testamentaire contre le Liban. Membre d’une association d’amitié judéo-chrétienne, ce n’est pas ainsi que je me suis représenté cette amitié…».
135. Bulletin ronéotypé de l’alliance judéo-chrétienne.
136. Informations d’Israël, Jérusalem, 15-8-1982. L’éditeur de ce bulletin est le journaliste allemand Ludwig Schneider.
137. Ibid.
138. Ibid.
139. Ulrich SAHM, «Wer sagt in diesem Krieg schon de Wahrheit?», Stuttgarter Zeitung, 22-7-1982.
140. Henryk BRODER, «Antisemitismus im neuen Gewand», Botschaft des Staates Israel, Bonn, août 1982.
141. Informations d’Israël, Zürich, novembre 1982.
142. W. NOEL, «Harte Worte Bruno Kreiskys», Allgemeine Jüdische Wochenzeitung, 2-7-1982.
143. Informations d’Israël, Jérusalem, 15-8-1982.
144. Andreas KOHLSCHÜTTER, «In die Tränen mischt sich die Wut», Die Zeit, 20-8-1982.
145. Pearl Sheffy GEFEN, «Behind the lies in Lebanon», Jerusalem Post, 29-10-1982.
146. Theo SOMMER, «Kritik an Israel — für uns verboten?», Die Zeit, 6-8-1982.
147. Cité par Walter MEININGEN, «Dass Begin Jude sei…», cf. Der Monat, no 285, 1982, p. 134.
148. H. JAENECKE, «Israel hat seinen moralischen Bonus verspielt», Stern, 15-7-1982.
149. H. BRODER, Antisemitismus im neuen Gewand, op. cit.
150. Informations d’Israël, Zürich, novembre 1982.
151. Ibid.
152. Johann Christian HAMPE, émission du Süddeutscher Rundfunk, 16-6-1982.
153. Ulrich SCHOEN, Aus einer belagerten Stadt, «Evangelische Kommentare», Stuttgart, août 1982.
154. H. BRODER, op. cit.
155. B. KREISKY, «Mit diesem Israel will ich nichts zu tun haben», Stern, 26-8-1982.
156. Andreas KOHLSCHÜTTER, «In die Trânen mischt sich die Wut», article cité.
157. Allgemeine jüdische Wochenzeitung, 26-11-1982.
158. «An appeal for an israeli withdrawal», Jerusalem Post, 18-6-1982.
159. Andreas KOHLSCHÜTTER, op. cit.
160. Cf. l’article de Jacques ELLUL, paru dans Réforme, 30-5-1970.
161. Elie WIESEL, «Lettre à un ami allemand gauchiste, maoïste, terroriste», dans Un Juif aujourd’hui, Paris, 1977, pp. 122-125.